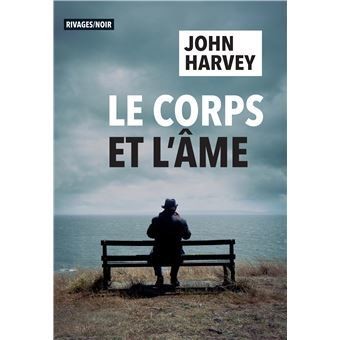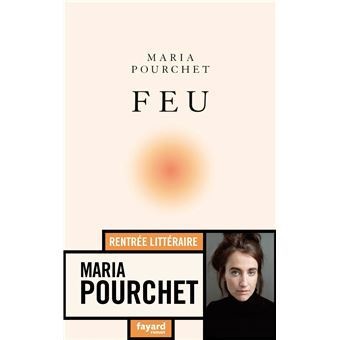>> Toutes les rubriques <<
· Discussion (473)
· Poésies (203)
· Mes ballades (83)
· MUSIQUE (112)
· UN PEU DE CORSE, la langue d'ici (40)
· HANDICAP (13)
· PHOTOS (17)
· MAXIMES,REFLEXIONS (33)
· Dansons,dansons, (23)
· Blagues (16)
· RANDONNÉE CORSE – POZZI DE BASTELICA
· POESIE de mon pays
· La Conspiration de l'ombre
· Dardanus.
· La Traversée des temps - Paradis perdus
· POESIE d'été
· Les glacières de Cardo et de Ville-di-Pietrabugno
· OLMO
· Rando:Cima di e Follicie
· LA PANTHÈRE DES NEIGES.SYLVAIN TESSON
· Avant elle
· VENISE!!
· Vie pour Vie
· Randonnée chemin du littoral ou sentier des douaniers.
· le petit pont génois
angebot bereit schnell
hallo,
ungl aublich, aber wahr, es gibt zu viele betrügereien über kreditangebot
Par Sabine, le 08.02.2022
comment ne pas aimer la corse !
Par Anonyme, le 20.07.2021
bonjour,
me rci pour ce relais...
nou s connaissons-no us peut-être?
bien à vous.
hugue s simard
Par Anonyme, le 03.05.2021
et comme toujours pas un mot sur la seule cause à la base de la catastrophe climatique : la surpopulation, jam
Par anonyme, le 22.04.2021
donat nonnotte; donatien nonnotte, né le 10 février 1708 à besançon et mort le 5 février 1785 à lyon, est un p
Par Anonyme, le 14.03.2021
air amis amour background belle bleu bonjour bonne carte centre cheval chez
Abonnement au blogImagesStatistiques
Date de création : 16.06.2010
Dernière mise à jour :
01.08.2024
1173 articles
Sauve-la.
RÉSUMÉ
Prix Cognac 2020 du meilleur roman francophone
Alexis Lepage, modeste employé d’assurances, est sur le point de se marier avec la fille de son patron lorsqu’il reçoit un message de Clara, son amour de jeunesse, qui refait surface après des années.
Alors qu’elle le supplie de l’aider à retrouver sa fille disparue, Alexis hésite. Que dissimule cette demande impromptue, si longtemps après leur séparation?? Et pourquoi Clara refuse-t-elle de le rencontrer??
Replongé dans un passé dont il n’a jamais fait le deuil, Alexis va partir à la recherche d’une fille dont il ignore tout.
Son enquête le conduira droit en enfer.
......................................................................................................................................................................
1Le crépuscule assombrissait l’horizon quand le vieux bus enchaîna ses premiers virages. Sur ses flancs, la peinture s’écaillait et le pot d’échappement crachait un épais nuage noir.
Elle avait choisi une place quelques rangs derrière le chauffeur, qui fumait comme un pompier.
À l’arrière, une dizaine d’hommes ne cessaient de la dévorer des yeux depuis qu’elle était montée à bord. Pourtant, elle n’avait rien d’affriolant avec ses vêtements sales et tachés de boue, ses traits ravagés par l’épuisement. Mais elle était la seule femme.
Le moteur émettait un bruit sourd et inquiétant dans les descentes. L’air lourd de l’habitacle, mélange de vieille sueur et de cigarillos, collait à sa peau.
Malgré ses efforts, elle n’était pas parvenue à ouvrir sa vitre ; chaque virage lui soulevait le cœur.
Ses yeux restaient fixés sur le dossier du siège devant elle, tandis que ses doigts serraient convulsivement son portefeuille. Elle repensait aux dernières heures et à son ami qui avait disparu. L’inquiétude la rongeait.
L’obscurité s’épaissit encore et les crêtes des montagnes s’estompèrent dans le noir. À un moment, le moteur ronfla et elle redressa la tête.
Un type quittait son siège et se dirigeait vers le conducteur.
Les volutes bleuâtres de son ninas lui piquaient les yeux et la gorge ; elle n’avait rien bu de toute la journée.
Se désaltérer et quitter ces montagnes, c’était tout ce qui lui importait.
Une dispute éclata à l’avant. Elle ne comprenait pas l’espagnol, et le passager debout ne baragouinait visiblement que deux ou trois mots.
Un instant le chauffeur tourna la tête vers l’homme qui refusait de regagner sa place et le bus fit une embardée, heurtant le panneau « Virage dangereux ».
Dans son élan, le véhicule longea le bord du ravin sur quelques mètres et le conducteur rétrograda, faisant craquer le boîtier de vitesse.
Mais l’allure de l’autocar ne diminua pas.
L’homme écrasa la pédale de frein et la lourde carcasse glissa de l’autre côté de la route jusqu’à buter contre un pan de la montagne dans un fracas de tôles froissées. Un des phares explosa et la course du bus devint erratique.
Tous les passagers, cramponnés, scrutaient la manœuvre avec un regard noyé de la même peur viscérale.
Le chauffeur cracha son cigare et tira sur le frein à main de toutes ses forces.
Les pneus hurlèrent tandis que du moteur jaillissait un vacarme de soupapes sur le point d’exploser. Entraîné par son propre poids, le véhicule fila droit vers le parapet qu’il heurta de plein fouet.
Le bus s’était immobilisé, sa première moitié engagée au-delà de ce qui restait du muret, ses roues avant tournant au-dessus de l’abîme, l’arrière à cheval sur le talus.
Passé l’état de sidération, les hommes se levèrent de leurs sièges simultanément.
Alors, le chauffeur se retourna, le visage lacéré par les éclats du pare-brise pulvérisé lors du choc.
Il hurla un ordre que personne n’entendit ou ne comprit, elle ne le saurait jamais.
Les passagers se ruèrent vers la porte latérale et leur poids fit osciller le bus.
Dans un ralenti cauchemardesque, elle vit l’unique phare éclairer le gouffre, puis les sièges voltiger dans l’habitacle : l’autocar se disloquait.
Le bruit de sa chute épouvantable se répercuta dans la vallée avant de retomber dans une pluie de poussière et de roches éclatées.
Ensevelie sous un monceau de tôles et de débris, en état de choc, le souffle coupé par l’effroi et la douleur, elle voulut dégager ses mains et sa tête. Le vent s’était levé, déchirant les nuages.
Les premières étoiles.
.................................................;
2
Cette nuit-là, il avait rêvé d’elle.
Les yeux mi-clos, il contemplait les ombres grises du petit jour qui progressaient dans la chambre. Il savait qu’il ne retrouverait pas le sommeil, plus à son âge.
Couchée sur le ventre, Clémence ronflait paisiblement, le visage à demi enfoui dans la couette. Quelques mèches blondes se détachaient sur l’oreiller. Avant de se glisser doucement hors du lit, il la contempla, une sensation désagréable à l’estomac.
Le contact du carrelage de la salle de bains le fit frissonner. Il tourna le robinet de la douche, un modèle italien que sa fiancée avait choisi, comme tout le reste dans leur pavillon.
Il laissait l’eau chaude noyer les débris de sa nuit, l’image de Clara debout sur la rive d’un lac remonta à la surface de sa mémoire. Ce qu’elle lui criait l’avait réveillé.
Dans la buée du miroir de la salle de bains, il interrogea son reflet.
Qu’est-ce qui t’angoisse comme ça ? La date du mariage qui approche, ou tes vieilles amours qui se rappellent à toi ?
Il n’arrivait pas à se souvenir des mots de Clara dans son rêve.
Lavé, rasé de près, Alexis alla se préparer un café dans la cuisine où perçaient les premiers rayons d’un jour d’automne. La baie vitrée offrait une vue panoramique sur la Loire ; un bateau quittait le port de Trentemoult pour rejoindre l’embarcadère de Nantes, de l’autre côté du fleuve.
Il posa la tasse dans l’évier et jeta un coup d’œil à la pendule au-dessus du four.
À peine 7 heures et je me pose la question de mettre une cravate ! pensa-t-il avec une pointe de résignation.
Sa vie changeait si vite à présent qu’elle en devenait presque irréelle. Peut-être était-il encore en train de rêver ?
Il aperçut Clémence, immobile sur le seuil de la cuisine.
Elle était en nuisette, une pièce de lingerie raffinée qu’il lui avait montrée du doigt, dans la vitrine d’une boutique chic de la rue Crébillon, et qu’elle s’était empressée d’acheter pour lui faire plaisir.
Alexis adorait sa poitrine, toujours ferme, ses longues jambes et la hauteur de sa nuque quand elle portait ses cheveux relevés. Clémence avançait dans la quarantaine, mais elle conservait cette touche de candeur héritée de l’adolescence, un brin de
sophistication et un je-ne-sais-quoi de rebelle qui pactisait avec son éducation catholique.
— Il est tôt, tout va bien ? demanda-t-elle, l’air soucieux.
Il força son sourire.
— J’avais trop chaud, impossible de me rendormir.
Elle s’approcha et l’embrassa dans le cou. Ses lèvres étaient douces, elle sentait bon.
— Ne me dis pas que c’est le rendez-vous avec mon père qui t’inquiète ? dit-elle d’un air taquin en lui ébouriffant les cheveux.
Alexis haussa les épaules. Travailler sous les ordres de « beau-papa » n’était pas l’aspect de sa vie le plus enviable. Surtout quand il se nommait Pierre-André Dulac, figure de la grande bourgeoisie nantaise dont les aïeuls avaient en partie écrit l’histoire de la ville ! Clémence lui avait même appris qu’une place, près du musée des beaux-arts, portait l’illustre patronyme. Les affaires avaient fait de Dulac un homme plein de morgue qui ne tournait pas autour du pot. Il vénérait sa fille unique et n’avait jamais caché à son futur gendre qu’il incarnait sa dernière chance d’être grand-père. Cette perspective seule compensait ce qu’il considérait comme une mésalliance, sa fille n’ayant jamais eu jusqu’alors l’étrange idée de s’amouracher d’un sans-le-sou. Mais qu’importait, pourvu qu’un petit-fils fasse pousser une nouvelle branche à l’arbre généalogique de la dynastie…
— Tout va bien se passer, fit Clémence.
Alexis hocha la tête sans conviction.
Elle ajouta :
— Et mon petit doigt me dit qu’il y a une bonne nouvelle à la clef.
Alexis l’embrassa pour clore le sujet et saisit son manteau. L’idée que père et fille complotent dans son dos l’agaçait, le dérangeait même.
Au moment où il traversait l’entrée, elle lui lança :
— On n’a toujours pas reçu le devis pour le repas du mariage, tu pourrais envoyer un mail au traiteur ?
Encore une fois, il hocha la tête. Puis il tourna les talons et sortit.
Pendant que la porte du garage coulissait, une averse d’images l’assaillit tel un rideau qui se déchire. Des fragments de son rêve.
Alexis, je t’en supplie. Sauve-la ! hurlait Clara.
...............................................................................................................................................................
BIO;
Sylvain Forge, né en 1971 à Vichy, est un écrivain français, auteur de romans policiers. Conférencier en dramaturgie, il est également expert en cybersécurité. En 2019, le magazine Usine nouvelle l'a classé parmi "les 100 Français qui comptent dans la cybersécurité.
Romans
La Ligne des rats, Éditions Odin, coll. « Énigme » (2009) (ISBN 978-2-913167-66-7)
Le Vallon des Parques, Éditions du Toucan, coll. « Toucan noir » (2013) (ISBN 978-2-8100-0526-0), réédition Le Grand Livre du mois (2013) (ISBN 978-2-286-09650-2), réédition Éditions du Toucan, coll. « Toucan noir » (2014) (ISBN 978-2-8100-0575-8)
La Trace du silure, Éditions du Toucan, coll. « Toucan noir » (2014) (ISBN 978-2-8100-0569-7), réédition Le Grand Livre du mois (2014) (ISBN 978-2-286-10778-9)
Un parfum de soufre, Éditions du Toucan, coll. « Toucan noir » (2015) (ISBN 978-2-8100-0622-9)
Sous la ville, Éditions du Toucan, coll. « Toucan noir » (2016) (ISBN 978-2-8100-0716-5)
Pire que le mal, Éditions du Toucan, coll. « Toucan noir » (2017) (ISBN 978-2-8100-0771-4)
Tension extrême, Éditions Fayard (2017) (ISBN 978-2-213-70495-1)
Parasite, Éditions Mazarine (2019) (ISBN 978-2-863-74493-2)
Sauve la, Éditions Fayard (2020) (ISBN 978-2-213-7187-98)
Le Royaume du fleuve, Éditions Michel Lafon (2021) (ISBN 978-2-749-9412-40)
Prix et distinctions
Plume d'argent du thriller francophone 2016 pour Un parfum de soufre
Prix du Quai des Orfèvres 2018 pour Tension extrême
Prix Cognac du meilleur roman francophone 2020 pour Sauve la
Prix Polar Découverte les petits mots des libraires 2021 pour Sauve la
Prix Imaginaire Découverte les petits mots des libraires 2021 pour Le royaume du fleuve
Nominations
Prix des bibliothèques et des médiathèques de la Ville de Cognac 2013 pour Le Vallon des Parques
Prix Sang pour sang polar 2013 pour Le Vallon des Parques
Prix lycéen des incorrigibles de la ville de Vichy 2013 -2014 pour Le Vallon des Parques
Grand Prix de l'association des écrivains bretons 2014 pour Le Vallon des Parques
Plume de Cristal 2014 pour La Trace du silure
Prix POLAR du roman francophone au festival de Cognac 2014 pour La Trace du silure
Prix POLAR du meilleur roman francophone de Cognac 2015 pour Un parfum de soufre
Prix POLAR du meilleur roman francophone de Cognac 2016 pour Sous la ville
Prix POLAR du meilleur roman francophone de Cognac 2017 pour Pire que le mal
Le corps et l'âme.
Résumé;
L'ultime aventure du personnage de Frank Elder, inspecteur de police à la retraite, qui doit intervenir dans une affaire à laquelle est mêlée sa fille Catherine.
Une enquête mêlée à un drame intime.
Après avoir mis fin à la carrière de Charlie Resnick, flic d'origine polak dans Ténèbres, Ténèbres , c'est au tour de Frank Elder d'être remisé au placard par John Harvey.Plus que tout autre roman de l'auteur, le corps et l'âme est émouvant, poignant. Un crime auquel est mêlée Katherine, qui a déjà tant subi dans un opus précédent, remet Frank en selle. Mais quel genre de père ne connaît pas l'adresse de sa fille unique ? C'est l'occasion pour celui qui s'est retiré – ou a fui – jusqu'à l'extrême pointe des Cornouailles, de s'interroger sur le sens de sa vie, de se perdre parfois dans une rêverie où il revient sur ses erreurs conjugales, paternelles ou professionnelles. Avec Vicky, Frank a noué une relation sentimentale qui n'a pas vocation à trop prendre d'importance.
.....................................................................................................................................................................
. I
À la lisière du village, la maison était la dernière d’une rangée de petites bâtisses en pierre adossées à des champs qui s’abaissaient en pente douce jusqu’à la mer. Elder ferma soigneusement la porte, remonta le col de son manteau pour se protéger du vent, et après un dernier regard à sa montre, s’éloigna sur le sentier en direction de la pointe. Le ciel traversé de nuages commençait à s’assombrir. Bientôt, à l’approche des falaises, le terrain devint inégal et rocailleux sous ses pieds. Des lapins levés par son passage détalaient tout autour. Plus loin, une barque de pêche se balançait au gré des flots. Des mouettes tournoyaient dans les airs.
Sur la pointe, il se retourna pour embrasser la vue derrière lui. Au-dessus du village, la route par laquelle elle arriverait descendait de la lande, sinuant entre un fouillis de rochers, de cailloux, de bruyère et d’ajoncs. Les phares des voitures étaient comme adoucis par un brouillard.
Depuis combien de temps ne l’avait-il pas vue ? Katherine. Sa fille. Une cérémonie de remise de diplômes qui avait mal fini, quand, mésestimant l’importance du moment, il n’avait pas su trouver les mots justes. Depuis, il y avait eu des coups de fil, surtout ceux qu’il passait, lui, emplis de silences prolongés, de réponses laconiques, de soupirs laborieux. Ses rares mails restaient en grande partie sans réponse, de même que ses SMS, plus rares encore. Qu’espérait-il ? Vingt-trois ans, bientôt vingt-quatre, elle avait sa vie.
Et puis, brusquement : « Je voulais passer te voir. Si ça te va… Deux, trois jours, c’est tout. J’ai des vacances.
– Oui, oui, bien sûr, mais…
– Et pas de questions, papa, d’accord ? Pas d’interrogatoire. Sinon je rentre par le premier train. »
Il s’aperçut, une fois qu’elle eut raccroché, qu’il ne savait plus exactement où elle habitait.
Lorsqu’il avait proposé de venir la chercher à la gare en voiture, elle avait répondu que ce n’était pas la peine, elle prendrait le bus. Allongeant le pas, il arriva à temps pour distinguer la lumière des phares qui contournaient la colline ; à temps aussi pour la voir descendre et s’avancer vers lui – bottines, veste rembourrée, jean, sac à dos –, souriant, mais avec une hésitation dans les yeux.
« Kate… Je suis content que tu sois là. »
Quand elle tendit les bras pour saisir les siens, il s’efforça de ne pas regarder ses poignets bandés.
Il ouvrit la porte de la maison et s’effaça devant elle. Elle entra, tête baissée, en se débarrassant de son sac à dos et de sa veste dans un même mouvement.
« Pose tes affaires ici pour l’instant. Tu les monteras tout à l’heure. »
Katherine se pencha pour délacer ses bottines, puis les lui tendit afin qu’il les pose à côté de ses propres chaussures, sous le baromètre du vestibule.
« Tu veux un thé ? Un café ? Il y a du jus si tu préfères. Orange ou…
– Un thé, c’est très bien. Mais d’abord, il faut que je fasse pipi. »
Il lui indiqua les toilettes avant de passer dans la cuisine, remplit la bouilloire au robinet et l’alluma. Avait-elle changé ? Son visage, oui ; aminci, les pommettes plus saillantes, presque décharné. Et elle avait maigri. Du moins lui semblait-il. Difficile de l’affirmer. Grande comme sa mère, elle avait toujours été svelte, avec des membres fins et longs. La distance, c’est ce que tu devrais travailler, répétait son entraîneur d’athlétisme. Le 5 000 mètres, peut-être même le 10 000. Tu as le corps qu’il faut, laisse tomber le 400.
Lui non plus, elle ne l’avait pas écouté.
« J’ai pensé qu’on pourrait manger dehors ce soir, dit Elder. Plutôt qu’à la maison. Si ça te convient. »
Le salon était petit : un unique fauteuil, une table basse, une télévision, un canapé deux places. Katherine serrait son mug dans ses mains, elle avait les yeux cernés. À l’extérieur, il faisait presque noir. La nuit serait bientôt complètement tombée.
« Parfait. Il faut juste que je dorme une heure avant. J’ai un coup de barre.
– Mais tu es sûre de vouloir sortir ?
– Papa, j’ai dit que c’était parfait, d’accord ? »
Bon. Il n’y avait pas si longtemps, elle aurait répondu en levant les yeux au ciel.
Le pub se trouvait un peu plus loin sur la côte. Une construction basse et tout en longueur, le parking presque plein. Elder dénicha une table dans une pièce au fond, repoussée contre un mur.
« Soirée concert, expliqua-t-il en désignant du menton la porte de la grande salle. Ça attire du monde. On pourrait y aller tout à l’heure, pour écouter.
– C’est quel genre de musique ?
– Du jazz, je crois.
– Tu n’aimes pas ça, le jazz. »
Elder haussa les épaules et examina la carte. Merlu ; blanc de poulet nourri au grain ; tarte au fromage de chèvre ; langoustines frites ; romsteck de bœuf.
« Tu es toujours végétarienne ? »
Katherine lui répondit en commandant le bœuf. Elle portait toujours son jean étroit, mais avait passé un col roulé rouge à manches longues. Les poignets bandés apparaissaient seulement lorsqu’elle tendait les bras au-dessus de son assiette. Il n’avait toujours pas posé la question.
« Où habites-tu exactement, maintenant ?
– À Dalston. »
Elder hocha la tête. L’est de Londres. Il y avait vécu quelque temps, à ses débuts dans la Met1. Stoke Newington, district de Hackney. Le coin avait dû beaucoup changer.
« Dans un appartement, ou quoi?
– Oui, une coloc. Un ancien HLM. C’est bien. Mieux qu’une tour.
– Tu devrais me donner ton adresse.
– Je vais sans doute pas rester longtemps. »
Chaque fois que la porte de la grande salle s’ouvrait, la musique leur parvenait plus fort. Trompette et saxophone. Applaudissements. Une voix de femme.
« Tu travailles toujours au même endroit ? demanda Elder.
– Le centre sportif ?
– Oui. »
Katherine secoua la tête.
« J’ai été licenciée. Ça fait des siècles.
– Je ne savais pas. »
Elle haussa les épaules, les yeux sur son assiette.
« Mais tu t’en sors ? Avec le loyer et tout ?
– Ça va. Maman m’aide un peu.
– Ah bon ?
– Elle ne t’a pas dit ?
– Non. »
Si elle l’avait interrogé, il n’aurait pas su dire quand Joanne et lui s’étaient parlé pour la dernière fois. Aux alentours de l’anniversaire de Katherine, probablement, mais des mois avaient passé, et depuis… Il avait sa vie, si l’on pouvait appeler cela une vie, et elle avait la sienne.
Ils s’apprêtaient à commander le dessert lorsqu’une femme sortie de la grande salle s’arrêta à leur table et posa une main sur l’épaule d’Elder. Robe noire, escarpins, coiffure soignée.
« Frank. Je ne savais pas que tu étais là. »
Elder se leva à demi, l’air vaguement gêné. « Salut, Vicki. Je te présente ma fille, Katherine. Katherine… Vicki. Vicki est la chanteuse du groupe. »
Katherine fit un effort pour sourire.
« Kate passe quelques jours chez moi.
– C’est chouette. » Vicki recula d’un pas. « Tu vas venir écouter ? On attaque le deuxième set.
– Je ne voudrais pas rater ça. »
Quand il se rassit, Katherine grimaça un sourire dénué de toute ambiguïté.
« Qu’est-ce qu’il y a ? » grommela-t-il.
Elle rit.
Le groupe jouait « Bag’s Groove ». Trompettiste en solo, les yeux hermétiquement fermés, pendant que le saxophoniste l’écoutait en tenant à deux mains la culasse de son instrument. Piano, basse et batterie. Elder entraîna Katherine vers deux chaises inoccupées sur le côté de la scène.
À la fin du morceau, une fois les applaudissements retombés, le trompettiste se pencha vers le micro. « Mesdames et messieurs, la fierté de la péninsule de Penwith… Vicki Parsons. »
Sa voix était riche et profonde, rauque aux entournures. Elle ondulait en chantant, fermement campée sur ses pieds, une main sur le support du micro, laissant aller souplement son autre bras le long de son corps. « Honeysuckle Rose », lent et langoureux, en accentuant le balancement des hanches ; « Route 66 », dans une version enlevée ; « Can’t We be Friends », d’un air entendu et malicieux, avec un bref coup d’œil à Elder. Enfin, pour le rappel, elle livra un « Taint’ Nobody’s Business if I Do » aux doux accents de blues.
« Ben dis donc, dit Katherine quand le concert fut terminé. Tu dois pas t’ennuyer. »
La lune émergeait entre les nuages au-dessus de la colline de Zennor. Un oiseau s’agita dans les arbres au bout du chemin et quelque chose détala tout près dans le noir.
Katherine réprima un frisson. « Au moins, à Dalston, on voit venir son agresseur.
– Tu es en sécurité ici.
– Ah oui ?
– Oui. »
Il voulut tendre la main vers elle, mais déjà elle se dérobait. Inutile de lire dans ses yeux. Une des dures leçons qu’elle avait apprises, il le savait, c’était que la sécurité n’existait pas. Nulle part.
La maison leur parut froide en entrant.
« Tu veux quelque chose avant de monter ?
– Ça va, merci.
– Dors bien, alors.
– Toi aussi. » À mi-hauteur dans l’escalier, elle s’arrêta. « Si je n’avais pas été là, elle serait venue ?
– Qui ça, Vicki ?
– À moins que tu aies quelqu’un d’autre.
– Oui, peut-être. Pas forcément.
– Désolée si je suis un obstacle à tes amours.
– Absolument pas. »
Il fit du thé, s’assit pour regarder les nouvelles à la télé, avec le volume très bas. Ça avait commencé brusquement, comme souvent ces choses-là. Une soirée au pub après l’heure de la fermeture ; trop d’alcool et, dans le cas de Vicki, de l’herbe ; au bout d’une demi-heure, alors qu’elle l’avait frôlé à trois reprises en le croisant, il finit par comprendre le message. Dehors, ils passèrent maladroitement du mur sur le côté du pub aux sièges avant de la voiture de Vicki, puis au lit extra-large de son appartement à Marazion, avec la vue sur la plage à marée basse et le mont St. Michael le lendemain matin. Déjà – quoi ? – six mois, et Elder commençait à se demander si la flamme, le désir qui avait circulé entre eux, risquait de s’éteindre.
Ne pouvons-nous pas être amis2, oui, voilà.
Il s’éveilla avec un sursaut sur le canapé. Deux heures et demie, légèrement passées. Il éteignit la télé. Tourna la clé dans la porte de l’entrée.
Après avoir gravi l’escalier sans bruit, il hésita devant la porte de la deuxième chambre ; puis entrouvrit doucement le battant. Les rideaux n’étaient pas tirés. Katherine était couchée sur le côté, les doigts d’une main serrant une mèche de cheveux près de sa bouche. Un geste conservé depuis l’enfance. L’autre main avait remonté le drap sous son menton. Sa respiration était régulière, son épaule nue. Elder l’observa un moment, puis gagna sa propre chambre, se mit au lit et sombra, immédiatement, dans un profond sommeil.
1. Metropolitan Police Service : force territoriale de police responsable du Grand Londres. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
2. Allusion à la chanson mentionnée plus haut, « Can’t We be Friends » (Ne pouvons-nous pas être amis ?)
....................................................;
2
Il faisait beau le lendemain matin. Quand Elder revint de son jogging, Katherine était en train de préparer du café et des toasts.
« Tu cours combien ?
– Dix kilomètres, plus ou moins.
– Tous les jours ?
– Sauf le dimanche.
– Jour de repos.
– Quelque chose comme ça.
– C’est quand même pas mal, pour toi.
– Pour moi. Vu mon âge, tu veux dire. »
Katherine rit. « Quelque chose comme ça.
– Tu voudras peut-être m’accompagner, demain ?
– Peut-être.
– Je me disais que tout à l’heure, si le temps se maintient, on pourrait faire une promenade.
– Ce serait bien.
– D’accord. Laisse-moi prendre une douche rapide avant de mettre du pain à griller pour moi. »
*
Ils empruntèrent la route de Penzance, garèrent la voiture, puis grimpèrent le sentier en lacet qui longe le cercle mégalithique des Seven Maidens et le bâtiment en ruine abritant autrefois les machines à vapeur, au centre de l’ancienne mine de Ding Dong. En bas, la baie du mont St. Michael avec le cap Lizard tout au fond ; au-dessus, un ciel bleu parsemé de nuages et une buse en vol plané sur un courant d’air.
Elder sortit le thermos de café de son sac à dos et ils s’assirent sur les vestiges d’un muret en pierre, tournant le dos au vent. Quand Katherine tendit la main pour attraper le gobelet qu’il lui avait servi, les mots s’échappèrent de sa bouche avant qu’il n’ait le temps de les retenir.
« Kate, tes poignets…
– Papa…
– Mais je…
– Papa, je t’ai dit “pas de questions”, OK ?
– Je voudrais juste savoir ce qui s’est passé. »
Katherine renversa du café sur ses doigts en se levant brusquement et s’éloigna. Quinze mètres plus loin, elle s’arrêta, tête baissée.
« Kate… » Il la rejoignit et posa doucement une main sur son bras. Elle s’en débarrassa d’un haussement d’épaules.
« Pas de questions, c’est ce que j’ai dit. Et tu étais d’accord.
– Je sais, mais…
– Mais quoi ? » Face à lui, maintenant.
« Je n’avais pas… Tu ne peux pas m’interdire de demander.
– Ah non ? »
Elder secoua la tête et soupira.
« Je me suis coupé les poignets, OK ? C’était un accident.
– Un accident ?
– Oui.
– Mais comment diable… ?
– Peu importe. »
Elle soutint son regard, le mettant au défi de protester. Il se rappelait ce visage buté, au jardin public, lorsqu’elle avait quatre ou cinq ans et qu’il lui annonçait que c’était l’heure de rentrer : l’heure de ranger sa chambre, d’arrêter de lire, d’écrire, de se préparer à se coucher.
« Je ne veux pas me coucher.
– Pourquoi ?
– Parce que je fais des rêves. Des cauchemars. »
Des cauchemars encore pires à présent, il n’en doutait pas. Il retourna s’asseoir, et, au bout d’un moment, elle reprit place à ses côtés. Non loin, un tracteur démarra et apparut bientôt, labourant l’un des champs dans la pente au nord, vers St Just, une nuée de mouettes dans son sillage.
« Je croyais que les choses s’étaient un peu arrangées.
– Arrangées ?
– Tu me comprends.
– Ah bon, je te comprends ?
– Je me disais qu’après la thérapie et tout… »
Elle rit. « La thérapie ?
– Oui. Je pensais que ça allait bien. Que tu avais réussi à dépasser…
– Quoi ? Genre, à oublier ? Tu crois que c’est possible ? On voit un psy et ça passe ?
– Non, mais…
– Mais quoi ?
– Je ne sais pas.
– Non, tu sais rien. Ni sur moi ni sur rien du tout. Tu te planques ici et tu t’en tapes ! »
Debout de nouveau, elle repartit à grands pas entre les bruyères. Elder se leva pesamment et la suivit, en gardant une distance prudente.
Le soir, la paix étant restaurée, ils allèrent au cinéma à Newlyn, au Filmhouse. Ils mangèrent un fish and chips, penchés sur le parapet devant le port. Katherine avait changé ses bandages, tandis que les questions non posées continuaient à tourner sans répit. Un accident ? Les deux bras ? Automutilation, ou geste potentiellement plus grave, définitif ? Si elle veut m’en parler, songeait Elder en essayant de se convaincre, elle le fera.
Durant le trajet de retour, détendue, Katherine parla du film qu’ils venaient de voir ; d’amies et de colocataires – Abike, qui était enseignante stagiaire dans une école primaire du quartier ; Stelina, qui se partageait entre ses études et son travail de secrétaire à l’hôpital de Mile End ; Chrissy, qui travaillait dans un bar et posait pour des artistes. À la maison, quand Elder sortit une bouteille de whisky, Katherine refusa d’un signe de tête et fit du thé. Il était tard lorsque, la fatigue prenant le dessus, ils montèrent se coucher.
Elder dormit d’un sommeil agité, entrecoupé de rêves familiers. Une cabane de pêcheur en planches grossières et bâches de plastique maintenues par des cordes et des clous. Le clapotis de l’eau. Des algues.
Des cendres. Les restes d’un feu plus loin sur la plage. La carcasse d’une mouette entièrement dévorée. Il forçait la porte, le bois vermoulu cédait sous sa poussée et il trébuchait dans le noir.
Un hurlement déchirant l’éveilla et il fut aussitôt en alerte.
Un hurlement provenant de la pièce à côté.
Katherine était assise dans son lit, les yeux écarquillés, fixés sur la fenêtre ouverte, tremblant de tout son corps. Lorsqu’il la toucha doucement, elle se mit à gémir et releva les genoux contre sa poitrine. Ses yeux dilatés papillotèrent, puis se fermèrent.
« Tout va bien, Kate, dit-il en l’aidant à se rallonger. Ce n’est qu’un rêve. »
Les rêves de sa fille, les siens à lui : une des choses qu’ils avaient en commun.
À seize ans, Katherine avait été enlevée par un homme nommé Adam Keach, emmenée dans une camionnette jusqu’à un endroit isolé sur la côte nord du Yorkshire, une cabane délabrée où elle avait été séquestrée, torturée, et violée. C’était Elder qui l’avait trouvée, nue, avec des hématomes sanguinolents sur les bras et les jambes, des traces de coups sur les épaules et le dos.
Il se pencha pour lui embrasser les cheveux, comme il l’avait fait alors.
Garda un moment sa main dans la sienne et la quitta, endormie.
Le lendemain matin, elle était partie.
................................;
3
Malgré ses efforts pour les chasser, les paroles de Katherine continuaient à le tourmenter. Tu te planques ici et tu t’en tapes ! Il y avait là une certaine vérité, se disait-il, plus qu’il n’aurait voulu l’admettre. Et, comme la plupart des vérités, celle-ci était prise dans des circonstances et des événements sur lesquels, à l’époque, il lui avait semblé n’exercer aucun contrôle.
Si seulement il était resté à Londres, rien de tout ça ne serait arrivé. Tout ça. Les dix dernières années.
Imploré par Joanne – c’est une occasion en or, Frank, une chance que je ne peux pas laisser passer ; la direction d’un des salons de coiffure de l’ambitieux Martyn Miles, une percée inespérée dans l’empire de la beauté et de la mode –, il avait demandé à contrecœur son transfert dans le Nord et abandonné son poste de sergent à la Met. Même pas le Nord à proprement parler : Nottingham, les Midlands de l’Est ; la Brigade criminelle, au grade d’inspecteur. La promotion, enfin. Ils avaient entraîné malgré elle leur fille de quatorze ans ravagée par les hormones.
Combien de temps avait-il fallu pour que Katherine décroche de l’école, après une succession d’ultimes avertissements et de renvois temporaires ? ; pour qu’Elder, frustré par des comportements dans lesquels il voyait une inefficacité et une maladresse typiquement provinciales, élève la voix une fois de trop contre ses supérieurs ? ; et pour que Joanne, avec une grâce et un empressement dont l’issue était courue d’avance, tombe dans les bras de Martyn Miles, self-made-multimillionnaire, élu Homme d’affaires de l’année par les Midlands ?
Face à une probable mise à pied disciplinaire, à l’infidélité criante de sa femme, et à une adolescente qu’il avait l’impression de ne plus reconnaître, sans parler de la comprendre, Elder avait réagi en adulte sensé. Piqué une grosse colère. Donné sa démission. Lesté de maigres économies personnelles et d’une retraite à taux minoré, il s’était enfui aussi loin que possible sans quitter complètement le pays. Sa course l’avait mené au fin fond des Cornouailles, à l’extrême sud-ouest, presque assez près de la pointe de Land’s End pour respirer le sel de l’Atlantique et sentir les embruns. À part quelques excursions exceptionnelles, il n’en avait plus bougé.
Des petits boulots, un chantier çà et là, un coup de main au moment de la moisson, la cueillette des jonquilles au printemps où il se brisait le dos aux côtés de journaliers venus d’Europe de l’Est. Récemment, et, l’âge venant, moins résistant, il s’était lié d’amitié – autour d’une pinte ou deux, un single malt de temps à autre – avec un inspecteur du coin, Trevor Cordon ; et depuis deux ans, en tant que civil attaché à la Force d’intervention en cas d’incidents majeurs du Devon et des Cornouailles, il apportait sa contribution à quelques enquêtes criminelles de la police. ...
.............................................................................................................................................................
BIO;
Né à : Londres , le 21/12/1938
John Harvey est un écrivain et scénariste britannique, spécialisé dans le roman policier.
Après avoir été enseignant de théâtre et de lettres dans un établissement du secondaire de 1963 à 1974, il démissionne et commence à écrire dès 1975.
Il obtient un master de l’Université de Nottingham en 1979 et y devient enseignant à temps partiel jusqu'en 1986. Après cette date, il se consacre entièrement à l'écriture, bien qu'il fonde et dirige, de 1977 à 1999, la petite maison d'édition Slow Dancer Press, spécialisée dans la poésie.
Boulimique de l’écriture, il publie à partir des années 1980, plus de 90 romans, des recueils de poésie, des romans pour la jeunesse et bon nombre d'adaptations pour la radio ou la télévision.
Après avoir commencé sa carrière d’écrivain en publiant dans des pulps (des policiers et beaucoup de westerns), il écrit en 1989 un roman mettant en scène un policier d’origine polonaise du commissariat de Nottingham du nom de Charles Resnick. C’est le début de la célébrité.
John Harvey a aussi écrit une autre série policière de trois romans consacrée à Frank Elder, inspecteur principal en retraite après 30 ans de service au commissariat de Nottingham.
Également scénariste, il a rédigé plusieurs scénarios de téléfilms et deux séries télévisées, dont "Hard Case" (1987-1988).
Pendant sa carrière d'écrivain, pour écouler son abondante production, il utilise divers pseudonymes : John McLaglen, William S. Brady, J.-D. Sandon, L.-J. Coburn, J.-B. Dancer, W.-M. James, Thom Ryder, Jon Hart, Jon Barton, James Mann, Terry Lennox, John B. Harvey, Thom Ryder, John Barton.
Il reçoit le Diamond Dagger Award en 2007 pour l'ensemble de son œuvre.
La fureur des mal-aimés.
RÉSUMÉ
Paris, veille de Noël, de nos jours. Comme tous les soirs ou presque, le commissaire Amaury Marsac va s’asseoir sur un banc dans le square du Vert-Galant, sa soupape pour chasser les horreurs du métier avant de rentrer chez lui. Mais cette nuit-là, son refuge a été gagné par le Mal : dans une poubelle du jardin public gît un cadavre au ventre ouvert, rempli de mort-aux-rats.
Paris, mars 1995. Alex a 15 ans, il a fui l’appartement familial et est à la rue. Mais il résiste au désespoir, car dès que possible il va partir, il va la retrouver, il n’y a qu’Elle qui compte désormais dans sa vie. Et ensemble, ils surmonteront tout.
Lorsque les chemins de Marsac et d’Alex convergent, chacun se méprend en pensant avoir connu le pire…
Une bouleversante variation sur les enfances brisées, mais aussi la puissance de la fraternité et la beauté cruelle de la vengeance.
........................................................................................................................................................................
« … la couleur des sangs mêlés. »
1er décembre 20**, arrière-pays niçois
Sur les flancs de la colline, au-delà de la poussière de sable, le soleil infusait au travers des persiennes et se déversait dans la mer azurée. Son regard délaissa l’écran d’ordinateur pour embrasser l’horizon. Ainsi, ce salaud s’apprêtait à s’envoler début d’année prochaine pour un mois au Brésil afin d’inaugurer sa mascarade de centre de formation pour jeunes déshérités, le point d’orgue de sa fulgurante carrière. Inenvisageable. Aucune fortune ne pouvait racheter un passé. Il fallait agir. Le Mal n’avait que trop duré.
Tu ne tueras point.
Mais si. Il le faut.
Sa main se crispa autour de son verre jusqu’à le briser, sa paume ensanglantée se superposa au soleil agonisant et, sur les flancs de la colline, au-delà de la poussière de sable, le chant du crépuscule s’empreignit de la couleur des sangs mêlés.
...........................................
« … une voix qui charriait dans son sillage le tumulte de mille torrents. »
Nuit du 23 au 24 décembre 20**, Paris, quai de la Rapée, IML, 12e arrondissement
Infanticide, Amaury. Rebecca Keller, légiste à l’Institut médico-légal de Paris, dénoua sa calotte et releva sur Marsac ses beaux yeux gris usés de concentration. Il acquiesça d’un signe de tête, ébouriffa ses cheveux d’une main lasse, se détourna du corps de l’enfant et posa la seule question valable, sans grand espoir de démenti. Rebecca avait pour elle quinze ans de pratique. Elle était la meilleure.
— Tu es sûre ?
Elle confirma et Marsac la remercia, enfonçant les poings dans ses poches. Il aurait tant aimé croire à l’innocence clamée par la jeune mère de ce nourrisson sans vie. Comment avait-elle pu ? Il quitta la salle, le bâtiment, et se laissa happer avec soulagement par le froid extérieur. Rebecca le rattrapa en courant au bout de la rue alors qu’il se retenait de boxer un mur.
— Dans cinq minutes, j’en ai fini pour ce soir. Tu m’attends et on prend un verre ?
— Je suis mort. Pas toi ?
Elle ébaucha un sourire.
— Pas encore.
— Il faut que j’y aille, Rebecca, je dors debout, désolé. Une autre fois, promis.
Il lui adressa un clin d’œil et disparut, tendu. Les Ides, comme il les appelait, suffixes de l’horreur, homicide, matricide, féminicide, parricide, etc., lui collaient de plus en plus à la peau. Et cette nuit avait été infanticide. On ne s’y résignait pas, personne.
De retour au vestiaire de l’IML, Rebecca Keller se changea sans hâte, pensant à la vie qu’elle s’était choisie dès la première année de ses études, la médecine légale ; une plongée en apnée dans les entrailles de l’humanité, en quête de l’ultime vérité. Elle ne regrettait jamais son choix, inutile de lutter contre une vocation, mais les corps d’enfants nus sur sa table en inox restaient pour elle aussi un déchirement innommable. Face au miroir, elle se dévisagea avant de se détourner de son reflet. Elle n’en voulait nullement à Marsac, ils se connaissaient trop bien pour qu’elle nourrisse à son égard un quelconque ressentiment. L’épuisement le guettait, mais elle, cette nuit, elle voulait vivre, encaisser les coups et rebondir.
Dehors, Marsac alluma une cigarette, mordilla la cicatrice qui effleurait sa lèvre supérieure et laissa décroître sa colère, éreinté. Combien de jours sans vraies nuits ? Trop. Il aurait dû rentrer chez lui, se glisser sous une douche interminable puis entre des draps frais et s’abandonner au luxe de ne plus penser, mais il savait déjà qu’il n’en ferait rien en dépit de ce qu’il avait prétendu à Rebecca. Personne ne l’attendait et il prit le chemin du square du Vert-Galant, comme un soir sur deux, parcourant la distance qui le séparait de son havre de paix en pilotage automatique. Tout juste eut-il le sentiment d’avoir frôlé
quelqu’un, quelque part, vers l’entrée, avant d’en pousser le portillon. Assis sur un banc bordé d’arbres efflanqués, face à la Seine qui lui offrait un spectacle dont il ne se lassait jamais, il étira ses jambes et délia sa nuque. Évacuer les tensions, retrouver un brin d’oxygène, chasser de son esprit les Ides, reflets du monde tel qu’il était, sans limites de barbarie. Il crut y parvenir, lorsqu’une voix surgit de nulle part, une voix qui charriait dans son sillage le tumulte de mille torrents.
— Sage, Friedrich
................................................,
« Mais tu sais pas qu’ici c’est le dernier arrêt avant de crever ? »
12 mars 1995, Paris, gare de Lyon, 12e arrondissement, 17 heures
Transi, figé en tailleur tête baissée sur le bitume, Alex hésite à les suivre. Son corps est meurtrissure, ses mains ont pris la couleur du plâtre vieilli, ses jambes ne répondent plus, se dérobent. Mais ces flics de la brigade d’assistance aux personnes sans abri, la BAPSA, ne renoncent pas, en voilà un qui revient café crème à la main et sourire aux lèvres tandis que l’autre n’en finit pas de lui détailler les avantages du centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans abri, alors Alex avale le café et capitule. OK, cette nuit il dormira au CHAPSA de Nanterre, ça lui laissera le temps de penser à la suite, au chaud, le ventre plein, loin de ceux qui doivent le rechercher. Arrivé devant le car dont le moteur ronronne déjà, Alex risque un coup d’œil. Des corps informes sur des visages hors d’âge, auxquels s’ajoute un vacarme étourdissant qui lui rappelle celui des cours de récréation, les jours pluvieux d’hiver. Son sac à dos serré entre ses bras, il recule, mais le binôme d’uniformes le pousse doucement en avant. Ce jeune les bouleverse. Secoué de frissons, respiration hachée, il frôle l’hypothermie. Monte, fais-nous confiance. Il va geler ce soir. Météo-France annonce des températures négatives, jusqu’à moins six. Tu seras mieux là-bas. Alex s’engouffre dans l’habitacle et leur offre un regard dont ils se souviendront longtemps. Un champ de mines, une immensité dévastée. Les portes se ferment en un chuintement plaintif et les flics lui envoient un dernier signe, pouces levés, qu’Alex ignore. Le chef de car qui relève les identités, visage tiré de lassitude, le presse déjà, carnet sorti et stylo dressé.
— Tu as tes papiers ?
— Non.
Alex, une main repliée dans sa poche sur sa carte d’identité, prie pour qu’il n’y ait pas d’accroc et fronce les sourcils dans l’espoir de se vieillir.
— Comment tu t’appelles ?
— Surri. Alex.
— Un ou deux r ?
— Deux.
— Date de naissance ?
— 12 mars 1976.
— C’est bon, tu peux t’asseoir. Et joyeux anniversaire.
Sans autre formalité, l’homme prend place à côté du chauffeur. On est au complet, c’est bon. Le bus démarre et Alex gagne la seule place vacante, au fond à droite, contre une vitre poisseuse. Recroquevillé sur son siège, essayant d’occulter cette puanteur exacerbée par le chauffage poussé au maximum qui lui donne la nausée, il se rêve phasme mais se découvre la cible de toutes les attentions. Hé, les gars, un nouveau !
Dans les rires gras des passagers, sa migraine prend son envol, emmenée par les fourmis guerrières mangeuses d’hommes, les Dorylus, qui tailladent son crâne de leurs cris surpuissants, Marabunta, Marabunta. Ces légionnaires aveugles, rapides et sans pitié, dont les morsures s’avèrent si douloureuses que l’évanouissement le guette à chacune de leurs apparitions, sont depuis des temps immémoriaux ses plus fidèles ennemies. Et elles réapparaissent, et il s’astreint à ne pas se fracasser la tête contre un carreau afin de ne pas passer pour un fou. Calme-toi, se répète-t-il, contrôle-toi et elles vont refluer. Autour de lui, le brouhaha enfle. Reste zen, se dit Alex, n’affiche pas tes faiblesses ou ces types ne te lâcheront plus. Fonds-toi dans la masse.
Le vacarme devient insupportable. Chauffeur et chef de car intiment l’ordre, sans se retourner, de la boucler. Alex cale son front puis ses paumes contre la vitre embuée et se demande dans quel monde il s’est jeté.
Les kilomètres défilent, un calme relatif s’installe. On s’apostrophe un peu moins, on somnole dans la moiteur. Alex ravale sa peur, se persuade qu’il a assuré. S’inventer une nouvelle identité, Alex Surri, ça lui est venu d’un coup, au hasard. Se prétendre majeur aussi. C’étaient les idées à avoir et il les a eues, au bon moment. Il va réussir, atteindre son objectif. Il fera tout pour.
Autour de lui, la meute est toujours assoupie, mais sa migraine le ronge et le ravage.
Une pluie fine et molle tombe sur Paris.
L’arrivée au CHAPSA annoncée, Alex saisit son sac, enjambe son voisin et se plante devant une porte. Te presse pas mon gars ! hurle derrière lui une voix éraillée. L’enfer t’attendra ! Mais tu sais pas qu’ici c’est le dernier arrêt avant de crever ?
Pendant ce temps, place Louis-Armand, gare de Lyon, les flics de la BAPSA restent un moment immobiles. Chaque fois, un véritable coup de poker se joue avec leurs interlocuteurs et ils sont satisfaits d’avoir eu raison de l’obstination de ce môme qui pourrait être leur fils, mais comment, entre eux, feindre d’ignorer que le CHAPSA recèle d’autres pièges que le froid ? Ils se prennent à espérer que la nuit sera sans pièges. Convaincus qu’ils n’oublieront pas de sitôt ce visage entraperçu, qui avait la pâleur des statues et le sérieux de ceux qui ont trop tôt quitté l’enfance, ils enchaînent les plaisanteries, soudainement conscients que les adultes se retrouvent parfois à raconter aux enfants des histoires, juste pour avoir l’air de savoir ce qui était bien.
...................................................,
« La lune se reflétait en cercle dans la Seine. »
24 décembre 20**, Paris, square du Vert-Galant, 1er arrondissement, 3 heures du matin
— Sage, Friedrich, reprit la voix dans son dos.
Marsac se retourna. Un homme approchait et s’asseyait sur le banc. Bonnet bleu, parka noire, pantalon en velours, sans doute marron autrefois, rangers. Un visage abîmé rongé par une barbe en liberté, des yeux bruns cernés de profondes rigoles qui s’étendaient loin jusqu’aux tempes, une cachexie évidente sous sa veste. Il caressait un minuscule berger allemand blotti entre ses bras, qui le fixait, museau humide et oreilles dressées. Friedrich.
Marsac fouilla ses poches remplies de ses habituelles inutilités et trouva un peu de monnaie.
— Tenez. C’est tout ce que j’ai.
L’homme au bonnet bleu scruta ce type qui lui faisait l’aumône, la cicatrice pâle sur sa lèvre supérieure, ses cheveux noirs en bataille, et empocha les pièces sans un mot. De son côté, Marsac le dévisageait aussi et se disait qu’il était incapable de lui donner un âge : l’errance bousillait à vitesse démoniaque. Une fraction de seconde, il le vit reposant sur la table en inox de Keller. L’homme suivit son regard, maintenant posé sur le tatouage de sa main gauche. Un cœur pourpre percé d’une flèche. Son talisman contre les salauds. Et sa voix rocailleuse boursoufla une nouvelle fois dans la nuit, torrent roulant des eaux jaunâtres et boueuses.
— Qu’est-ce que tu fous ici ?
— Les flics, ça dort peu.
L’homme, secoué par une interminable quinte de toux qui dessinait des ombres craintives autour de sa gorge, comme si elle s’apprêtait à éclater, abaissa son bonnet de laine sur son front. Décidément, c’était sa nuit. Il aurait dû se tirer dès l’approche de ce type.
— Ça va ? s’enquit Marsac.
Mais le sans-abri ne le calculait plus, concentré à tenter de ne pas reluquer une poubelle, ouverte, à quelques enjambées. Un container que Marsac aurait juré ne jamais avoir vu auparavant et d’ailleurs pas à sa place, l’emplacement des déchets étant à l’extérieur de l’enceinte de ce square. Deux décennies au sein de la police lui ayant appris que rien n’apparaît jamais au hasard dans une vie, il se leva pour s’en approcher.
L’homme lâcha sa bouteille au sol.
La lune se reflétait en cercle dans la Seine.
— Nom de Dieu ! s’exclama Marsac.
L’Ide était revenu.
................................................................................................................................................................
BIO:
Elsa Roch est psychologue spécialisée dans les troubles autistiques, l’adolescence et les addictions.
Elle écrit depuis son enfance, de la poésie d’abord. À l’adolescence, une rencontre change sa vie, celle de Salomé, 3 ans, une petite fille autiste dont elle s’occupe pendant tout son temps libre. C’est-ainsi que naît sa première vocation, et qu’elle devient psy, avec pour spécialisation les troubles autistiques, ceux de l’adolescence, et les addictions.
En parallèle, elle écrit des polars pour explorer une à une les failles de l’être humain.
"Ce qui se dit la nuit" (2017) est son premier roman.
Avec "Oublier nos promesses" (2018) son deuxième roman elle remporte le Prix Polar INFINIMENT QUIBERON 2018 et le Prix des lecteurs BLOODY FLEURY 2019.
Prix Plume de bronze Du Thriller Francophone 2019. (Plume-Libre).
Feu.
RÉSUMÉ
Laure, prof d’université, est mariée, mère de deux filles et propriétaire d’un pavillon. À 40 ans, il lui semble être la somme, non pas de ses désirs, mais de l’effort et du compromis.
Clément, célibataire, 50 ans, s’ennuie dans la finance, au sommet d’une tour vitrée, lassé de la vue qu’elle offre autant que de YouPorn.
Laure envie, quand elle devrait s’en inquiéter, l’incandescence et la rage militante qui habitent sa fille aînée, Véra.
Clément n’envie personne, sinon son chien.
De la vie, elle attend la surprise. Il attend qu’elle finisse.
Ils vont être l’un pour l’autre un choc nécessaire.
Saisis par la passion et ses menaces, ils tentent de se débarrasser l'un de l'autre en assouvissant le désir… Convaincus qu’il se dompte.
......................................................................................................................................................................
Tu t’étonnes de ces mains de fille nouées par erreur au corps d’un homme. Doigts frêles, attaches poncées, phalanges adoucies, et sous la peau trop fine pour en masquer la couleur, les veines sont enflées. La droite s’agitant au-dessus des olives et du pain, tu vois remuer un muscle vulnérable, d’enfant, qui bientôt tremble quand il soulève la carafe. Tout ceci est très fragile et pourrait se briser dans un geste un peu vif. Tu penses qu’il serait incapable de t’étrangler. Tu notes les ongles limés court, l’annulaire sans alliance ni trace de, les extrémités blanches, exsangues, et presque mauves. Chez lui le retour du sang au cœur se fait mal et par à-coups. Entre la malléole et le drap sombre du costume, tranchent deux centimètres de coton épais, immaculé. Tu supposes une chemise étroite lavée une fois, portée deux. Maximum.
Tu voudrais soudain voir le reste sous la laine froide.
Alors regarde ailleurs, s’affole ta mère dans la tombe, depuis les femmes correctes et aliénées.
Tu devines une chair présente mais terminée, attendrie par autre chose que l’amour, mais quoi. Les coups, le confort ou l’alcool, ça dépend des mœurs. Ton regard parvient à se hisser plus haut, allant de sa main à son coude, puis de son col à ses lèvres. De la tristesse tatouée à la verticale sur sa bouche, tu cherches malgré toi l’origine. Une fille, un mort ou la fatigue d’être soi, ça dépend des vies. Pour la peau brunie des tempes et des arêtes, tu l’imagines courir comme tout le monde sur les rives de Seine. Pour le crâne rasé à fleur d’os, tu cherches encore.
Demande-lui, suggère la mère de ta mère du paradis des femmes de somme, franches du collier.
Demander qui, quelle douleur, quel impact vous ont fait cette viande émue, cette gueule comme le reflet brisé d’un visage antérieur, ces mains pessimistes, c’est délicat. Tu ne le connais pas. Tu es censée rencontrer en lui un intervenant pour un colloque d’histoire contemporaine, pas un paysage, tu dois obtenir sa participation. Pas son histoire.
Sa voix qui semble apprise quelque part où l’on apprend à attaquer les consonnes, à conquérir des publics en salle, n’a rien à voir avec le reste. Il répète une phrase que tu n’écoutais pas, il va penser qu’il t’ennuie alors qu’il t’embarque. Il demande pourquoi lui. Pourquoi un banquier pour intervenir lors d’un sommet de sciences humaines, pourquoi parmi les chercheurs, les linguistes et les auteurs, inviter l’engeance qu’il sait représenter.
Tu dis pour le contraste. Il dit qu’il est ton homme. Personne mieux que lui n’excelle à n’être pas à sa place.
Puis il se tait, semble une seconde ailleurs, son visage en amande s’offrant sans vigilance à l’attention. À nouveau, tu peux voir remonter du fond quelque chose de faible et d’abîmé, comme un morceau d’épave. Tu voudrais savoir quel bateau. Tu le trouves beau alors qu’en arrivant, il était vide, les traits modestes.
Ferme la bouche et travaille, s’énerve ta mère depuis la fosse aux impayées, aux femmes utiles et rigoureuses.
Tu chausses ta paire de lunettes sans correction, pur accessoire à verres blancs utile à masquer, selon les circonstances, tes cernes ou le songe qui te traverse. Tu dis merci. Merci à la chaîne de recommandations dont la source s’est perdue mais qui t’a menée jusqu’à lui, après différentes bouteilles à la mer, messageries saturées ou refus catégoriques. Curieusement une prestation gratuite au cours d’un colloque non médiatisé dans une université sans prestige n’excite plus grand monde.
Ironise c’est mieux, valide maman sous son granit, au moins on sait pourquoi on t’a payé des études.
Et puis tu lui sais gré de cette heure à midi dès lors que vous pouviez administrer ce rendez-vous préalable par téléphone.
Le garçon de salle demande si vous avez choisi et toujours pas.
Ton commensal remercie lui le hasard et personne d’autre. Quant à téléphoner, le moins possible. Depuis que voir les gens entraîne quantité de risques sanitaires, il en abuse, multipliant ainsi ses chances que lui arrive enfin quelque chose. Il le dit comme ça. Tu penses aujourd’hui le risque c’est moi et comme ça t’irrite, que ça t’intéresse, tu t’empresses d’être chiante, de détailler l’enjeu de ces rencontres disciplinaires, deux jours à Cerisy en décembre pour qualifier l’époque, la nôtre, celle qu’on n’appelle pas encore ou qu’on appelle la crise, mais tu n’as pas le temps de finir que déjà il balance, l’époque est un scandale.
Des enfants dit-il naissent à l’instant avec 40 000 euros de dette par tête puisque leurs grands-parents ont financé leurs vies de merde à crédit. Un pavillon, une Peugeot, deux, un téléviseur par chambre, les porte-avions, l’armée française en Afghanistan et désormais le pompon, la vie éternelle. Le scandale c’est la facture, l’époque est une facture mais peu importe le nom qu’on lui donne, nos enfants ne voudront pas rembourser, ils débrancheront pour en finir les respirateurs dans les hôpitaux. Alors il n’y aura plus d’époque mais la guerre, voulez-vous que l’on commande un truc à boire, un apéritif.
Tu demandes s’il en a, des enfants.
Il répond un chien, un seul.
Arrête ça, Laure, se fatigue ta mère qui sous la terre voit tout, contempler ce con comme s’il s’agissait de le peindre et regarde les choses comme elles sont.
Dans un restaurant crâneur, conçu comme une serre, progressent des clématites vers un plafond vitré. Un homme blanc dans un costume a priori Lanvin te raconte le désastre en mangeant, s’écoutant prédire la violence des combats qui l’épargneront. Tu portes du bleu marine car il s’agit cette année du nouveau noir, il en porte lui depuis toujours. Voilà t’es contente.
Le serveur demande si vous avez choisi et cette fois il insiste.
Tu cherches le menu, il est devant toi. Un grand miroir piqué où sont tracés au feutre, les entrées, les plats et les fromages. Reflétés entre la sole à 38 euros et les champignons crus, tu surprends ton brushing d’avant-hier, ta main laissée en coquille sur ton oreille, tes pupilles légèrement dilatées, ton sourire de Joconde dont l’étude te surprend. Il commande la sole, toi le tartare.
En mastiquant du pain, tu parviens à mater ton rictus incorrect. Tu remarques à voix haute la ridicule brièveté de la carte, la nullité des portions sur les tables. Évidemment dès lors que l’abondance est un rêve de pauvres, qu’avoir le choix n’est profitable qu’à ceux qui n’ont pas de goût. En attendant, 20 grammes de poisson décongelé à 40 euros, si l’époque est un scandale, en effet c’est ici. Tu parles exprès la bouche pleine, depuis les acharnés, ceux qui comptent vraiment et pas en dollars. Qu’on en finisse.
Il recule sa chaise, machinal, densifiant l’écart que tu suggères entre vous, ça t’apprendra. Il reprend, parle comme toi tu manges, sans respirer. Ce matin dit-il les marchés ont parié à la baisse sur toutes les valeurs, un signal connu pour précéder le pire. À quelle échéance et sous quelle forme, on l’ignore évidemment, on attend, d’où cet intenable suspense qui fait de toutes les époques un délai. Il pourrait tout aussi bien déclarer le contraire, ce serait tout aussi vrai, et tout aussi vain. Car il n’y a plus d’époque, mais des versions, des récits. Et de conclure qu’il est prêt pour ton machin universitaire. Le scandale, la facture, le délai, les versions, quatre parties c’est bien, Laure qu’en pensez-vous.
Tu penses poncifs, slogans. Tu penses qu’entre un restaurant et un colloque il existe cet écart qu’on appelle la réflexion, mais tu dis formidable. Tu voudrais à ton tour faire rebondir sur la table des formules géniales et bâclées mais rien ne se forme dans ton esprit, qu’un dessin. Si tu devais peindre cet homme ce serait à l’huile sur bois, à la manière des florentins quand on voit sur les visages martyrs se livrer en dedans le combat de l’ange et de la chair. Ce serait comme ça.
N’importe quoi, s’impatiente ta mère fantôme. Comme si tu savais tenir un pinceau, faire quelque chose de tes dix doigts.
La porte du restaurant s’ouvre, vous rafraîchit et se referme, à mesure que sortent par deux ou trois les cadres du tertiaire ayant laissé des notes de frais à 60 euros par couvert. Vous avez terminé. Tu ne sais pas quel goût avait ton plat, tu n’as pas fait attention. Soudain il rapproche sa chaise, repousse son assiette, éloigne l’une de l’autre ses mains obsédantes et toi tu comprends. Dans l’inculte langage du corps, il vient vers toi.
Ça ou une crampe, soupire ta mère bien profond.
Tu commandes un café, lui aussi. Il pose ses coudes sur la table, ses mains mourantes se rejoignent pour s’attacher l’une à l’autre. Tu voudrais les prendre mais tu sais d’expérience qu’en saisissant les oiseaux souvent on les tue.
Mais fous-moi le camp, s’époumone maman de sous la dalle, depuis les femmes éteintes mais renseignées.
Tu rassembles d’un coup tes effets. Un crayon, tes lunettes de frimeuse, ton téléphone, lequel indique huit appels en absence en provenance du lycée de ta fille, rien de très étonnant. Tu te lèves, déployant vers le plafond de verre ton mètre soixante-treize qui paraît le surprendre. Arrivé en retard, il ne t’a vue qu’assise. Tu dis je dois partir, tu attends une seconde qu’il se lève, selon l’usage, à ta suite. Il ne bouge pas.
Le goujat, regrette la mère de ta mère au paradis des premières fans du prince Philip.
Il te regarde sans rien dire, comme étonné. S’ouvre alors un silence où tu pourrais entrer et rester tout l’après-midi à boire du café, poser des questions indécentes, apprendre la peinture sur bois.
Alors tu rappelles comme tes troupes autour de toi, ton diplôme et ta chaire avec un e de maîtresse de conférences. Tu dis pardon, j’ai vraiment du travail.
Pourquoi vraiment, pourquoi pardon, relève ta mère de la terre plein les dents. T’as du travail, point.
Le secrétariat du laboratoire le contactera, tu es désolée, dans une heure tu dois disparaître, il dit quoi ? Tu dis lapsus. Dispenser, pas disparaître. Dispenser un cours à l’université, un cours chaque année plus documenté. Histoire de la peur en Europe.
– Et vous ? dit-il.
– Moi quoi ?
Et toi est-ce que tu as peur, tu sais bien.
En quittant la table, tu fais tomber ta veste, on ne comprend pas ce que tu dis quand tu prononces merci, tu es d’une littérale fragilité qu’il pourra imputer à ce qu’il veut, tu t’en vas et bientôt sous la ville, le RER B t’emporte.
Époque, nom féminin, du grec epokhê, arrêt.
................................................................................,
2 juin, 14 : 30, TC 37,5°,
FR 15/min, FC 80/min, TA 15
La Défense, dis-je en m’engouffrant dans le G7, tour Nord, côté Puteaux et vite tant que c’est encore debout, prenez par la D9, on m’attend. Puis j’interpelle maladivement mon téléphone, comment ça va Carrie ? et aussitôt s’illumine l’application Care, dans ces apaisants tons rose pâle mais pas cochon, plutôt infirmière en pédiatrie. Pour qu’elle affiche les constantes, on lui dit comment ça va aujourd’hui Carrie et hop. Oui c’est un peu dégradant, mais bon, on en fait d’autres. Température du corps 37,5, évidemment on étouffait dans cette orangerie, tension artérielle à 15, pas étonnant non plus, je suis vidé. J’ai parlé pour quinze jours. Fréquence cardiaque à 80. C’est tout ? C’est marrant. J’aurais juré qu’elle m’avait fait monter facile à 90 avec ses lèvres sans rien dessus, à dévorer du steak comme sur la bête. Ou c’est l’appli qui déconne. C’est possible, c’est chinois. 14 h 45. Elle m’a oublié depuis au moins vingt minutes. J’ai tout fait pour ne pas être marquant, c’est mon genre, plus délébile tu meurs. Au début elle s’intéressait surtout à la décoration, à la fin elle bâillait, cramée d’ennui, entre les deux elle regardait la porte avec des yeux de taularde, et ma carte de visite, elle l’a prise sans regarder pour brosser la nappe. Une carte comme ça, biseautée, de 120 grammes qui commence par Head of, recyclée en ramasse-miettes. L’époque est un crachat.
– On est arrivés, d’après le chauffeur alors qu’un SMS de CEO m’apprend en anglais qu’on n’attend plus que moi.
Esplanade, polygones, tourniquet, ascenseur gavé au démarrage, personnel cerné mais souriant, odeurs de bouffe maison réchauffée, descendant entre le deuxième et le cinquième étage (Sécurité et entretien), personnel mal habillé et désagréable, odeurs de bouffe à emporter, ventilé du dixième au vingtième (Recherche et développement). Enfin moi-même, personnel sportif à forte responsabilité non opérationnelle, m’élevant tout seul vers le trente-cinquième étage et ressentant toujours le petit quelque chose dans le bas-ventre, rien à faire. L’ivresse des cimes en verre. La délicate envie de gerber du simplet qui prend encore, après dix ans de boîte, la pulsion d’un moteur à traction installé au sous-sol pour son propre élan.
Une impression étrange, pas désagréable que je parviens en général à traîner jusque dans l’Espace accueil. Et après ça s’arrête. J’ai à nouveau envie de chialer en atterrissant sur la moquette rouge à rayures marron. Mais j’avance. Je ne touche plus terre. Entre moi et la terre s’étagent trente-quatre niveaux, douze parkings, vingt mètres de gaines de climatisation, sans compter le métro. Je m’avale au ralenti quinze mètres de couloir revêtu d’angora polyamide à 1 000 balles le mètre, sur dalle de ciment à 20 000 le mètre. Non 25, après le trentième étage, c’est plus cher. Plus c’est chiffré, plus c’est rassurant. Encore dix mètres, je ralentis, pour arriver quasi paralysé dans l’Espace comité où persiste la moquette rouge tel du chiendent, d’où surgit la voix de son maître :
– C’est enfin Clément, prononce Oliver, le CEO et je percevrais si j’étais lucide une pointe d’agacement. Il me rafraîchit jusqu’à l’os de son regard bleu glacier, délicatement chiné de vaisseaux éclatés. En voilà une teinte qui conviendrait davantage à la moquette.
Tout le monde fait normalement la gueule car c’est l’endroit pour. Une réunion Special Situation (SS) à la mi-journée au quasi dernier étage d’une banque d’affaires malmenée en Bourse depuis deux ans. Un sourire y ferait l’effet d’un bermuda. Sont ici rassemblés CEO, CFO, CRO, CDO, des fonctions importantes qui rendent très mal en français. Disons le grand patron, Oliver, Safia la directrice financière et Grette la directrice des risques. Quant à Chief Data Officer, Amin, je ne sais pas vraiment ce qu’il fait et s’il était honnête, il avouerait que lui non plus. Ils sont dans le vif du sujet depuis un moment et je devrais bien sûr savoir lequel. Il y avait sûrement un mail à ouvrir tandis que je tentais de deviner la forme des seins de la prof, sous son chemisier APC.
– T’en penses quoi Clément de ce merdier ?
Si je demande lequel je passerai pour ce que je suis, un poids mort incapable des bonds qu’exigera l’agilité-dans-la-transition-économique-post-covid. J’opte pour une moue situant mon jugement entre la lassitude de qui avait vu arriver le boulet et l’expectative de celui qui n’est pas sûr de se le prendre. Encore gagné. Safia est d’accord avec moi, estimant qu’en l’absence du patron des activités de marchés, on ne peut conclure à rien. Ce disant, elle caresse, abandonnée sur son épaule, une queue-de-cheval longue, noire, luisante et nette comme un jet de pétrole qui devrait me donner des idées. Mais je pense encore à la chercheuse. Son appétit sous la serre.
– Tu lui as parlé toi, à ce trou-du-cul ? m’adresse Oliver, sûrement à propos du responsable de la présente tragédie.
Je réponds non car j’ai une chance sur deux.
– Tant mieux. Je vais me le faire.
Bingo.
..............................................................................................................................................................
BIO;
Maria Pourchet est une romancière française, née le 5 mars 1980 à Épinal (Vosges). La plupart de ses romans sont publiés aux éditions Gallimard dans la collection Blanche. Elle vit à Paris.
Romans
Avancer, roman, Gallimard, « collection Blanche », 2012 (ISBN 9782070137121).
Rome en un jour, roman, Gallimard, « collection Blanche », 2013 (ISBN 9782070142163) ; « Folio » n° 6057, 2015 (ISBN 9782070468140).
Champion, roman, Gallimard, « collection Blanche », 2015 (ISBN 9782070148646) ; « Folio » n°6723, 2019, (ISBN 9782072864643).
Toutes les femmes sauf une, Pauvert, 2018 (ISBN 9782213699134).
Les Impatients, roman, Gallimard, « collection Blanche », 2019 (ISBN 9782072831454).
Feu, roman, Fayard, 2021, (ISBN 9782213720784).
Nouvelles et poésie
La 206, in La Nouvelle Revue française (n° 618), Gallimard, mai 2016 (ISBN 9782070183739).
Roman, in La Nouvelle Revue française (n° 641), Gallimard, mars 2020 (ISBN 9782072890963).
Hypo Game, in Les désirs comme désordre (collectif), Pauvert, 2020, (ISBN 9782720215674).
Autres publications (ouvrages collectifs et recensions)
Les Médiations de l’écrivain, les conditions de la création littéraire7 sous la direction de Maria Pourchet et d’Audrey Alvès, L’Harmattan, 2011 (ISBN 9782296139114).
Avec Sylvie Ducas, Comment le livre vient au lecteur : la prescription littéraire à l’heure de l’hyperchoix et du numérique, in Communication et Langages, Armand Colin, Paris, 2014.
« Roger Marchal, dir., Vie des salons et activités littéraires de Marguerite de Valois à Mme de Staël », Questions de communication, 5, 2004. Accès : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/7148 [archive].
« Olivier Donnat, Paul Toila, dirs, Le(s) public(s) de la culture », Questions de communication, 2004. Accès : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/4602 [archive].
« Mihai Coman, Pour une anthropologie des médias », Questions de communication, 2005. Accès : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/5474.
Documentaires
Des écrivains sur un plateau : une histoire du livre à la télévision (52 min), écrit par Maria Pourchet, co-réalisé avec Bernard Faroux, produit par l'INA, diffusion France 2, octobre 2009.
Prix et distinctions
Prix Erckmann-Chatrian8 2013 pour Rome en un jour.
Prix du public (Touquet Paris-Plages) 2015 pour Champion
Prix Révélation de la SGDL 2018, pour Toutes les femmes sauf une.
Finaliste prix Le Monde 2018, pour Toutes les femmes sauf une.
Prix Françoise Sagan 2019 - "Mention spéciale du jury" pour Les impatients.
Sélection prix Orange du livre 2019 pour Les impatients.
Sélection prix du roman Marie-Claire 2019 pour Les impatients.
Blizzard.
RÉSUMÉ
Le blizzard fait rage en Alaska.
Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile.
.......................................................................................................................................................................EXTRAITS:
Bess
Je l’ai perdu. J’ai lâché sa main pour refaire mes lacets et je l’ai perdu. Je sentais mon pied flotter dans ma chaussure, je n’allais pas tarder à déchausser et ce n’était pas le moment de tomber. Saleté de lacets. J’aurais pourtant juré que j’avais fait un double nœud avant de sortir. Si Benedict était là, il me dirait que je ne suis pas suffisamment attentive, il me signifierait encore que je ne fais pas les choses comme il faut, à sa manière. Il n’y a qu’une seule manière de faire, à l’entendre. C’est drôle. Des manières de faire, il y en a autant que d’individus sur terre, mais ça doit le rassurer de penser qu’il sait. Peu importe, j’ai lâché sa main combien de temps ? Une minute ? Peut-être deux ? Quand je me suis relevée, il n’était plus là. J’ai tendu les bras autour de moi pour essayer de le toucher, je l’ai appelé, j’ai crié autant que j’ai pu, mais seul le souffle du vent m’a répondu. J’avais déjà de la neige plein la bouche et la tête qui tournait. Je l’ai perdu et je ne pourrai jamais rentrer. Il ne comprendrait pas, il n’a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui se joue. S’il avait posé les bonnes questions, si j’avais donné les vraies réponses, jamais il ne me l’aurait confié. Il a préféré se taire, entretenir l’illusion, prétendre que j’étais capable de faire ce qu’il me demandait. Au lieu de cela, dans cette terre de désolation qui suinte le malheur, je vais ajouter à sa peine, apporter ma touche personnelle au tableau. Il faut croire que c’est plus fort que moi.
............................................,
Benedict
Rétrospectivement, je crois que j’ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. C’est un peu comme lorsque vous avez la sensation qu’un insecte vous chatouille l’oreille. Vous faites un geste pour vous en débarrasser, mais en réalité c’est une alarme, votre alarme interne, réglée au strict minimum. Pas assez forte pour vous faire bondir, mais juste assez pour vous empêcher de dormir tranquillement. Je dormais justement et je me suis réveillé en sursaut. Était-ce un pressentiment ou bien le courant d’air froid qui venait d’en bas ? Je ne sais pas. J’étais tellement fatigué d’avoir passé les derniers jours dans l’excitation, à relever les pièges, à ranger le matériel et à nous préparer avant que n’arrive le mauvais temps. J’ai toujours aimé les tempêtes, et surtout le moment juste avant, quand il faut tout protéger, boucher les interstices, rentrer assez de bois pour tenir quelques jours et se faire un espace clos, le plus hermétique possible. Et puis, quand la tempête est là, se claquemurer avec la cibi qui grésille, une tasse de café brûlant pour se réchauffer les mains et le feu dans la cheminée qui se rebelle à cause de la neige qui tombe dans le conduit et du vent qui s’y engouffre. J’entends la maison qui craque et qui gémit comme un petit vieux. Parfois, j’ai l’impression qu’elle me parle, comme elle a peut-être parlé à mes parents et à mes grands-parents avant eux, de génération en génération, jusqu’au premier Mayer qui a décidé de s’installer ici, en terre hostile, et de prétendre qu’il serait plus fort que la nature. La maison est encore debout et je suis bien au chaud à l’intérieur, protégé par ses murs, comme un diamant dans son écrin. Sauf que je suis tout seul. Quand je suis descendu de l’étage, la porte était grande ouverte et la neige s’était déjà engouffrée par paquets. Ça m’a énervé. J’ai crié : « Bon Dieu, Bess, tu peux pas fermer cette foutue porte ? On va tous crever de froid par ta faute ! », mais elle n’a pas répondu. C’est seulement à ce moment-là que j’ai vu que les bottes du petit n’étaient pas là et que leurs vestes n’étaient plus accrochées au porte-manteau. J’ai compris qu’elle était sortie avec lui, alors que même une fille aussi spéciale qu’elle aurait dû savoir qu’on ne sort pas dehors en plein blizzard.
.........................................................,
Cole
Si le Seigneur m’entend, je jure solennellement que je boirai plus une goutte d’alcool. J’ai tellement mal à la tête avec le truc que ce salopard m’a fait boire. Appeler ça de l’eau-de-vie, c’est vraiment se foutre de la gueule du monde. Je sens plus ma gorge et j’ai le bide en vrac. C’est à vous donner l’envie de virer bonne sœur, même si j’ai pas l’attirail pour ça. Je sortais à peine des toilettes à cause de la courante que l’alcool m’avait causée quand ça a tambouriné de tous les diables à la porte. C’est pas un temps à mettre un bon chrétien dehors, alors je me suis reboutonné comme j’ai pu et j’ai attrapé mon fusil. On sait jamais ce qui peut courir les bois. J’ai crié : « C’est qui ? », un truc auquel un ours pourrait pas répondre, mais il y avait trop de vent dehors pour que je puisse entendre quoi que ce soit. Les coups ont redoublé. Ma foi, j’avais pas le choix. J’ai tourné le verrou, entrouvert la porte avec mon pied et j’ai visé l’entrebâillement au cas où. « Tire pas, Cole ! C’est moi ! » qu’il a crié. J’ai reconnu la grosse voix grave de Benedict. Il était couvert de neige, ça lui faisait comme des épaulettes de général de pacotille et il avait déjà le bout des cils tout blanc, avec des gouttes de givre comme des décorations de strip-teaseuses. Enfin je dis ça parce que j’en ai vu une en photo dans un magazine qui traînait chez Clifford. La fille avait des petites gouttes rouges au bout de ses faux cils, ça lui faisait un regard bizarre, comme une poupée. Il paraît qu’il y a des types qui aiment ça. Benedict m’a poussé d’un coup pour refermer la porte derrière lui. Il a même pas enlevé son couvre-chef. Il s’est appuyé contre le mur, a passé sa main sur son visage et puis il a dit, comme s’il avait vu passer un revenant : « Bess et le petit sont partis. Ils sont dehors. » C’était tellement crétin comme idée que j’ai rigolé. « Me fais pas rire, Benedict, elle est pourrie ta blague », je lui ai dit. « Tu crois que je serais sorti avec ce temps, juste pour te faire marcher ? » qu’il m’a répondu. J’ai vu rien qu’à sa tête qu’il était sérieux et bon sang, si c’était vrai, alors on avait du souci à se faire. Il a tout juste dix ans, le môme, et l’autre, elle a pas deux sous de jugeote. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce qu’on fait alors ? » et il m’a répondu un truc qui m’a pas fait plaisir : « Qu’est-ce que tu crois ? On va les chercher. » Ça, c’était pire que la bibine de Clifford et j’ai eu comme une envie d’en reprendre une lampée.
...................................................,
Freeman
Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit avec ce temps. Le vent souffle tellement fort autour de la maison que je ne sais pas comment elle tient encore debout. J’ai l’impression que les murs sont pris dans un étau entre la poussée des rafales et la neige qui s’accumule. Dieu sait comment je vais réussir à en sortir quand tout sera fini. Lors de la première tempête que j’ai vécue ici, je suis resté bloqué deux jours. Il y avait bien cinq pieds de neige devant la porte et je ne pouvais pas ouvrir les volets des fenêtres que j’avais stupidement fermés, une erreur de débutant, m’avait dit Benedict. J’ai dû grimper jusqu’au grenier, à mon âge, et redescendre par la lucarne avec une corde. L’opération n’a pas tout à fait marché comme je le souhaitais. Je me suis déboîté l’épaule dans la chute et il a quand même fallu que je m’occupe de pelleter la neige avec mon bras valide avant de pouvoir trouver de quoi bloquer l’autre bras. Ce coup-ci, j’ai essayé de déblayer le plus possible tout autour de la maison en espérant que ce soit suffisant. C’est quelque chose qui ne s’invente pas, savoir survivre. Là d’où je viens, on n’a pas à se poser de questions pour savoir si la neige vous empêchera de sortir. Il n’y a pas de neige, pas le moindre flocon, et si j’avais le choix, je préférerais cent fois être là-bas plutôt que dans ce pays à supporter mes rhumatismes. Le froid, l’humidité, ce n’est pas bon pour ma vieille carcasse. Ce serait un comble d’avoir survécu à tout ce que j’ai connu pour mourir maintenant, moisi comme une vieille branche pourrie. Qu’est-ce que je fais là alors ? Je suppose que s’Il a voulu que nos routes se croisent et que je m’enterre au bout du monde, c’est qu’il y avait une bonne raison à cela. Il sait que je suis un pécheur, mais si mon Dieu de miséricorde a un plan pour moi, j’attendrai jusqu’à ce que la lumière soit faite. Je suis gelé, mais j’attendrai puisqu’il le faut. Et, pour être tout à fait honnête, je n’ai pas vraiment d’autre choix.
..............................................,
Bess
Je ne vois rien. La neige s’envole du sol en tourbillons et lorsque je lève les yeux vers le ciel c’est une vraie purée de pois. L’air est incolore, comme si toutes les couleurs existantes avaient disparu, comme si le monde entier s’était dilué dans un verre d’eau. Je regrette de ne pas avoir fait plus attention quand Benedict essayait de décrire le fonctionnement des blizzards au petit. J’aurais peut-être su ce qu’il fallait faire, à part ne pas sortir bien sûr, mais ça, il est trop tard pour le regretter. Je tourne le dos au vent, appuyée sur ce que je suppose être un rocher. À moins que ce ne soit un ours qui hiberne, ce qui réglerait mon problème. Je ne parviens pas à réfléchir à la conduite à tenir, mais je vais me transformer en bonhomme de neige si je ne bouge pas. Je ne suis pas complètement idiote, je sais dans quel pétrin je me suis fourrée. Il faut que je bouge, que je trouve le gosse ou que je retourne à la maison chercher Benedict, même s’il pourrait avoir envie de me décoller les oreilles à grands coups de baffes si je reviens seule. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas lui expliquer, ce serait trop d’un seul coup. Il est solide, mais il y a des choses qui sont trop dures à entendre. De toute façon, je ne peux pas laisser le petit tout seul. Puisque je ne sais même pas dans quelle direction aller, je vais marcher droit devant moi, c’est ce qu’il a dû faire. C’est bête parfois un gamin, ça fait des trucs sans réfléchir, à l’instinct, même un petit génie comme lui. Alors si je ne réfléchis pas, moi, j’avance tout droit. C’est sûrement ce qu’il y a de mieux à faire.
.................................................................................................................................................................
BIO:
Marie Vingtras est une écrivaine française née en 1972. Elle emprunte son nom de plume à Arthur Vingtras (1855-1929), de son vrai nom Caroline Rémy, une journaliste et écrivaine française connue comme la première femme à diriger un quotidien de renom, le journal intitulé Le Cri du peuple.
Marie Vingtras est l’auteure de :
Blizzard (L’Olivier, 2021) son premier roman.
Rythmé tel un thriller, Blizzard creuse avec sensibilité l'histoire intime de ses personnages, leurs secrets, leurs douleurs.
LES AMOUREUX
Deux amoureux, marchant main dans la main
Sur le même chemin
La vie ne leur a pas fait de cadeaux
À nos deux tourtereaux.
Moult raz de marées,
Les a secoués.
MouLt zéphyrs les ont balayés, emportés,
Vers des cieux,
Qu’ils pensaient bénis des dieux.
Cris et déchirements
Rires, pleurs ;
Souffrance et, malheurs
Dure labeur.
La vie qui n’était un roman tranquille
À fait d’eux des rebelles ...
Jeux Paralympiques 2021
BRAVO A NOS VALEUREUX HANDICAPES!!!!!!!! QUI ONT Dépassé l' handicap pour parler de performance »
Les Jeux paralympiques se déroulent du mardi 24 août au dimanche 5 septembre 2021 à Tokyo. Pour cette nouvelle édition, qui devait initialement se tenir l’année dernière, la délégation française a dépassé son objectif de 35 médailles. Voici les champions français.
Or
Alexandre Léauté, cyclisme. Le cycliste Alexandre Léauté a apporté jeudi 26 août sa première médaille d’or à l’équipe de France aux Jeux paralympiques en Tokyo en remportant la poursuite individuelle (catégorie C2). Le pistard de 20 ans s’est imposé en finale face à l’Australien Darren Hicks. Il a au passage signé un nouveau record du monde dans sa catégorie et donc offert une troisième médaille à la France, provisoirement dixième au tableau des médailles. « Au bout de 1 500 mètres, ce n’était qu’au mental. C’est grâce à tous les encouragements (à distance) si j’ai pu me surpasser aujourd’hui », a réagi Alexandre Léauté, qui participe pour la première fois aux Jeux.
Dorian Foulon, cyclisme. Dorian Foulon s’est s’imposé en finale de la poursuite individuelle (catégorie C5) vendredi 27 août. Déjà champion du monde en titre de la spécialité, le cycliste de 23 ans, à l’aise aussi sur route, a signé au passage un nouveau record du monde lors des qualifications (4 min 18 s 274). « C’est le rêve de ma petite vie. Le podium, la Marseillaise, c’est quelque chose d’énorme », a confié le Breton, né avec un pied bot côté gauche, qui a exulté dans un hurlement en passant la ligne. « Les cris, c’était peut-être excessif, mais c’est ce que j’avais sur le cœur. Tout ressort : les années de travail, d’acharnement, les hauts et les bas. »
Alexis Hanquinquant, triathlon. Alexis Hanquinquant a apporté à l’équipe de France sa troisième médaille d’or des Jeux paralympiques de Tokyo en s’imposant samedi dans la catégorie PTS4 du triathlon. Triple champion du monde (2017, 2018 et 2019), le Normand de 35 ans est le seul concurrent à enregistrer un temps sous l’heure (59 min 58) et à devancer de près de quatre minutes son poursuivant japonais Hideki Uda sur cette épreuve comportant 750 mètres de natation, 20 kilomètres de cyclisme et 5 kilomètres de course à pied.
Fabien Lamirault, tennis de table. Fabien Lamiraul s’est imposé en finale du tournoi individuel de tennis de table Classe 2. Le Français, champion paralympique en titre, est venu à bout du Polonais Rafal Czuper (3-2) dans un remake de la finale de Rio 2016. Pour ses troisièmes Jeux, à 41 ans, Fabien Lamirault remporte sa cinquième médaille paralympique, la troisième individuelle.
Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault, cyclisme. Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault ont remporté le contre-la-montre sur route en tandem. Vice-champion du monde de la spécialité, le binôme français associant les cyclistes Alexandre Lloveras, malvoyant de naissance, et Corentin Ermenault, ex-professionnel, s’est imposé devant la paire néerlandaise championne paralympique en titre avec un peu moins de sept secondes sur un parcours de 32 kilomètres.
Charles-Antoine Kouakou, 400 mètres. Le sprinteur Charles-Antoine Kouakou a apporté sa 6e médaille d’or à l’équipe de France en s’imposant dans la finale du 400 mètres (catégorie T20). Pour ses premiers Jeux, l’athlète de 23 ans s’est offert le titre paralympique et porte à 33 le total de médailles françaises, à seulement deux unités de l’objectif, fixé à 35 avant l’événement.
Florian Jouanny, handbike. Florian Jouanny a été sacré champion paralympique lors de la course en ligne aux commandes de son vélo à mains (Catégorie H2). L’Isérois de 29 ans, qui disputait ses premiers Jeux au Japon, s’est rapidement détaché en tête sur le parcours arrivant au Fuji Speedway et a relégué son premier poursuivant, l’Italien Luca Mazzone, en argent la veille, à plus de quatre minutes en achevant les 53 kilomètres de course à 28,9 km/h.
Kévin Le Cunff, cyclisme. Le cycliste français, âgé de 33 ans, a décroché l’or sur la course en ligne C4-5. Il rapporte une huitième médaille à la délégation française. Kévin Le Cunff, qui jouait auparavant parmi les valides, participe à ses premiers Jeux paralympiques.
Stéphane Houdet et Nicolas Peifer, tennis fauteuil. Stéphane Houdet et Nicolas Peifer ont conservé leur titre paralympique vendredi 3 septembre en battant la paire britannique Alfie Hewett et Gordon Reid en finale du tournoi de tennis fauteuil. Le match a duré plus de trois heures. Une sacrée performance pour ces deux hommes, titrés à Rio, en 2016.
Fabien Lamirault et Stéphane Molliens, tennis de table. La Marseillaise retentira une troisième fois vendredi 3 septembre grâce au titre paralympique de la paire française en tennis de table. Fabien Lamirault et Stéphane Molliens ont remporté l'or face au tandem sud-coréen Cha Soo Yong et Park Jin Cheol. Comme Stéphane Houdet et Nicolas Peifer en tennis fauteuil, ils avaient eux aussi été titrés à Rio.
Argent
Ugo Didier, natation. En 400 mètres nage libre, Ugo Didier (catégorie S9) a décroché la première médaille d’argent de l’équipe de France mercredi 25 août : « la fierté et l’accomplissement de cinq années de travail », savoure l’étudiant de 19 ans en école d’ingénieurs. Il échoue à 1 s 08 de l’Australien William Martin, l’un des dix « Aussie » médaillés mercredi qui permettent à l’île continent de dominer le tableau des médailles. Dont la première championne paralympique de ces Jeux, la cycliste Paige Greco en poursuite individuelle (catégorie C1-C3).
Axel Bourlon, haltérophilie. Novice aussi aux Jeux malgré ses 30 ans, Axel Bourlon est devenu vice-champion paralympique d’haltérophilie en poussant une barre de 165 kg en développé couché dans la catégorie des – 54 kg, jeudi 26 août. « Cette médaille représente la fierté du travail accompli, toutes ces années passées », a exulté le Roannais, submergé par l’émotion de ce « bonheur immense », après une nuit difficile à moins de cinq heures de sommeil. « La nuit a été un peu courte, à me faire dans la tête tous les scénarios possibles », décrit Axel Bourlon, atteint d’achondroplasie, un trouble de croissance le dotant d’une petite taille.
Sandrine Martinet, judo. La porte-drapeau française, Sandrine Martinet, a été battue en finale du tournoi de judo des moins de 48 kg dans la mythique salle du Nippon Budokan, qui avait tant réussi à la délégation olympique revenue avec un record de médailles (8). C’est la quatrième médaille en cinq Jeux paralympiques pour la judoka malvoyante de 38 ans, championne paralympique 2016 des moins de 52 kg. « J’ai fait le job en ramenant une médaille. J’ai tout donné, et même si ce n’est pas l’or », a-t-elle réagi, estimant que « ça ne s’est joué à rien ». « Maintenant, je vais reprendre mon rôle de porte-drapeau et soutenir toute la délégation », se projette-t-elle.
Alexandre Léauté, cyclisme. Après son titre paralympique jeudi 26 août en poursuite (catégorie C2), le cycliste a décroché l’argent sur le kilomètre le lendemain (cat. C1-3).
Marie-Amélie Le Fur, athlétisme. Pour ses cinquièmes Jeux, Marie-Amélie Le Fur a réussi son pari de conquérir une neuvième médaille. Tenante du titre en saut en longueur (catégorie T64), la présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF) est passée près de le conserver avec un dernier bond à 6,11 mètres, trop court de seulement cinq centimètres.
Léa Ferney, tennis de table. Benjamine de la délégation française, Léa Ferney, 17 ans, a remporté la médaille d’argent en tennis de table, classe 11. Après avoir dominé en demi-finale la Japonaise Maki Ito (3-0), qui jouait à domicile, Ferney s’est inclinée en finale face à la Russe Elena Prokofeva (3-1).
Matéo Bohéas, tennis de table. Matéo Bohéas n’a pas réussi à se défaire de son adversaire, numéro 1 mondial, le Polonais Patryk Chojnowski, en finale du tournoi de tennis de table de sa catégorie. Le jeune homme de 24 ans, contraint de jouer avec une semelle orthopédique (il a une cheville bloquée et un mollet atrophié), repart avec une superbe médaille d’argent et le couteau entre les dents pour Paris 2024.
Alex Portal, natation. Alex Portal est à nouveau monté sur le podium para-olympique cette semaine. Après le bronze en 400 mètres nage libre vendredi, le nageur de 19 ans, qui est atteint d’albinisme oculaire, a décroché l’argent sur le 200 mètres 4 nages de sa catégorie (S13).
Loïc Vergnaud, handbike. Amputé tibial de la jambe droite après un accident du travail en 2004, Loïc Vergnaud s’est paré d’argent pour ses premiers Jeux à 41 ans avec son vélo à mains (catégorie H5) en contre-la-montre.
Loïc Vergnaud, handbike. Loïc Vergnaud est passé tout proche d’un exploit en handbike (Catégorie H5). Au lendemain de sa médaille d’argent en contre-la-montre, après avoir faussé compagnie à ses deux derniers compagnons d’échappée néerlandais, il a été dépassé sur la ligne par Mitch Valize, l’un d’entre eux, déjà champion du monde en juin devant lui.
Dimitri Pavadé, athlétisme. À 32 ans, Dimitri Pavadé est devenu vice-champion paralympique du saut en longueur (T64). Le sportif, amputé de la jambe droite, s’est envolé à 7 m 39. De bon augure pour Parisc2024.
Relais par équipe, handbike. Les cyclistes Riadh Tarsim, Loic Vergnaud et Florian Jouanny ont décroché l’argent sur le relais par équipe H1-H5. Ils ont devancé les États-Unis et ont fini 31 secondes derrière les Italiens, champions paralympiques. C’est la première médaille de Tarsim sur ces Jeux, la troisième de Vergnaud et la troisième de Jouanny, en or sur la course en ligne.
Timothée Adolphe, athlétisme. Timothée Adolphe et son guide Bruno Naprix ont décroché la deuxième place du 100 mètres en catégorie T11 (déficient visuel) jeudi 2 septembre. Timothée Adolphe, para-athlète de 31 ans, que l’on surnomme « le guépard blanc », a, qui plus est st, battu son record personnel en bouclant ce 100 mètres en 10 secondes 90.
Bronze
Marie Patouillet, cyclisme. Au vélodrome d’Izu, Marie Patouillet a ouvert le compteur de l’équipe de France en remportant la médaille de bronze sur piste en poursuite individuelle (catégorie C5). « Je ne réalise pas trop. Pour mes premiers Jeux, première épreuve et première médaille », a réagi la pistarde de 33 ans, plutôt spécialiste du sprint. Elle est d’ailleurs entraînée par Grégory Baugé, quadruple champion du monde de vitesse individuelle et médaillé d’argent dans la même épreuve aux Jeux olympiques de Londres en 2012.
Alex Portal, natation. Le timing était trop juste pour filer à la piscine du centre aquatique de Tokyo où Alex Portal, deux jours après avoir manqué le podium pour 1/100 mercredi en 100 mètres papillon, a pris la médaille de bronze du 400 mètres nage libre (catégorie S13). Atteint d’albinisme oculaire depuis sa naissance, et donc malvoyant, le nageur de 19 ans tient son premier podium aux Jeux, les premiers de sa carrière.
Mandy François-Elie, athlétisme. La sprinteuse Mandy François-Elie, qui en est, elle, une habituée, a décroché la médaille de bronze du 200 mètres (catégorie T37) après l’or et l’argent en 100 mètres en 2012 puis 2016. Atteinte d’une hémiplégie côté droit, la Martiniquaise a manqué la deuxième place pour 1/100 vendredi 27 août.
Ronan Pallier, athlétisme. Le sauteur en longueur Ronan Pallier a, lui, signé à 50 ans l’exploit de remporter la première médaille de sa carrière dans une épreuve individuelle, son bond à 6,15 mètres lui offrant le bronze de la catégorie T11, dédiée aux athlètes malvoyants.
Raphaël Beaugillet, cyclisme. Sur la piste du vélodrome d’Izu, déjà pourvoyeuse de quatre podiums depuis le début des Jeux, le duo formé par Raphaël Beaugillet et le septuple champion du monde chez les valides, François Pervis, a pris la médaille de bronze du kilomètre en tandem pour 82/100.
Thu Kamkasomphou, tennis de table. L’expérimentée Thu Kamkasomphou, 52 ans, a signé un sixième podium individuel (Classe 8) en six Jeux. Elle avait commencé son aventure paralympique en 2000 par un titre à Sydney (en Classe 9 à l’époque).
Annouck Curzillat, triathlon. La triathlète Annouck Curzillat, qui participe à ses premiers Jeux paralympiques à l’âge de 29 ans, avec sa guide Céline Bousrez, a décroché la médaille de bronze en paratriathlon samedi 28 août. Elle a jeté toutes ses forces dans le sprint final pour devancer de quelques mètres à peine la paire britannique, qui finit au pied du podium.
Maxime Thomas, tennis de table. Comme à Rio, le pongiste en fauteuil Maxime Thomas a pris aussi la troisième place en individuel (Classe 4), sa quatrième médaille paralympique additionnée à celles obtenues par équipes.
Lucas Créange, tennis de table. Lucas Créange a glané sa première médaille aux Jeux, en Classe 11, dédiée au handicap cognitif, avec le bronze.
Anne Barnéoud, tennis de table. Aphasique et hémiplégique côté droit depuis un AVC à quatre ans, Anne Barnéoud a remporté sa première médaille en individuel (Classe 7), après une médaille de bronze obtenue par équipes à Pékin, en 2008 : elle prend aussi une médaille de bronze.
Nathalie Benoit, aviron. Après l’argent à Londres en 2012, Nathalie Benoit, 41 ans, a réussi à décrocher une magnifique médaille de bronze en skiff, samedi 28 août. Un vrai tour de force pour cette rameuse de Marseille qui fait face ces derniers mois à une évolution de sa maladie, la sclérose en plaques. La quadragénaire de plus avait été repêchée pour participer à cette finale dans la catégorie PR1.
Quatre avec barreur, aviron. Les Bleus ont signé un doublé en bronze dans la nuit de samedi à dimanche. Après la belle troisième place de Nathalie Benoit, le quatre barré mixte – composé d’Erika Sauzeau, Antoine Jesel, Rémy Taranto, Margot Boulet et Robin Le Barreau – a franchi la ligne d’arrivée en troisième position en 7'27''04, derrière les Américains, en argent, et les Britanniques, en or.
Souhad Ghazouani, développé couché. L’haltérophile Souhad Ghazouani, paraplégique, alignée dans la catégorie des moins de 73 kilos, a décroché une belle médaille de bronze dimanche 29 août. C’est la cinquième médaille olympique pour cette Lilloise qui était en argent en 2004 à Athènes, en bronze à Pékin en 2008, en or à Londres en 2012 et en argent à Rio en 2016.
Hélios Latchoumanaya, judo. Le judoka tricolore Hélios Latchoumanaya, déficient visuel, a remporté le bronze dans la catégorie des moins de 90 kilos. Une belle revanche pour le numéro trois mondial de 21 ans, après une défaite douloureuse en demi-finale. Il a battu le Kazakh Zhanbota Amanzhol par ippon. À noter qu’il s’agissait de sa première olympiade. Un résultat plein d’espoir pour Paris 2024.
Trésor Makunda, athlétisme. Trésor Makunda, malvoyant, et son guide Lucas Mathonat, ont décroché la troisième place synonyme de médaille de bronze en finale du 400 mètres (catégorie T11) dimanche 29 août. L'athlète de 37 ans, malvoyant depuis tout petit à la suite d’une rétinopathie, avait déjà remporté quatre médailles olympiques dans sa carrière : l’argent en 100 mètres à Athènes, deux fois le bronze en 100 mètres et 4 x 100 mètres à Pékin, ainsi que le bronze en 400 mètres à Londres.
Fleuret par équipe, escrime. Le trio de fleurettistes français, en escrime fauteuil, Damien Tokatlian, Maxime Valet et Romain Noble, a battu la Russie 45-40 et repart de Tokyo avec le bronze autour du cou. De quoi se remettre de la large défaite face aux Britanniques en demi-finale (45-23).
Compétition par équipe, tennis de table. Florian Merrien, Nicolas Savant-Aira et Maxime Thomas ont récolté le bronze par équipe mercredi 1er septembre en catégorie 4-5. Après leur victoire en quarts, les Bleus n’ont pas su se défaire de la Corée du Sud. Mais en tennis de table, une défaite en demi-finale est synonyme de médaille de bronze.
Florian Jouanny, handbike. Florian Jouanny a remporté sa première médaille paralympique lors du contre-la-montre en handbike (catégorie H2) avec le bronze, comme aux Championnats du monde en juin.
Alexandre Léauté, cyclisme. Troisième médaille en autant d’épreuves individuelles pour Alexandre Léauté : le cycliste français a pris le bronze dans le contre-la-montre sur route (Catégorie C2).
Alexandre Léauté, cyclisme. Alexandre Léauté aura connu des Jeux paralympiques presque parfaits, avec autant de podiums que d’épreuves individuelles disputées. Le cycliste français a décroché une médaille de bronze jeudi dans la course en ligne (catégorie C1-C3) au Fuji Speedway.
Marie Patouillet, cyclisme. Marie Patouillet, 33 ans, déjà médaillée de bronze sur piste en poursuite (catégorie C5), a doublé la mise lors de la course en ligne sur route. Née avec une malformation à un pied, elle a pris la troisième place au bout d’un parcours identique à celui d’Alexandre Léauté.
Thomas Bouvais et Clément Berthier, tennis de table. La paire française masculine, composée de Thomas Bouvais et Clément Berthier, a échoué aux portes de la finale du tournoi par équipe en catégorie 8. Mais ils repartent avec la médaille de bronze.
Anne Barneoud et Thu Kamkasomphou, tennis de table. Anne Barneoud et Thu Kamkasomphou, déjà médaillées de bronze individuellement sur ces Jeux paralympiques, montent encore une fois sur la troisième marche du podium, mais pour le tournoi par équipe cette fois. Elles ont été défaites en trois sets en demi-finale face à la paire chinoise Jingdian Mao et Wenjuan Huang.
Ugo Didier, natation. Et de deux ! Déjà médaillé d’argent sur le 400 mètres nage libre au début des Jeux paralympiques, Ugo Didier a à nouveau accédé au podium mercredi 1er septembre, décrochant le bronze sur le 400 mètres 4 nages dans sa catégorie S9.
Florent Marais, natation. Florent Marais, qui souffre d’une agénésie de la jambe droite, s’est offert le bronze sur le 100 mètres dos dans la catégorie S10 jeudi 2 septembre. À 21 ans, il s’agit de sa première médaille paralympique, une médaille qui a un goût de revanche après la douloureuse quatrième place sur le 100 mètres papillon quelques jours plus tôt.
Pierre Fairbank, athlétisme. À 50 ans, Pierre Fairbank a remporté la 9e médaille paralympique de sa carrière avec le bronze sur le 800 mètres fauteuil (catégorie T53). Il a bouclé la course en 1'39''67, à trois secondes seulement du Canadien Brent Lakatos (en argent avec 1'36''32) et du Thaïlandais Pongsakorn Paeyo (en or avec 1'36''07). Il s’agissait de la dernière course de la carrière sportive de Pierre Fairbank, qui avait donc déjà remporté trois médailles à Sydney, deux à Athènes, une à Pékin et deux à Rio en 2016.
Rémy Boullé, canoë. L’athlète français Rémy Boullé décroche la médaille de bronze sur le 200 mètres en catégorie KL1. Le Français de 33 ans a été devancé par le jeune Hongrois Peter Kiss et le Brésilien Luis Carlos Cardoso da Silva, vendredi. C’est la première médaille pour le canoë français sur ces Jeux paralympiques.
Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault, cyclisme. Le tandem emmené par Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault a remporté la 16e médaille du paracyclisme tricolore avec le bronze vendredi 3 septembre sur la course en ligne classe B. C’était la dernière épreuve du paracyclisme, qui a réalisé une magnifique moisson. À noter que la paire a déjà obtenu une médaille sur cette olympiade : l’or sur le contre-la-montre.
Timothée Adolphe

S'il n'en reste qu'une .
RÉSUMÉ:
L’héroïsme des bataillons de combattantes kurdes contre Daech attendait son grand roman. Le voici.
Une journaliste occidentale croit pouvoir enquêter impunément sur le destin magnifique de deux figures légendaires, Tékochine et Gulistan, afin de raconter la pureté de leur cause, l’inflexibilité de leur lutte, les circonstances exceptionnelles de leur mort dans les décombres d’une ville assiégée de l’ancienne Mésopotamie.
Mais accéder au premier cercle des dirigeants clandestins de cette guerre-là se mérite, et peut-être ne peut-on révéler la vérité qui se cache derrière tant de récits lacunaires et contradictoires qu’en se perdant à son tour : son enquête devient peu à peu parcours initiatique, remontée du fleuve du souvenir, hymne à une liberté dont nous avons perdu le sens en cessant d’être prêts à en payer le prix.
Dans un paysage de sable et de lumière, S’il n’en reste qu’une est l’histoire de ces femmes confrontées à ce qu’il peut y avoir d’incandescent dans la condition humaine.
.....................................................................................................................................................................
Extraits:
PREMIÈRE PARTIE
Kobané – le sursaut
CHAPITRE I
Je m’appelle Rachel Casanova et je suis journaliste – grand reporter, plus précisément : un fichu métier par les temps qui courent, surtout pour une femme. Depuis dix ans, je travaille au Sydney Match, journal à sensation qui ne fait pas toujours honneur à l’Australie et il m’arrive de regretter le Québec dont je n’aurais peut-être jamais dû partir – surtout de Chicoutimi, la ville où je suis née il y a déjà pas mal de temps. Toutefois, Jim Billingman, mon boss – comme on dit dans l’équipe – n’est pas un mauvais gars, ni l’un de ces horribles patrons de presse tels qu’on en rencontre souvent ; disons qu’il fait de son mieux pour ne pas se laisser prendre au charme vénéneux du divertissement généralisé ; quand il le faut, il « persévère dans son être », ainsi qu’il aime s’en vanter, et se lance à contre-courant de l’air du temps pour publier des sujets qui en valent vraiment la peine, de ceux qui « mènent le monde », comme il dit aussi ; on voit alors des lueurs d’une profondeur presque inquiétante s’allumer au fond de ses gros yeux de batracien. Si j’écris ce livre sur les combattantes kurdes de Syrie depuis les montagnes les plus perdues qui soient en ce bas-monde, c’est grâce à lui – et pour une fois, je bénis la main qui me nourrit.
Pourtant, rien ne me prédestinait à parler de ces Kurdes, encore moins de leur guerre ou de leur pays, le Rojava ; on ne m’avait jamais envoyée dans ce capharnaüm militaire qu’est le Moyen-Orient et cela ne me tentait pas vraiment – comme au temps de ma jeunesse, je pensais : « La guerre ? C’est le mal absolu, occupons-nous d’amour… » De surcroît, j’ignorais les détails des soubresauts agitant la Syrie et de ce que pouvait bien être la révolution kurde ; j’avais retenu d’un spécialiste que si ces derniers se battaient contre les islamistes de Daech – et la plupart des États de la région – c’était pour faire émerger une Syrie démocratique et laïque, féministe et écologique ; pour moi, cela voulait tout dire et rien dire ; je suis un peu revenue de ce genre de choses, je le reconnais sans peine. Naturellement, il y avait beaucoup de femmes dans cette révolution, ce qui me plaisait bien, mais aussi pas mal d’idéologie, ce qui m’enchantait moins.
Tout a commencé il y a six mois, lorsque mon boss m’a fait demander par sa secrétaire ; je suis entrée dans son bureau et Jim a installé son ventre replet sur le canapé des visiteurs ; après quoi, il a allumé l’un de ses gros cigares dont le diamètre est à ses yeux proportionnel à l’importance d’un patron de presse – le genre de poncif qu’il affectionne avec les roses à la boutonnière pour les complets trois-pièces des soirées VIP, et les pieds sur la table du bureau pour les visiteurs sans importance… Je me suis toujours demandé pour quelles raisons cet homme au physique disgracieux se complaisait dans cette caricature hollywoodienne de lui-même, mais je n’ai jamais trouvé la réponse. Et personne au bureau n’aurait pu m’aider. C’était le genre de sujet qu’il aurait été malvenu d’aborder. On ne plaisantait pas avec ça.
Son cigare entre les dents, Jim a redressé l’espèce d’outre flasque qui lui tient lieu de corps et je me suis assise dans le fauteuil en face de lui. La bouteille de scotch était à sa place habituelle, sur la table basse, et Jim s’est mis à la regarder d’un œil mélancolique, sans plus faire attention à moi. Brusquement, je me suis sentie mal à l’aise ; cette histoire commençait bizarrement et me rappelait le début d’une autre histoire – toutefois, j’étais bien en peine de savoir laquelle. Puis, Jim a grogné comme pour lui-même :
« Depuis la disparition de Ted, plus aucun de mes visiteurs ne touche à cette bouteille ; c’est pourtant de l’excellent scotch, du Black Bourbon, tout de même… Au moins, Ted le reconnaissait toujours quand il en sifflait la moitié en une heure… »
Ted Singleton avait été l’un de nos meilleurs grands reporters, un de ces types à l’ancienne comme on n’en fait plus, le moule étant cassé depuis longtemps – ainsi que l’on dit. Hélas, depuis l’échec du seul livre qu’il ait jamais écrit, Le naufrage du lieutenant Wells, il n’avait jamais remis les pieds au journal. Les employés des faits divers affirmaient en rigolant qu’on se perdait en conjectures sur ce qu’il était devenu ; c’étaient des sots – cependant, son appartement de la rue Courtépée avait été déménagé par on ne savait qui, son téléphone était aux abonnés absents, aucun de ses rares amis n’avait de nouvelles. On avait fini par prévenir la police : sans résultat aucun. C’était comme si le vieux Ted se trouvait désormais sur la Lune.
« Je me demande si ce n’est pas de ma faute, reprit Jim en dodelinant de la tête. Bon sang, où peut-il bien être en ce moment ? Il ne s’est tout de même pas… »
Je me récriai : « Non, boss, Ted n’est pas le genre d’homme à se suicider. À mon avis, il est parti très loin et on ne le reverra pas de sitôt. Il se purge du monde à défaut d’avoir pu le soigner ; c’est comme ça qu’il voyait les choses depuis un bon bout de temps, vous savez. Il vieillissait – je veux dire : il commençait à comprendre.
— Vous étiez très amis, n’est-ce pas ? », demanda Jim, comme s’il ne m’avait pas entendue – et sans attendre la réponse, il marmonna : « J’aurais dû publier son reportage sur l’histoire Wells. C’était excellent, en fait. Une histoire de tous les temps cet officier de marine qui ne ressemblait à personne… À la place, je lui ai dit : “Ted, on ne peut pas sortir un truc pareil : un gars qui saborde son navire parce que ce navire et son capitaine se sont déshonorés en abandonnant des migrants en perdition, qui va croire ça ? Et qu’en plus, cet officier, à peine un lieutenant, ait mis en jeu la vie de l’équipage parce que ce dernier s’était retiré de l’espèce humaine par ses actes, ce n’est pas crédible non plus.” J’ai même ajouté stupidement : “Ce n’est pas une histoire d’aujourd’hui, mon vieux.”
— Tout était vrai pourtant, dis-je doucement.
— De grâce, ne me tourmentez pas, Rachel. J’ai longtemps refusé de croire que l’homme vivait dans le mensonge et je me suis fichu dans le mur… On ne m’y reprendra plus. » Je ne comprenais pas trop ce qu’il entendait par là – que venait faire le mensonge dans tout ça ? – mais déjà il reprenait : « En plus, c’est moi qui ai incité Ted à écrire un livre sur cette histoire de marin à moitié dingue… Avec le Sydney Match, il aurait eu ses deux millions de lecteurs habituels ; en librairie, il a vendu à peine plus de mille exemplaires de son bouquin. La poisse… »
Il parlait en m’observant par en dessous, dans un mélange de tristesse et d’inquiétude, son cigare à la main, coincé entre ses doigts boudinés. « Ça a dû l’affliger considérablement, ajouta-t-il d’un air malheureux.
— Il faut oublier tout ça, boss, lui lançai-je d’un ton que je voulais fataliste. Ce sont des choses qui arrivent ; vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour le journal et voilà tout…
— Justement, fit Jim, il faut qu’on se rattrape – et sans plus attendre. Il se trouve que j’ai les munitions pour ça et j’aimerais vous les confier. Ça vous dirait, un sujet du même genre que l’affaire de Ted avec son marin fou ? Je veux dire : quelque chose d’important ; mieux, de grave… »
Il se tut d’un coup et tira plusieurs fois sur son cigare en me dévisageant avec une intensité qui en était presque gênante ; soudain, je sus quel début d’histoire tout cela me rappelait : ce n’était ni plus ni moins que l’histoire de Ted et de l’affaire Wells : elle avait débuté exactement de la même manière, dans les mêmes termes et au même endroit. Je sentis un drôle de trouble m’envahir. Et si c’était un signe que m’envoyait le destin ? Mais un signe de quoi ? Tout cela commençait à me perturber. Comme Jim demeurait silencieux, se contentant de jeter de grosses volutes de fumée vers le plafond avec un air de vieux Bouddha rusé, je m’enhardis :
« Quelque chose de vraiment important, boss ? »
Il haussa les épaules d’un air désabusé : « Rachel, après quarante ans de ce foutu métier, je me demande en fin de compte si je sais encore ce qui est important et ce qui ne l’est pas. C’est votre cas aussi, non ?
— J’ai vingt ans de moins que vous, Jim…
— Ah ? Tant que ça ?
— S’il vous plaît, ne soyez pas désobligeant.
— Hum… Si vous voulez… Bon, je conviens que vous savez à coup sûr ce qui est important et ce qui l’est moins ; c’est entendu… » Il s’interrompit, souffla comme une baleine fatiguée, et sans transition m’annonça : « Quoi qu’il en soit, je voudrais que vous partiez dans le nord de la Syrie.
— Ah, fis-je, étonnée. La Syrie ?
— Le nord, Rachel, le nord… C’est le pays des Kurdes, l’ancien Rojava.
— Oui, je sais, répondis-je, vaguement agacée ; je lis les journaux, merci… Quel est le lien avec Ted ? Et puis, ça fait des lustres qu’on n’en parle plus, des Kurdes. Les Turcs occupent toute la région et y ont installé les groupes islamistes qu’ils contrôlent, non ?
— Justement, Rachel, justement. Et pour Ted, vous comprendrez vite. »
Il entreprit de soulever son gros corps du canapé et se dirigea vers sa table de travail vide de tout dossier : pas la plus petite feuille de papier. C’était une habitude dont il était très fier depuis quelque temps, affirmant à qui voulait l’entendre que seuls les patrons inefficaces voyaient leurs bureaux surchargés de paperasse. Il ouvrit un tiroir et revint vers moi avec une chemise cartonnée qu’il posa devant lui, près de la bouteille de scotch. Ses gros yeux de caméléon brillaient à nouveau. Il ouvrit la chemise et me tendit une série de clichés : « Jetez un œil là-dessus, je vous prie. »
Toutes les photos représentaient des combattantes kurdes dans des scènes de guerre ou de vie quotidienne. Beaucoup étaient jolies, toutes portaient de longues nattes noires. Leurs tenues camouflées n’ôtaient rien à leur féminité. Jim me demanda :
« Ça vous parle, j’imagine ?
— Évidemment, boss.
— Ces filles ont été célèbres à une époque, continua-t-il d’un air songeur, les yeux mi-clos. Elles étaient des milliers à lutter contre les djihadistes, de vraies petites Jeanne d’Arc – c’est comme ça que certains de nos collègues les appelaient à l’époque ; ça m’avait frappé et pourtant on n’a pas fait grand-chose dans le journal… Un de mes damnés regrets, comme pour Ted et Wells, je dois l’avouer… Vous vous souvenez des grandes batailles auxquelles ont participé ces femmes, n’est-ce pas ? Kobané, Raqqa. Toute la presse racontait leur combat…
— Elle relatait aussi celui des hommes, fis-je remarquer, soudain sur mes gardes. Ils ont gagné la guerre ensemble. »
Jim bougonna : « Avant qu’on ne les abandonne, nous autres Occidentaux, une fois le boulot terminé contre les islamistes de Daech, nos ennemis communs… »
Il y eut un silence. Jim se mit à mâchonner son cigare sans plus ouvrir la bouche, le regard perdu dans des pensées qui semblaient très sombres. Je demandai : « Vous avez une idée de ce que sont devenues toutes ces femmes ? Du moins les survivantes ?
— Pas la moindre… Et je ne sais pas pourquoi, ça commence à me tracasser comme si j’y étais pour quelque chose…
— Il n’y a pas de raisons, Jim. Et puis, c’est le passé ; tout ce qui existe est fait pour être oublié un jour, non ? C’est une loi de la Nature… »
Mon boss me regarda d’un drôle d’air en se récriant : « Par pitié, ne philosophez pas à cette heure-ci, Rachel. La vie est assez tragique comme ça… Et n’ajoutez pas que tout ce que nous écrivons est destiné à disparaître, je le sais assez ; je vous ai entendue le dire à Ted l’année dernière et ça m’a fichu le moral en l’air. Mais bon, cessons de nous égarer… » Il reprit les photos, les étala près de la bouteille de scotch, et les considéra encore un long moment, presque scrupuleusement, son double menton calé entre les mains. Il respirait lourdement mais son imposante poitrine enrobée de graisse se soulevait à peine ; enfin, il annonça : « Ces photos ont été prises il y a longtemps déjà mais je les regarde souvent ; voilà des visages qui me touchent de plus en plus – allez savoir pourquoi… Un de nos confrères en Allemagne a écrit je ne sais plus où que chacun d’eux était l’expression d’une tragédie personnelle ancrée dans une histoire collective – et que cette histoire collective était un rêve de liberté ; c’est bien vu, je crois. » Il hésita : « Vous en pensez quoi ?
— J’essaie d’être une bonne journaliste, Jim, et de voir les choses comme nous devons les voir, nous. Si je devais m’occuper de ça, j’écrirais pour nos lecteurs quelque chose du genre : derrière tous ces visages oubliés, il y a des âmes héroïques et généreuses. Par les temps qui courent, ça devrait plaire. »
Jim m’adressa un large sourire, le premier de la journée : « Excellent début, Rachel ; il faut être consensuel dans notre métier, plaire à tout prix et en toutes circonstances… Non, je plaisante… De toute façon vous allez partir là-bas pour faire le contraire : plaire à tout le monde, ça me dégoûte de plus en plus. Je vieillis… Heureusement que le Sydney Match m’appartient. Retrouvez-moi quelques-unes de ces femmes et on racontera leur destin dans les moindres détails – ça vous va ?
— Drôle d’idée, mais bon, c’est vous le patron… Vous me donnez combien de temps, Jim ?
— Tout le temps dont vous aurez besoin. C’est un sujet exceptionnel.
— Et on fera quel nombre de pages ?
— Autant que vous voudrez ; sur plusieurs numéros, même. J’y tiens beaucoup. Et vous écrirez aussi un livre si ça vous chante. » Il s’interrompit puis ajouta à voix basse : « Vous aurez ce que je n’ai pas offert à Ted. »
Je préférai ignorer cette dernière remarque et me contentai de déclarer : « Très bien, boss, tout me va. Finalement, ça peut être excitant. On va faire du bon travail. » Jim hocha sa grosse tête : « Tant mieux ; passez voir ma secrétaire en sortant, elle vous donnera vos billets d’avion et vos frais de voyage – ils sont conséquents, je n’ai pas lésiné. Vous partez demain matin pour Kobané, via Istanbul. Vous commencerez par là, ça me paraît tout indiqué – c’était autrefois une ville kurde. Ensuite, vous tirerez le fil de votre enquête. Les Turcs n’ont pas fait d’histoires pour votre visa ; ils croient que nous allons produire un mirifique reportage sur le bonheur de vivre dans le nord de la Syrie. Je blague à peine ; ne les détrompez pas. Ils vous ont prévu un interprète qui vous attendra à l’aéroport de Kobané, un certain Mohamed. Voilà, vous savez tout. Des questions ? »
Je fis non de la tête.
...............................................;
CHAPITRE II
Je sortis du bureau de Jim avec une drôle d’impression ; où mon boss voulait-il en venir exactement ? Pourquoi me lançait-il ainsi sur les traces des combattantes kurdes ? Il m’avait paru un peu exalté. C’était la façon dont il traitait toutefois les sujets qui le touchaient au plus haut point et je devais me faire des idées. Il avait simplement fait siens les visages de ces drôles de combattantes et il faudrait bien que je m’en accommode. Le mieux était que je reste la plus objective possible – après tout, c’était mon boulot de grand reporter – et tout irait bien.
Le lendemain, j’étais à Kobané.
Je découvris un aéroport minuscule, neuf, et presque vide ; mon premier sentiment fut que je débarquais dans un univers de tristesse compassée : les murs étaient parfaitement ripolinés, le sol de marbre très propre, les plafonds bien éclairés, mais ce décor dégageait une forme de grisaille surprenante. Les policiers étaient peu nombreux et très affables : on ne me posa aucune question. Passé la douane, je ne vis qu’une seule personne attendant les rares passagers : un homme à l’air avenant, tenant une pancarte à mon nom. Il était grand et mince, mal habillé d’un pantalon sans forme, d’un polo rayé trop ajusté, et de mauvaises chaussures dont les bouts étaient écornés ; cependant, les traits de son visage, d’une finesse très particulière, révélaient une élégance à la fois désuète et touchante qu’accentuaient des cheveux gominés coiffés en arrière. Il portait une moustache taillée avec soin, des lunettes à fine monture, et ses grands yeux sombres me dévisagèrent avec gravité dès que je m’avançai vers lui : « Madame Rachel, je suis Mohamed ; bienvenue à Kobané. »
Un je-ne-sais-quoi me frappa d’emblée : « Je m’attendais à être reçue par un représentant turc ou un milicien islamiste », lançai-je, vaguement provocatrice.
Mohamed secoua la tête, manifestement gêné – une lueur d’inquiétude avait traversé son regard : « Oh, c’est la même chose, madame Rachel ; je suis kurde, mais cela ne compte pas. Ici, nous sommes tous des musulmans syriens, même si les islamistes turcs dirigent tout. Donnez-moi votre sac, une voiture nous attend avec un chauffeur. C’est aussi un Kurde ; nous vous emmenons à la guest house du gouvernement. » Je répondis poliment : « Ah, très bien », et Mohamed précisa, très déférent : « Vous êtes une invitée d’honneur de notre gouvernement local et nous sommes à votre disposition pour toute la semaine. Notre programme de visite est chargé. »
Dehors, la chaleur était accablante ; nous étions en juillet et le soleil se trouvait déjà haut dans le ciel – ce qui n’arrangeait rien.
Pas le moindre souffle de vent ne venait atténuer cette chaleur ; tout était sec, brûlant, et la lumière, presque aveuglante, ricochait de partout ; je me fis la réflexion que si des arbres avaient poussé là, ils se seraient enflammés à la moindre étincelle – mais je ne vis aucun arbre nulle part.
Le chauffeur s’appelait Ahmed. C’était un petit homme noiraud, silencieux et renfrogné, avec des jambes arquées et des bras énormes, comme artificiellement greffés de part et d’autre de son torse parfaitement rectangulaire. Il n’allait pas prononcer plus de trois mots au cours de mon séjour, se contentant de grognements indistincts pour dire bonjour et bonsoir. Ce drôle de personnage jeta mon sac à l’arrière d’un 4 × 4 dernier cri et Mohamed s’installa près de lui ; aussitôt, la voiture fila sur une route rectiligne et bien goudronnée, traversant une interminable plaine couleur de glaise, elle aussi dénuée de toute végétation digne de ce nom ; des mirages de chaleur flottaient au-dessus du sol en tremblotant et s’évanouissaient lorsque nous nous en rapprochions. La ville était encore loin.
Peu avant d’y parvenir, j’aperçus en contrebas de la route quelque chose qui me sembla être un grand cimetière abandonné. Mohamed, qui m’observait à la dérobée dans le rétroviseur, devança ma question : « C’est l’ancien cimetière militaire de Kobané, madame Rachel. Il ne sert plus à rien depuis la fin de la guerre ; le ministère de l’Intérieur l’a fermé.
— Ah ? fis-je, étonnée, fermé ? C’est étrange, les cimetières, ça ne ferme pas, habituellement… Qui est enterré là, au juste ? »
Mohamed parut embarrassé : « Beaucoup de gens… Des terroristes kurdes… Des hommes et des femmes mélangés. Avant, au temps du Rojava, on appelait ces hommes Yapagués et ces femmes Yapajas. C’est fini, maintenant.
— J’aimerais bien visiter ce cimetière, Mohamed. »
Il m’adressa une moue désolée : « Ce n’est pas prévu dans notre programme, madame Rachel, et on ne peut pas le changer ; de toute façon, c’est sans importance. Voilà, nous arrivons à la guest house – vous verrez, elle est confortable et nous disposons de la climatisation. »
Toute la semaine suivante, Mohamed me traîna dans Kobané et ses environs ; bientôt, je sus tout du développement économique de la région, du réseau d’adduction d’eau entièrement refait, des routes rénovées, des maisons réhabilitées, de l’hôpital reconstruit, des écoles rouvertes. On m’assura que près d’un million d’Arabes réfugiés en Turquie pendant la guerre avaient été réinstallés dans des colonies agricoles après qu’on eut chassé de leurs terres les terroristes kurdes et leurs familles – ce qu’ils avaient amplement mérité. Le gouvernement comptait même ouvrir des dizaines de fermes d’élevages dès que les budgets seraient débloqués par Ankara. Je pouvais vérifier par moi-même que le prétendu nettoyage ethnique du nord de la Syrie était un pur mensonge colporté en Occident par les quelques groupes de bandits qui avaient réussi à survivre ici ou là.
Je trouvai la ville de Kobané elle-même dépourvue du moindre charme ; on avait rasé une bonne partie des anciennes maisons traditionnelles et construit à la place de petits immeubles tarabiscotés, tous identiques et sagement alignés. J’avais lu dans ma documentation que de nombreux cafés existaient autrefois,mais je n’en aperçus aucun. Les rares femmes dans les rues étaient toutes voilées.
Au troisième jour, je fus reçue par le maire – une sorte de géant à la barbe immense et broussailleuse, qui refusa poliment de me serrer la main. Quand je lui demandai combien de Kurdes vivaient encore sous sa juridiction et pourquoi je n’en avais quasiment pas rencontré hormis quelques responsables de seconde zone, il m’affirma avec un sourire doucereux : « Quand nous avons repris cette région en 2019, notre président a rappelé une vérité oubliée : ces plaines ne conviennent pas aux Kurdes, elles ne sont pas faites pour eux ; ce dont ils ont besoin, c’est de montagnes. Alors, la plupart des Kurdes nous ont écoutés et sont partis. Vers l’Irak en majorité, chez leurs cousins. Quelques-uns ont quand même voulu rester et nous avons accepté qu’ils collaborent avec nous comme des frères. »
Mohamed avait écouté, tête baissée, silencieux, les mains croisées dans le dos ; dès que nous fûmes sortis de la mairie, il me chuchota : « Moi, madame Rachel, j’ai eu de la chance ; j’ai pu rester parce que j’étais marié à une Arabe ; ça m’a sauvé et je n’ai pas perdu ma maison même si la vie est difficile quand on est kurde ; c’est redevenu comme avant la guerre. »
Cependant, il semblait tourmenté par autre chose encore. J’en découvris la raison lorsque je remontai dans la voiture : « Vous vous souvenez du cimetière que vous vouliez voir le jour de votre arrivée ? me dit-il. Eh bien, j’ai changé d’avis. Je vais vous y emmener demain, pour votre dernier jour à Kobané ; quand vous le visiterez, vous comprendrez certaines choses. Nous irons là-bas au moment de la prière du soir, quand personne ne fera attention à nous – il ne faudra pas rester longtemps. Ensuite, nous partirons à l’aéroport. Votre vol pour Istanbul est à 21 heures. »
Je ne pus m’empêcher de serrer son bras : « Merci Mohamed. Je commençais à désespérer de découvrir quelque chose qui puisse vraiment me parler… »
Il eut un sourire sans joie : « Mes parents ont disparu lorsque les gens que vous avez rencontrés, comme ce maire, se sont emparés de la ville. Je n’ai jamais su ce qu’ils étaient devenus. Je suis faible et je ne les ai jamais vengés. »
...............................................................................................................................................................
Bio:
Patrice Franceschi est un écrivain-aventurier français (membre des Écrivains de Marine depuis 2014) né le 18 décembre 1954 à Toulon. Il est également aviateur, marin, cinéaste, parachutiste et officier de réserve.
Il a reçu le 5 mai 2015 le prix Goncourt de la nouvelle pour son livre Première personne du singulier.
Principales expéditions
1975 : Expédition Babinga-Pongo - Pygmées du Congo
1976 : Expédition Yacumo - Indiens Macuje d'Amazonie
1978 : Expédition Néferkara - Le Nil de la source à la mer
1984 - 1987 : 1er tour du monde en ULM
1989 : Raid Papou - Papous de Nouvelle-Guinée
1990 : Participation à la révolution roumaine à Bucarest
1990 : Expédition Thylacine - À la recherche du tigre de Tasmanie
1994 : Expédition Wapoga 1 et 2 - Papous de Nouvelle-Guinée
1994 : Expédition Kihiri - Papous de Nouvelle-Guinée
1995 : Expédition Nabuabu - Papous de Nouvelle-Guinée
1996 : Expédition Otavella - Indiens Macuje d'Amazonie colombienne
1998 : Expédition Naga - Haute-Birmanie
1999 - 2001 : Campagne d'exploration de la jonque La Boudeuse - Asie-Pacifique
2004 - 2007 : Expédition «A la rencontre des peuples de l'eau» La Boudeuse - Circumnavigation
2009 - 2010 : Mission «Terre - Océan» - Grenelle de la Mer La Boudeuse - Amérique du Sud
2013 : Nouvelles expéditions chez les Sakuddeï des îles Mentawaï et chez les Saa de l'île Pentecôte au Vanuatu
2016 : Nouvelle expédition chez les Saa de l'île Pentecôte au Vanuatu
Livres
Au Congo jusqu'au cou, Fernand Nathan, 1977; réédité sous le titre Quatre du Congo, Archipoche, 2013 et dans Premières expéditions, Points P4790, 2018
Terre Farouche, récit, Fernand Nathan, 1977; réédité dans Premières expéditions, Points P4790, 2018
Au long cours, poésie, Éditions St-Germain des Prés, 1978
L'Exode vietnamien, récit, Arthaud, 1979
Ils ont choisi la liberté, récit, Arthaud, 1980
Guerre en Afghanisan, essai politique, La Table ronde, 1984
Un capitaine sans importance, roman, Robert Laffont, 1987; réédition par Pocket, 2008 et Points P2899, 2012
La Folle Équipée, récit, Robert Laffont, 1987; réédition Éditions J'ai Lu n. 8797, 2008
Qui a bu l'eau du Nil, Robert Laffont, 1989; réédition Éditions J'ai Lu, n. 2984, 1991, Archipoche 2013, et dans Grandes traversées, Points P4791, 2018
Raid Papou, récit, Robert Laffont, 1990; réédition par Archipoche en 2013 et dans Grandes traversées, Points P4791, 2018
Paona: une orpheline dans la tourmente roumaine, récit, avec Alain Boinet et Domitille Lagourgue, Éditions de l'Archipel, 1991
Chasseur d'horizon : vivre autrement, album, Filipacchi, 1991
De l'esprit d'aventure, essai, avec Gérard Chaliand et Jean-Claude Guilbert, Arthaud, 2003; réédition Points 4418, 2016
L'Homme de Verdigi, roman, Archipoche, 2008; réédition Points P3294, 2014
La Dernière Manche, roman, La table Ronde, 2008; réédition Points P4457, 2016
La grande aventure de La Boudeuse, Mon tour du monde à la rencontre des peuples en péril, Éditions Plon, 2008 (ISBN 978-2-259-19755-7)
Le Chemin de la mer, et autres nouvelles, nouvelles, Éditions de l'Aube, 2009; réédition Grasset, 2019
Avant la dernière ligne droite, Éditions Arthaud, 2012; réédition Points P3024, 2013
Le Regard du singe: Esprit d'aventure et modernité, essai, avec Gérard Chaliand et Sophie Mousset, Ed. Points, P3126, 2013 (ISBN 978-2-7578-3196-0)
Quarante ans d'esprit d'aventure : 4 grands récits d'expédition, Archipoche, 2013 (reprend en un seul volume Raid papou, Terre farouche, Quatre du Congo et Qui a bu l'eau du Nil).
Première personne du singulier, nouvelles, Ed. Points, P4046, 2015 (ISBN 978-2-7578-4973-6); réédition suivi de La ligne de démarcation, Points P4321, 2019
Mourir pour Kobané, Éditions des Équateurs, 2015 (ISBN 978-2-8499-0378-0) - 2e éd., Tempus Perrin, 2017 (ISBN 978-2-262-06999-5)
Il est minuit, monsieur K, Ed. Points, P4238, 2016 (ISBN 978-2-7578-5766-3); réédition Points P4540, 2017
Trois ans sur la dunette, Ed. Points, P4690, 2017 (ISBN 978-2-7578-6933-8)
Combattre !, manifeste politique26, Éditions de La Martinière, 2017
Dernières nouvelles du futur : quatorze fables sur le monde à venir, Grasset, 2018 (ISBN 978-2-246-81503-7) ; réédition Points P4937, 2019 (ISBN 978-2-7578-7443-1)
Éthique du samouraï moderne, Grasset, 2019 (ISBN 978-2-246-81701-7)
La Vie que j'ai voulue, Seuil, 2019 (ISBN 978-2-021-31638-4) (une édition collector et numérotée27 est parue en 2020)
Bonjour Monsieur Orwell, le contrôle numérique de masse à l’heure du Covid-19, Gallimard, 2020
Avec les Kurdes. Ce que les avoir abandonnés dit de nous, Gallimard, 2020
Filmographie sélective
La Vallée Perdue – France 3
Retour chez les Macuje – France 2
Nagaland interdit – France 3
Les 33 Sakuddeï – France 2
Sur la piste de Wallace – France 2
Les mystères de la Sungaï Baï – France 2
Au-dessus des Volcans – France 2
Sous le vent de Bougainville – France 2
L’Odyssée de La Boudeuse – France 2
Le dernier voyage de La Boudeuse – France 2
On les appelle Yuhup – France 5
A l’ombre des Géants – France 5
Ces Hommes du Paradis – France 5
Ceux de Fatu Hiva – France 5
Au pays des Saa – France 5
Les bâtisseurs de la mer – France 5
L’archipel des Jarangas – France 5
Les fils de Sindbad – France 5
Au vent de la Guyane - France 5
L’or de Ouanary - France 5
Oyapock - Voyage
Raïba et ses frères - France 5
Trente saisons à Pentecôte - France 5
Trois Saa et puis la France - France 5
Distinctions
Chevalier de la Légion d'honneur28
Chevalier du Mérite maritime29
Médaille des services militaires volontaires
Médaille de l'Académie de Marine
Lauréat de l'Académie française (prix Broquette-Bonin)
Médaille d'or de l'Académie des sports
Victor de l'aventurier
Prix Liotard de la Société des explorateurs français
Grande médaille de l’exploration de la Société de Géographie28
Prix Relay 1993 pour Quelque chose qui prend les hommes30
Écrivain de Marine (2014).
Prix Goncourt de la nouvelle (2015) pour Première personne du singulier
Les soeurs de Montmorts
RÉSUMÉ
Novembre 2021. Julien Perrault vient d’être nommé chef de la police de Montmorts, village isolé desservi par une unique route. Alors qu’il s’imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d’une propreté immaculée, et équipé d’un système de surveillance dernier cri.
Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme.
Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des Morts qui surplombe le village ? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants ? Les décès violents qui jalonnent l’histoire des lieux ?
.....................
Il arrive parfois que certains auteurs proposent une liste de chansons ou musiques à écouter avant la lecture. Je trouve l’idée originale et intéressante puisque dans mon cas, avant de me mettre à écrire, j’écoute toujours des titres qui collent à l’atmosphère de mon histoire et qui m’aident à me concentrer. Mais, si vous le permettez, poussons l’idée un peu plus loin. Imaginons que les titres que je vous propose correspondent non pas à l’idée générale du roman, mais à des lieux et des personnages précis. Un peu comme les livrets de pièces de théâtre où l’on indique des liens de parenté ou des détails sur les personnages avant le premier acte. Libre à vous de les écouter (de manière légale, bien entendu) ou non. Mais essayez peut-être avec la première d’entre elles, et sachez que cette « expérience » pourrait se révéler utile dans votre lecture…
.................................................................................................................................................................
EN CHEMIN (1)
— Où allons-nous ? demanda Camille en se tournant vers la conductrice.
Depuis qu’elles avaient quitté le parking souterrain, celle-ci n’avait prononcé presque aucune parole. Elle s’était contentée de conduire, le visage marqué par une extrême fatigue qui lui pâlissait la peau comme la plus sournoise des maladies.
— Dans le mail que je vous ai envoyé, répondit Élise sans dévier son attention de la route, je vous ai écrit que j’allais vous fournir l’histoire la plus effroyable que vous ayez entendue. Mais comme tout fait réel, il faut que j’appuie mes dires sur des preuves, sinon vous seriez incapable de me croire. Vous me traiteriez de folle et de menteuse.
— Vous n’aviez pas précisé que nous devrions sortir de la ville, remarqua Camille, en scrutant les alentours à travers la vitre de la voiture.
— C’est vrai, j’aurais dû, reconnut Élise, en tournant la tête pour lui adresser un faible sourire. Mais une fois sur place, vous comprendrez. N’ayez crainte, il ne s’agit nullement d’un guet-apens ou de je ne sais quoi. Vous n’avez pas à avoir peur.
La peur se lit-elle sur mon visage ? songea Camille en détournant son attention par-delà la vitre et le paysage qui défilait. Au travers de ma voix mal assurée ? Non, je n’ai pas peur, je suis simplement curieuse et… mal à l’aise de me retrouver assise à côté d’une inconnue.
Par un réflexe enfantin, elle abaissa le miroir de courtoisie du véhicule pour vérifier la bonne prestance de son visage. Elle n’y remarqua aucun signe de fragilité. Ses yeux en amande d’un marron profond demeuraient fixes, sûrs d’eux. Son teint n’avait pas blêmi et ses lèvres ne tremblaient pas. Son trouble n’était donc qu’intérieur.
La voiture quitta les artères du centre-ville et atteignit rapidement la banlieue. Les rues éclairées par les dizaines de devantures lumineuses s’étaient muées en quartiers sombres et déserts, puis les lampadaires blafards disparurent à leur tour pour laisser aux champs et à la lune pleine le soin de veiller sur elles. Camille pensa à ce mail reçu une semaine auparavant sur sa boîte professionnelle :
Je peux vous offrir le premier scoop de votre courte carrière. En lisant cette phrase, vous penserez certainement à une mauvaise plaisanterie, mais ce n’est pas le cas. Je suis sérieuse. D’ailleurs, pour vous montrer ma bonne foi, je vais vous donner une indication, une sorte d’amuse-bouche qui vous mettra en appétit. Vous avez sans aucun doute entendu parler des supposés évènements qui se sont produits dans le village de Montmorts, il y a deux ans. Bon nombre de médias ont tenté de comprendre le déroulé des faits. Hallucination collective ? Complot de l’État ? Sorcellerie ? Bien sûr, tous se sont heurtés au silence et aux avocats du propriétaire du village. Je peux vous révéler ce qui s’est réellement passé. Et j’ai choisi de vous offrir ce cadeau sans aucune contrepartie. Vous pouvez décider de me faire confiance ou de m’ignorer. Mais une fois en route, il vous sera impossible de quitter le chemin de la vérité. Je vous attendrai lundi prochain, à vingt heures, dans le parking souterrain public de la rue Saint-Exupéry. Cherchez une Volkswagen Polo noire, au deuxième sous-sol.
La journaliste avait hésité. Mais plus elle relisait le message, plus son envie de savoir grandissait. Le lendemain, elle décida qu’elle n’avait rien à perdre. Au pire, elle gâcherait une heure de son temps, et au mieux elle pouvait lancer sa carrière.
— Vous voyez, reprit Élise d’une voix atone, imaginez que je vous dise que cette nuit, alors que je dormais, un grincement lugubre provenant du grenier m’a réveillée. Vous me croiriez, n’est-ce pas ?
— Oui, bien sûr.
— Mais si je vous avouais que ce grincement est dû à la présence d’un fantôme dans ce même grenier, vous auriez beaucoup plus de mal à me prendre au sérieux ?
— Dans ce cas, oui, avoua Camille.
— Eh bien, nous sommes exactement dans ce cas de figure. Ma seule chance de vous convaincre est de vous montrer ce fantôme et non pas de me contenter de vous décrire le bruit d’un parquet centenaire qu’un esprit s’évertue à faire craquer dès que mes yeux se ferment.
— Je ne crois pas aux fantômes, déclara la journaliste, sans toutefois savoir si cela était vrai.
Elle ne s’était simplement jamais posé la question.
— Vraiment ? Peut-être parce que vous n’en avez jamais vu… Mais avant d’arriver à la conclusion de mon histoire, je vais profiter de ces deux heures de route pour vous la présenter dans son intégralité. S’il vous plaît, cherchez sous votre siège et prenez ce qui s’y trouve.
Camille s’exécuta. Elle se pencha et découvrit une chemise cartonnée orange qu’elle posa sur ses genoux et de laquelle elle sortit des pages dactylographiées, reliées par des agrafes en métal épais. La journaliste souleva la page de garde et découvrit les premiers mots : Acte 1. Dessine-moi un mouton !
— Il y a un peu plus de deux cents pages, précisa Élise, en observant du coin de l’œil sa passagère qui feuilletait déjà le contenu. Je vais vous laisser les lire pendant que je conduis. Évitez de me demander des précisions, toutes vos réponses apparaîtront à notre arrivée. Une fois sur place, je vous montrerai les preuves. Et je vous poserai alors cette question : croyez-vous toujours que les fantômes n’existent pas ?
............................................................;
ACTE 1 :
DESSINE-MOI UN MOUTON !
FAIT NUMÉRO UN
L’aspirine, sous sa forme actuelle, existe depuis plus de cent ans. Cependant, grâce à l’un des traités médicaux les plus anciens, le papyrus Ebers, on date son utilisation, sous forme de décoction, à plus de trois mille cinq cents ans. Tout d’abord en Égypte, puis en Grèce antique par Hippocrate, l’aspirine, ou acide acétylsalicylique, fut utilisée et conseillée à travers les siècles. L’aspirine agit sur le cerveau en bloquant les hormones qui d’habitude envoient des messages électriques aux récepteurs de la douleur.
Elle provient de l’écorce de saule blanc, un arbre réputé en sorcellerie puisque c’est avec son bois qu’étaient confectionnées les tresses reliant le manche à la brosse des balais de sorcières.
...............................................;
1
Montmorts, le 12 décembre 2019
Vincent observa le ciel, laissant les flocons s’échouer contre son visage. Les nuages, d’un blanc laiteux, saupoudraient la campagne avec prudence et retenue. Le jeune garçon savait que plus tard, à la nuit tombée, le vent et la neige engendreraient des bourrasques d’hiver tumultueuses qui recouvriraient les toits de Montmorts, ainsi que les champs avoisinants, d’un duvet solide et rigide. Il ne leur restait que quelques heures, deux ou trois au maximum, pour mettre les bêtes à l’abri. À travers le brouillard qui s’élevait du sol, confondant terre et ciel, il chercha Jean-Louis du regard. Sa silhouette spectrale apparut non loin de l’enclos. Vincent comprit que son comparse s’ébrouait déjà à diriger les moutons vers l’étable et courba les épaules pour le rejoindre. Cela faisait maintenant deux ans qu’ils travaillaient ensemble. Le métier de berger n’était pas le plus simple, surtout pour un jeune homme de vingt ans. Mais devenir apprenti agricole lui permettait de se payer ce que ses parents ne pouvaient lui offrir. Une voiture, de l’alcool ‒ du bon alcool, pas celui servi chez Mollie ‒, et surtout l’attention des jeunes filles de son âge qui cherchaient toujours un véhicule pour les conduire aux boîtes de nuit des villes voisines. Un jour, se promettait Vincent tous les matins en enfilant son bleu de travail, j’aurai assez d’argent pour que Sybille s’intéresse à moi. Je m’achèterai des livres, les mêmes qu’elle possède, et nous discuterons de ses auteurs préférés, Camus, Sartre, Saint-Exupéry, en dégustant un bon dîner…
Il en discutait parfois avec Jean-Louis, son collègue. Le vieil homme, même s’il n’avait jamais pu connaître son âge exact (quarante ans ? cinquante ?), celui-ci repoussant toute tentative d’un « ce n’est pas ton affaire », l’encourageait à poursuivre ses rêves. Et malgré sa rudesse apparente, il lui intimait de ne jamais lâcher ce à quoi il croyait. Son « tuteur » ajoutait souvent, avec un sourire encourageant : « P’t-êt’ ben que cette fille elle comprendra qui tu es vraiment et que je me retrouverai seul à parquer les moutons. » Chaque fois que le berger prononçait cette phrase, Vincent ressentait un picotement au cœur. Jean-Louis avait beau être un personnage bourru, à l’attention trop dirigée vers la bouteille ‒ contenant du mauvais alcool, celui de Mollie ‒, il savait au fond de lui que ce n’était pas un vilain bougre. Beaucoup dans le village le trouvaient distant, rustre, malpoli. « Parfois, certaines personnes ne savent simplement pas comment parler aux gens, et cela en froisse quelques-uns, surtout ceux qui ne comprennent pas vraiment ce qu’est le métier de berger », se répétait Vincent lorsqu’une de ces critiques s’échouait à ses oreilles.
Il mit sa main droite en visière, et repéra de nouveau l’ombre massive de Jean-Louis. Sa main dansait dans l’air glacial en tenant sa baguette de saule, donnant des ordres aux moutons comme un chef d’orchestre le ferait avec ses musiciens. L’écho de ses injonctions brèves et précises vola jusqu’à lui et Vincent leva son bâton pour motiver à son tour les quelques récalcitrants.
— Il manque trois agneaux ! lança Jean-Louis d’une voix tonique afin d’assourdir le bruit du vent qui soufflait de plus en plus.
Il fallait les retrouver avant la nuit, sans quoi les loups ou le froid s’occuperaient d’eux. Vincent jeta un regard circulaire. Le champ dans
lequel paissaient les moutons n’était pas très vaste. Mais de nombreux arbres et buissons, ainsi qu’une herbe épaisse et drue, pouvaient tout à fait servir d’abris et rendre les bêtes invisibles.
— Je vais par là ! indiqua Vincent en désignant le côté sud et le mur de pierre que formait la base de la montagne de Montmorts.
Il fit quelques pas dans la terre humide en direction de la paroi minérale et s’arrêta un court instant pour lever les yeux jusqu’à la crête. Il ignorait qui avait décidé de définir ce relief en tant que montagne. Pour lui, il s’agissait plutôt d’un immense rocher, et même s’il ne parvenait pas à fixer le pic, notamment parce que les nuages bas qui s’amoncelaient contre son flanc lui bloquaient la vue, il savait qu’il ne mesurait que cent trente-sept mètres de haut, bien en dessous des normes d’une montagne.
Vincent avança prudemment en épiant le moindre mouvement. Arrivé à quelques pas de la paroi rocheuse, il s’arrêta, prenant conscience de l’endroit où il se trouvait. Sur sa droite, le squelette métallique des grilles de l’ancien cimetière dessinait une frontière à ne pas franchir, un lieu dont personne ne s’approchait plus depuis des siècles. Instinctivement, il leva une nouvelle fois la tête en direction des nuages pour apercevoir l’extrémité de la montagne. C’est de là-haut, selon ce que sa mère lui avait raconté, gamin (comme elle l’avait entendu par son propre père, comme tous les habitants de Montmorts l’avaient entendu de leurs aïeux), que l’on jetait autrefois les condamnés. Le jeune apprenti tenta de chasser ces pensées de son esprit, mais il ne le put complètement. Sans en avoir pleinement conscience, il s’avança un peu plus vers la roche nue qui luisait d’humidité. Vincent tendit la main avec la ferme intention de poser sa paume contre la roche, d’en caresser la peau rugueuse et de défier ainsi les superstitions qui prétendaient que cette montagne, tout comme le village, était maudite. Encore quelques centimètres, s’encouragea-t-il en longeant la grille de l’ancien cimetière, les sorcières n’existent pas et n’ont jamais existé, ce ne sont que des histoires pour effrayer les enfants, ces enfants qui plus tard trouveront le chemin qui longe la crête de cette minuscule montagne et s’y rendront, comme moi, pour surplomber le village et vider des bouteilles en se moquant de ces superstitions puériles…
Alors que, du bout des doigts, il s’apprêtait à ressentir le contact de la pierre, une voix puissante le sortit de sa torpeur :
— Vincent, je les ai trouvés ! Viens m’aider à parquer le troupeau !
Le garçon mit quelques secondes à réaliser ce qu’il était sur le point de faire. Il fixa ses pieds et se hâta de quitter cette zone où des squelettes centenaires dormaient sous quelques centimètres de terre, car comme il le savait (comme tout le monde à Montmorts le savait), plusieurs n’avaient pas été inhumés, mais simplement laissés sur place, les os brisés par la chute.
— Merde, qu’est-ce que je fous là… ? pesta-t-il en s’éloignant de la montagne. C’est comme si je m’étais approché malgré moi, comme si j’avais été aimanté…
Il courut jusqu’à Jean-Louis, masquant son trouble, cachant son soulagement de ne plus être seul dans l’ombre du massif rocheux.
— Qu’est-ce qu’il y a, tu as vu un fantôme ou quoi ?
— Non, c’est juste une migraine, sans doute le froid…
— Faut te couvrir, je te le dis à chaque fois ! lui conseilla le berger en donnant un coup de trique au dernier mouton récalcitrant.
— Dis-moi…, lui demanda Vincent, ne pouvant s’enlever de la tête la sensation dérangeante qui le troublait encore. Il tournait le dos à la montagne comme un nageur fuirait une vague démesurée. Tu as déjà entendu les légendes du coin, sur Montmorts, cette ridicule montagne et les forêts autour ?
— Oh oui, tous les soirs en buvant un coup chez Mollie ! s’amusa Jean-Louis. Mais tu sais, gamin, contrairement à toi, je ne suis pas du coin… alors toutes ces balivernes… Allez, je vais fermer l’étable, attends-moi là…
Le vieil homme, qui en fait n’était âgé que de cinquante-deux ans, se trouvait penché au-dessus de son baluchon quand une bourrasque colérique hurla à travers les bois environnants, fouetta leurs silhouettes et vint s’échouer contre la pierre.
— Merde, elle va nous filer la mort, celle-là ! s’exclama Vincent. La première tournée sera pour moi, j’ai besoin de me déglacer le sang ! Jean-Louis ?
Son collègue ne bougeait plus. À le voir ainsi, immobile, les mains figées dans son sac, le garçon crut qu’il se payait sa tête. Ça lui arrivait de temps en temps, quand il était de bonne humeur… ou ivre. Il faisait semblant de ne plus pouvoir bouger, certainement pour se venger du fait que son jeune compagnon le taquinait régulièrement sur son âge « avancé »…
— Allez, on se les caille, ne te fiche pas de moi…
Lentement, tel un mime ridicule, Jean-Louis se tourna vers Vincent, sans prononcer le moindre mot. L’apprenti fut tenté de lui taper l’épaule avec son poing pour qu’il cesse sa blague, mais toute intention disparut quand il remarqua son regard : ses prunelles étaient réduites à de simples cercles minuscules, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Mais ce qui glaça Vincent fut que le berger ne le fixait pas, lui, mais la montagne derrière lui, hypnotisé par la façade de granite et de calcaire.
— Jean-Louis… qu’est-ce qui t’arrive ?… Tu… tu pleures ?
Jamais il n’avait vu ce colosse trembler, se plaindre du froid ou du vent, reculer devant quoi que ce soit. Le berger était pour lui un roc, bien plus costaud et solide que cette montagne. Un homme aux muscles vigoureux et infatigables… Que se passait-il pour qu’un tel géant se mette soudainement à pleurer, comme il s’en rendit compte alors que Jean-Louis sortait son couteau de chasse de son barda ?
— Maintenant tu restes là, gamin, tu as compris ?
— Ou… oui, mais…
— Ça a commencé, ajouta le berger dans un murmure à peine perceptible. Je sais qui je suis et ce que j’ai fait… Il est déjà trop tard, c’est ce que disent les saules…
— Qu’est-ce que tu… ?
— Ne les vois-tu pas ?! hurla Jean-Louis, le regard devenu fou. Il fixait un point invisible vers le sol, à quelques mètres seulement de Vincent.
— Quoi… qui… ? Je ne vois personne ! balbutia le garçon en tournant la tête dans tous les sens.
— Mes enfants, murmura le berger, regarde…
Puis, après un bref sourire empli de tristesse, il se détourna de l’apprenti et se dirigea vers l’étable, marquant de ses empreintes la terre recouverte d’une fine couche de neige. Vincent le suivit du regard tétanisé par ces paroles, statufié par la vue du couteau et de sa lame épaisse.
Jean-Louis disparut dans l’abri et aussitôt les bêlements inquiets des moutons se muèrent en plaintes de souffrance et de mort. Le gamin demeura debout dans le froid un long moment, incapable d’esquisser le moindre geste, incapable de comprendre la scène qui se déroulait devant lui. Ce ne fut que quelques minutes plus tard, lorsque le berger sortit de l’étable, le corps entièrement couvert de sang tiède et vaporeux, que Vincent se mit à courir comme un damné en direction du bar de Mollie, fuyant à grandes enjambées la montagne silencieuse et les derniers soupirs des animaux.
..........................................................;
Les chroniques de Montmorts, par Sybille
Laissez-moi vous présenter mon village.
Montmorts est comme un manoir ancestral dont les occupants seraient pris au piège à l’intérieur de murs épais. Loin de s’en attrister, chacun vaquerait à ses occupations et observerait avec reconnaissance le pic qui surplombe l’horizon telle une stèle géante destinée à rappeler aux vivants l’importance des morts.
Car Montmorts n’est autre que le diminutif de la montagne des morts. Autrefois, ce village portait certainement un autre nom, que les souvenirs et les livres d’histoire n’ont pas retenu. Faisant suite aux procès en sorcellerie de Sancerre, d’Aix-en-Provence, puis de Loudun un demi-siècle plus tard, Montmorts fut un temps sujet à l’hystérie collective. En 1696, les habitants entendirent les murmures d’une rumeur selon laquelle une mère de famille, Louise, et ses quatre filles, étaient capables de soigner n’importe quelle douleur humaine. Il suffisait de se prêter à une sorte de purification en s’allongeant nu sur le sol. Une fois terminées les différentes incantations incompréhensibles de la mère et ses quatre filles, le malade devait boire une concoction épaisse élaborée à base d’écorce de saule blanc. Si, au début, aucun membre du village ne sembla prêter attention aux témoignages des patients de Louise, la rumeur selon laquelle cette femme usait de sorcellerie enfla lorsque le maire prit connaissance de faits identiques en diverses régions de France. En 1698, un nom à consonance étrangère, Salem, vint étayer l’idée que ce phénomène ne se résumait plus à quelques régions françaises, mais se propageait dans d’autres pays. Le mal était là, et il prospérait. Le maire décida donc d’endiguer la maladie en condamnant à mort la famille entière. Une parodie de procès fut mise en place. On reprocha aux cinq suspectes, outre le fait de proférer des incantations soufflées par le Malin, de se livrer à des débauches sexuelles lors des nuits de sabbat, de corrompre les esprits et de rendre amnésiques les hommes du village. En effet, que ce fût pour une fièvre, des maux de tête ou des douleurs de tout autre genre, les victimes juraient n’avoir que très peu de souvenirs quant à leur entretien avec Louise.
La sentence fut prononcée et les coupables traînées jusqu’au pic qui dominait le village depuis le jour où Dieu avait décidé de peupler la Terre. Les corps de la mère et des quatre sœurs chutèrent et s’écrasèrent contre le sol gelé, en émettant des craquements lugubres dont les échos remontèrent le long de la roche pour résonner aux oreilles de ceux qui venaient d’observer l’exécution avec un enthousiasme communicatif. Durant les mois suivants, beaucoup penseront que c’est à ce moment précis que les sorcières avaient lancé leur malédiction. Qu’à travers les craquements de leurs squelettes, elles avaient engourdi l’esprit des hommes au point que ceux-ci se mettent à suspecter la grande majorité des femmes d’être également des sujets du diable. D’autres sorcières, du moins supposées telles par un voisin, un amant ou parfois même un mari, furent jetées du haut du pic qui devint alors la montagne des morts, puis, avec le temps, Montmorts.
L’hystérie perdura jusqu’au début du dix-huitième siècle, jusqu’à ce que le vivier de sorcières fût tari par la folie des hommes et que Montmorts fût abandonné par les derniers habitants.
Voilà pour le côté historique de ce village, passons à sa géographie.
Montmorts est une enclave, un cul-de-sac, un amoncellement de maisons prises au piège entre deux massifs forestiers, le grand tertre et le petit tertre, avec pour mur infranchissable dans sa partie sud, cette montagne des morts. Une seule route vous amène ici, la départementale 1820 qui sinue tel un serpent capricieux entre les massifs montagneux dans lesquels elle a été creusée pour arriver par le nord.
Certains d’entre nous se souviennent des mythes et légendes à l’origine de la création de Montmorts. D’autres s’en contrefichent et n’en parlent jamais, ni n’écoutent les paroles de ceux qui ont entendu leurs parents décrire ce qu’eux-mêmes avaient entendu de leurs propres parents. De là est née la fameuse expression des Montmortois, qui définit qu’un sujet n’est pas assez important pour qu’on y prête attention : ce n’est que flocon de neige.
Alors oui, les sacrifices, les prétendues sorcières, le cimetière vieux de plusieurs centaines d’années établi juste en bas de la montagne, parce que à l’époque il était plus pratique d’enterrer les morts à l’endroit exact où ils venaient de chuter, tout cela pour beaucoup n’est que flocon de neige. Inutile, provenant d’un passé révolu, le pic ne représente à présent qu’un gros rocher surnommé pompeusement montagne, qui bloque la brume rejetée par le grand et le petit tertre, suinte d’humidité et cache le coucher de soleil.
Ce village, c’est le mien. J’y suis née.
Je l’aime comme une partie intégrante de mon propre corps et jamais je ne me résoudrai à le quitter. Alors tant pis si pour certains d’entre vous ces phrases demeurent futiles. J’ai décidé d’écrire sur ce blog les chroniques de ce vieux manoir qu’est Montmorts, de lui rendre hommage afin que son histoire ne s’éteigne jamais.
Tout le reste n’est que flocon de neige.
P.-S. : Ah si, un petit évènement dans notre village ! Dans trois jours le nouveau chef de la police municipale arrive pour remplacer notre regretté ancien fonctionnaire. Je compte sur chacun de vous pour lui réserver le plus agréable des accueils !
........................................................;
2.
Montmorts, le 10 novembre 2021
À sept heures quinze, Julien se trouvait déjà attablé dans le salon de l’auberge. Mollie lui apporta son café en traînant les pieds, ses chaussons frottant le sol tels les sabots d’un âne récalcitrant, et ne répondit aux salutations du fonctionnaire que par un bref raclement de gorge. Elle disparut ensuite après avoir remis une bûche dans le feu de la cheminée, pourtant bien ravitaillé, comme pour préciser par ce geste qu’elle ne reviendrait pas avant un long moment. Le policier se trouvait seul dans la pièce, et ne douta pas un instant qu’il demeurait l’unique pensionnaire de l’endroit. Il jeta un coup d’œil en direction du bar où trônait un amoncellement de verres que la propriétaire n’avait sans aucun doute pas eu le courage de nettoyer la veille. Choisir cette auberge le temps que les déménageurs transportent l’intégralité de ses affaires n’avait pas été un choix compliqué : il n’existait à Montmorts qu’un seul hôtel, « Chez Mollie ». Au moins le café est buvable, sourit Julien en portant la tasse à ses lèvres. Sur le pan de mur face à lui se trouvaient suspendues des photos encadrées. La veille, quand il s’était présenté à la réception, qui n’était autre que le comptoir surchargé, le mari de Mollie, Roger, l’avait accueilli avec un sourire empli de surprise.
— Vous êtes le nouveau chef de la police ?
— Exactement, je commence demain, précisa Julien sans véritablement savoir pourquoi. La fatigue, sans doute, pensa-t-il en songeant aux cinq heures de route qui l’avaient conduit jusqu’ici.
— Et vous voulez rester ici une nuit ?
— Tout à fait, sauf si vous êtes complets, sourit Julien.
Roger ignora le sarcasme, mais par réflexe professionnel examina la salle qui, mis à part une femme penchée au-dessus de sa tasse de thé, courbée comme si elle murmurait à son breuvage le plus précieux des secrets, et un vieux chat couché près de la cheminée, était déserte.
— Les gens viennent surtout le soir, après le travail…, justifia-t-il en essuyant un verre, j’espère que le bruit ne vous dérange pas trop, certains clients boivent jusqu’à pas d’heure…
— Ce n’est que pour une nuit, je saurai être clément, lui promit Julien.
En attendant que Roger trouve sa femme pour qu’elle lui montre la chambre, Julien s’était dirigé vers les photos. La plupart des clichés présentaient des moments festifs, des hommes et des femmes en train de lever leurs verres en direction de l’objectif, des visages souriants, rougis par l’alcool et les célébrations. Un cadre accroché à l’écart montrait une photo qui contrastait violemment avec la joie affichée sur les précédentes. Il s’agissait d’un vieux cimetière, dont les croix usées par le temps ne se tenaient plus dressées vers le paradis céleste, mais au contraire semblaient s’affaisser vers l’enfer et penchaient en direction du sol comme si elles n’avaient pas été suffisamment enfoncées dans la terre. Des herbes hautes jonchaient le pourtour et couraient le long d’une grille rouillée.
— Charmant, non ?
Une voix féminine, à l’intonation rauque et usée, résonna derrière le policier.
— Charmant, je ne sais pas, mais… bucolique en tout cas.
— Je suis Mollie, la propriétaire. Je vais vous montrer votre chambre.
La vieille femme, tout en rondeurs, se déplaça en traînant les pieds vers un renfoncement où apparaissaient les premières marches d’un escalier. Julien la suivit, tentant d’ignorer son odeur de sueur âcre. Chaque pas qu’elle posa sur les marches en bois fit craquer l’escalier de douleur.
— Je vais vous donner la chambre qu’avait occupée votre prédécesseur à son arrivée, déclara-t-elle d’une voix ferme, une fois le premier étage atteint. Pas que je veux vous porter le mauvais œil, mais c’est la seule qui soit prête.
— Je ne suis pas superstitieux, plaisanta Julien, cependant légèrement mal à l’aise de dormir dans le même lit qu’un homme qui, à ce que lui avait appris son supérieur, était mort à peine huit mois après sa prise de poste.
— Vous êtes à Montmorts, jeune homme, vous feriez mieux d’être superstitieux…
Mollie tourna la clef dans la serrure de la première porte d’un couloir qui semblait n’avoir pas de fin, se perdant dans l’obscurité du parquet sombre, abandonné par un lustre qui n’éclairait plus les murs décrépits et pendait du plafond telle une corde de gibet.
— Ce n’est pas le Hilton, ajouta la propriétaire en lui tendant la clef, mais pour ce soir, je présume que monsieur ne fera pas le difficile… Le petit déjeuner est servi à partir de sept heures, et si vous voulez dîner, demandez le plat du jour à mon mari. Moi je ne m’occupe que des chambres et du café du matin.
Julien observa d’un œil résigné la pièce qui se présentait à lui. Il attendit que les pas traînants de Mollie disparaissent dans l’escalier avant de fermer la porte. « En effet, ce n’est pas le Hilton… », souffla-t-il en singeant la vieille femme, dont les relents fétides occupaient encore l’atmosphère. Après avoir ouvert la fenêtre pour aérer, il descendit récupérer sa valise dans le coffre de sa voiture. En passant devant le comptoir, il remarqua que la femme assise quelques minutes plus tôt avait disparu, laissant sa tasse et le chat immobile. Un jour à tenir, se motiva-t-il en remontant le col de son manteau pour affronter le vent glacial, un jour à tenir dans cet endroit…
— R’voulez du café ?
La voix de Mollie le fit sursauter. Il ne l’avait pas entendue arriver, ce qui lui parut impossible tant cette femme usait le sol à chaque déplacement. Il pencha par réflexe la tête en direction des pieds de la propriétaire. Ses pantoufles crasseuses se trouvaient toujours à leur place. Qu’est-ce qui a pu retenir mon attention au point d’ignorer le bruit et l’odeur de Mollie ? se demanda-t-il un bref instant sans parvenir à trouver une réponse.
— Non… Non merci, ça ira.
— Il n’est pas bon ?
— Euh… si, très bon, mais je dois filer au commissariat, le premier jour c’est important.
— Vous avez raison, et profitez-en pour passer un message à votre collègue, le gros Francky : dites-lui qu’ici ce n’est pas une banque, et qu’il vienne régler son ardoise rapidement.
— Très bien, je lui transmettrai.
.................................................................................................................................................................
BIO:
Jérôme Loubry est un écrivain français né en 1976 à Saint-Amand-Montrond.
Il travaille dans le milieu de la restauration jusqu'en 2016, date à laquelle il décide de devenir écrivain. Il publie l'année suivante son premier roman, Les Chiens de Détroit. En 2018 il est considéré comme l'un des auteurs de polars français les plus prometteurs par le journal Le Parisien.
Œuvre
Romans
Les Chiens de Détroit, Calmann-Lévy, 2017 (ISBN 978-2702161708)
Le Douzième chapitre, Calmann-Lévy, 2018 (ISBN 978-2702163627)
Les Refuges, Calmann-Lévy, 2019 (ISBN 978-2702166390)
De Soleil et de Sang, Calmann-Lévy, 2020 (ISBN 978-2702166857)
Nouvelles
Storia, coll., Hugo poche, 2020, (ISBN 978-2755685176)
Collectif
L’Enfance, c’est… / par 120 auteurs ; textes illustrés par Jack Koch ; préf. Aurélie Valognes. Paris : Le Livre de poche, novembre 2020. (ISBN 978-2-253-08202-6)
Prix et récompenses
Prix Plume Libre D'argent 2017 pour Les Chiens de Détroit
Prix Sang pour sang Polar 2018, Salon du Polar de Saint-Chef pour Le Douzième Chapitre
Prix Polar du festival Mauves-en-noir 2018 pour Le Douzième Chapitre
Prix salon La Ruche des Mots, Riez, 2018 pour Les Chiens de Détroit
Prix Moustiers-Sainte-Marie à la Page, 2019 pour Le Douzième Chapitre
Prix Polars de Nacre 2019 pour Le Douzième Chapitre
Prix Cognac du meilleur roman francophone 2019 pour Les Refuges3
Prix Grand prix de l'Iris Noir, Bruxelles 2019 pour Les Refuges
Prix Sud-Ouest/Lire en poche 2020 pour Le Douzième Chapitre
Prix Crime de L'année, Dunkerque, 2021 pour Les Refuges
Prix Choix des lilbraires, Livre de Poche 2021 pour Les Refuges
Premier Sang
Résumé;
« Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre . »
Sous la forme d’un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant angélique qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort.
Un magnifique hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros de l’ombre, diplomate à la carrière hors norme.................
......................................................................................................................................................................Extraits;
On me conduit devant le peloton d’exécution. Le temps s’étire, chaque seconde dure un siècle de plus que la précédente. J’ai vingt-huit ans.
En face de moi, la mort a le visage des douze exécutants. L’usage veut que parmi les armes distribuées, l’une soit chargée à blanc. Ainsi, chacun peut se croire innocent du meurtre qui va être perpétré. Je doute que cette tradition ait été respectée aujourd’hui. Aucun de ces hommes ne semble avoir besoin d’une possibilité d’innocence.
Il y a une vingtaine de minutes, quand j’ai entendu crier mon nom, j’ai su aussitôt ce que cela voulait dire. Et je jure que j’ai soupiré de soulagement. Puisqu’on allait me tuer, il ne serait plus nécessaire que je parle. Cela fait quatre mois que je négocie notre survie, quatre mois que je me lance dans des palabres interminables afin d’ajourner notre assassinat. Qui va défendre les autres otages à présent ? Je l’ignore et cela m’angoisse, mais une part de moi est réconfortée : je vais enfin pouvoir me taire.
Dans le véhicule qui m’emmenait au monument, j’ai regardé le monde et j’ai commencé à m’apercevoir de sa beauté. Dommage d’avoir à quitter cette splendeur. Dommage, surtout, d’avoir mis vingt-huit années d’existence à y être à ce point sensible.
On m’a jeté hors du camion et le contact avec la terre m’a enchanté : ce sol si accueillant et tendre, comme je l’aime ! Quelle planète charmante ! Il me semble que je pourrais l’apprécier tellement plus. Là aussi, il est un peu tard. Pour un peu, je me réjouirais à l’idée que mon cadavre y soit abandonné sans sépulture dans quelques minutes.
Il est midi, le soleil dessine une lumière intransigeante, l’air distille des odeurs affolantes de végétation, je suis jeune et plein de santé, c’est trop bête de mourir, pas maintenant. Surtout ne pas prononcer de paroles historiques, je rêve de silence. Le bruit des détonations qui vont me massacrer déplaira à mes oreilles.
Dire que j’ai envié à Dostoïevski l’expérience du peloton d’exécution ! À mon tour d’éprouver cette révolte de mon être intime. Non, je refuse l’injustice de ma mort, je demande un instant de plus, chaque moment est si fort, rien que de savourer l’écoulement des secondes suffit à ma transe.
Les douze hommes me mettent en joue. Est-ce que je revois ma vie défiler devant moi ? La seule chose que je ressens est une révolution extraordinaire : je suis vivant. Chaque moment est sécable à l’infini, la mort ne pourra pas me rejoindre, je plonge dans le noyau dur du présent.
.........................
Le présent a commencé il y a vingt-huit ans. Aux balbutiements de ma conscience, je vois ma joie insolite d’exister.
Insolite parce que insolente : autour de moi régnait le chagrin. J’avais huit mois quand mon père est mort dans un accident de déminage. Comme quoi, mourir est une tradition familiale.
Mon père était militaire, il avait vingt-cinq ans. Ce jour-là, il devait apprendre à déminer. L’exercice tourna court : par erreur, on avait placé une vraie mine à la place de la fausse. Il mourut au début de 1937.
Deux années plus tôt, il avait épousé Claude, ma mère. C’était le grand amour comme on le vivait en cette Belgique des bons milieux qui évoque si singulièrement le dix-neuvième siècle : avec retenue et dignité. Les photos montrent un jeune couple se promenant à cheval en forêt. Mes parents sont très élégants, ils sont beaux et minces, ils s’aiment. On dirait des personnages de Barbey d’Aurevilly.
Ce qui me sidère sur ces photos, c’est l’air heureux de ma mère. Je ne l’ai jamais vue ainsi. L’album de photos de leur mariage se termine sur les clichés d’un enterrement. À l’évidence, ma mère avait prévu d’écrire les légendes des photographies plus tard, quand elle en aurait le temps. En fin de compte, elle n’en a pas eu le désir. Sa vie d’épouse comblée a duré deux années.
À vingt-cinq ans, elle trouva son expression de veuve. Elle ne quitta jamais ce masque. Même son sourire était figé. La dureté s’empara de ce visage et le priva de sa jeunesse.
Son entourage lui dit :
– Au moins, vous avez la consolation d’avoir un enfant.
Elle tournait la tête vers le berceau et voyait un joli bébé à l’air content. Cela la décourageait, cette jovialité.
À ma naissance, pourtant, elle m’avait aimé. Son premier enfant était un garçon : on l’avait félicitée. À présent, elle savait que je n’étais pas son premier mais son unique enfant. L’idée qu’il lui faille remplacer son amour pour son époux par l’amour d’un enfant l’indignait. Personne, bien sûr, ne le lui avait proposé en ces termes. C’est ainsi cependant qu’elle l’entendit.
Le père de Claude était général. Il trouva la mort de son gendre très acceptable. Il ne la commenta pas. La Grande Muette avait en lui son grand muet.
La mère de Claude était une femme tendre et douce. Le sort de sa fille l’épouvanta.
– Confie-moi ton chagrin, ma pauvre chérie.
– Arrête, Maman. Laisse-moi souffrir.
– Souffre, souffre un bon coup. Cela n’aura qu’un temps. Après tu te remarieras.
– Tais-toi ! Jamais, entends-tu, je ne me remarierai. André était et est l’homme de ma vie.
– Bien sûr. Maintenant tu as Patrick.
– Quelle drôle de façon de parler !
– Tu l’aimes, ton fils.
– Oui, je l’aime. Mais je veux les bras de mon mari, son regard. Je veux sa voix, ses paroles.
– Veux-tu revenir vivre à la maison ?
– Non. Je veux habiter mon appartement de femme mariée.
– Me confierais-tu Patrick pendant quelque temps ?
Claude haussa les épaules en signe d’assentiment.
Ma grand-mère, toute contente, m’emporta. Cette femme, qui avait une fille et deux fils adultes, se réjouit de l’aubaine : elle avait à nouveau un poupon.
– Mon petit Patrick, que tu es joli, quel amour !
Elle me laissa pousser les cheveux et me vêtit de costumes de velours noirs ou bleus, avec des cols de dentelle de Bruges. J’avais des bas de soie et des bottines à boutons. Elle me prenait dans ses bras et me montrait mon reflet dans le miroir :
– As-tu déjà vu un si bel enfant que toi ?
Elle me regardait avec tant d’extase que je me croyais beau.
– As-tu vu tes longs cils d’actrice, tes yeux bleus, ta peau pâle, ta bouche exquise, tes cheveux noirs ? Tu es à peindre.
Cette idée lui resta. Elle convia sa fille à une séance de pose avec moi, devant un peintre connu à Bruxelles. Claude refusa. Sa mère sut qu’elle l’aurait à l’usure.
Ma mère s’était lancée dans les mondanités. Elle n’appréciait guère les réceptions mais elle ne songeait pas à aimer ce qu’elle faisait. Cette jeune femme promenait un deuil d’une élégance saisissante devant des spectateurs en mesure de le comprendre et de lui renvoyer l’image voulue. Cela suffisait à ses aspirations.
Le matin, elle se réveillait en pensant : « Que vais-je porter ce soir ? » La question meublait sa vie. Elle passait ses après-midi chez les grands couturiers, enthousiastes d’avoir à habiller un si noble désespoir. Sur ce corps grand et maigre, les robes et les tailleurs avaient un tombé parfait.
Le sourire figé de Claude apparut sur la quasi-totalité des photos de soirées du gotha belge, dès 1937. On l’invitait partout, avec le sentiment que sa présence garantissait la bonne tenue, le bon goût de la réception.
Les hommes savaient que la courtiser ne représentait aucun danger : elle ne céderait pas. Pour cette raison, ils lui faisaient la cour. C’était une occupation agréable.
J’aimais ma mère d’un amour désespéré. Je la voyais peu. Chaque dimanche midi, elle venait déjeuner chez ses parents. Je levais les yeux vers cette femme magnifique et j’accourais, bras ouverts. Elle avait une manière spéciale d’éviter l’étreinte, elle me tendait les mains afin de ne pas me soulever. Était-ce de peur de ruiner sa belle toilette ? D’un sourire crispé, elle disait :
– Bonjour, Paddy.
La mode était à l’anglicisme.
Elle me regardait des pieds à la tête avec une déception gentille que je ne parvenais pas à analyser. Comment aurais-je pu comprendre que, toujours, elle espérait retrouver son époux?
À table, ma mère mangeait très peu et très vite. Il fallait expédier le devoir de porter des aliments à sa bouche. Ensuite, elle sortait de son réticule un superbe étui à cigarettes et fumait. Son père la fusillait du regard : une femme n’était pas censée fumer. Elle détournait les yeux avec un mouvement de mépris qu’elle croyait discret. Si elle avait pu parler, elle eût dit : « Je suis une femme malheureuse. Que cela me donne au moins le droit de fumer ! »
– Eh bien ma Claude, raconte, demandait Bonne-Maman.
Maman disait le cocktail chez Untel, sa conversation si intéressante avec Mary, le divorce probable de Teddy et Anny, le tailleur un peu ridicule de Katherine – elle prononçait tous les prénoms à l’anglaise et appelait ses parents Mommy et Daddy. Son regret était qu’il n’existe pas de « charmant diminutif anglicisant » pour son propre prénom.
Elle parlait vite en articulant à peine et en tapant les T, persuadée que les Anglais prononçaient de la sorte :
– Je vais à un thé chez Tatiana. Tu vois, elle n’est pas aussi dépressive qu’elle le prétend.
– Et si tu y emmenais Patrick ?
– Tu n’y penses pas, Mommy, il s’ennuierait à périr.
– Non, Maman, j’aimerais beaucoup t’y accompagner.
– N’insiste pas, mon chéri, il n’y aura pas d’enfants.
– J’ai l’habitude qu’il n’y ait pas d’enfants.
Elle soupirait en levant un peu le menton. Cette expression me tuait : je comprenais que j’avais commis une faute aux yeux de cette femme inaccessible et sublime.
Bonne-Maman sentait que je souffrais.
– Allez vous promener au parc tous les deux, le petit a besoin d’air.
– L’air, l’air, toujours l’air !
Combien de fois ai-je entendu ma mère dire cela ? Elle trouvait absurdes ces considérations hygiénistes sur la nécessité de s’aérer. Respirer lui paraissait surfait.
Quand elle partait, j’étais aussi triste que soulagé. Ce qui me désolait le plus était de comprendre qu’elle partageait mon double sentiment. Claude m’embrassait, me jetait un regard brisé et disparaissait à pas rapides. Ses chaussures à talons faisaient en s’éloignant un bruit superbe qui me rendait malade d’amour.
.................................................................................................................................................................
Bio:
De nationalité : Belge elle est née à : Etterbeek , le 13/08/1966
Amélie Nothomb, nom de plume de Fabienne Claire Nothomb, est une romancière belge d'expression française.
Elle est fille de l'ambassadeur de Belgique à Rome, et petite-nièce de l'homme politique Charles-Ferdinand Nothomb.
Amélie Nothomb passe ses cinq premières années au Japon, dont elle restera profondément marquée, allant jusqu'à parler couramment japonais et même à devenir interprète par la suite. Mais son expérience ne s'arrête pas là puisqu'elle vivra successivement en Chine, à New York, au Bangladesh, en Birmanie et au Laos, avant de débarquer à dix-sept ans sur le sol de Belgique, berceau de sa famille où elle obtient une licence en philologie romane à l'Université libre de Bruxelles, et envisage un moment la carrière d'enseignante, passant et obtenant l'agrégation.
Elle écrit depuis ses dix-sept ans. Elle avoue avoir déjà écrit plus d'une centaine de romans. L'écrivain garde rangés dans un carton différents manuscrits qu'elle se refuse à publier, les estimant trop personnels.
C'est en 1992, alors âgée de vingt-cinq ans, qu'elle fait son entrée fracassante dans le monde des lettres avec son roman "Hygiène de l'assassin." Elle enchaîne depuis les succès publics avec bientôt trente publications.
Amélie Nothomb est également l'auteur de : "Le sabotage amoureux" (1993), "Les combustibles" (1994), "Mercure", "Péplum", "Les Catilinaires" (1995), "Métaphysique des tubes" (2000), "Cosmétique de l'ennemi" (2001), "Robert des noms propres" (2002)...
Amélie Nothomb a été définitivement consacrée en 1999 alors que "Stupeur et Tremblements" a été couronné du Grand Prix de l'Académie française et s'est vendu à 385 000 exemplaires. Ses romans sont depuis traduits en une quarantaine de langues.
Elle a également obtenu par deux fois le prix du jury Jean Giono, le prix Alain Fournier et, très connue en Italie, il premio Chianciano.
Elle est encore actuellement domiciliée à Bruxelles mais voyage beaucoup de ville en ville afin de rencontrer ses lecteurs.
Auteure extrêmement prolifique, Amélie Nothomb publie traditionnellement un livre par an depuis 24 ans, chaque année vers le mois de septembre.
Premier sang est son 30 éme roman.