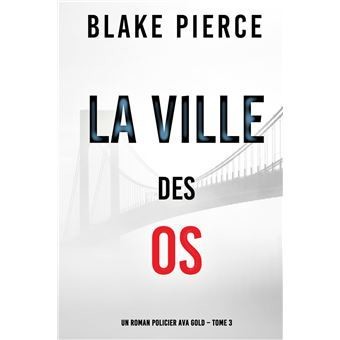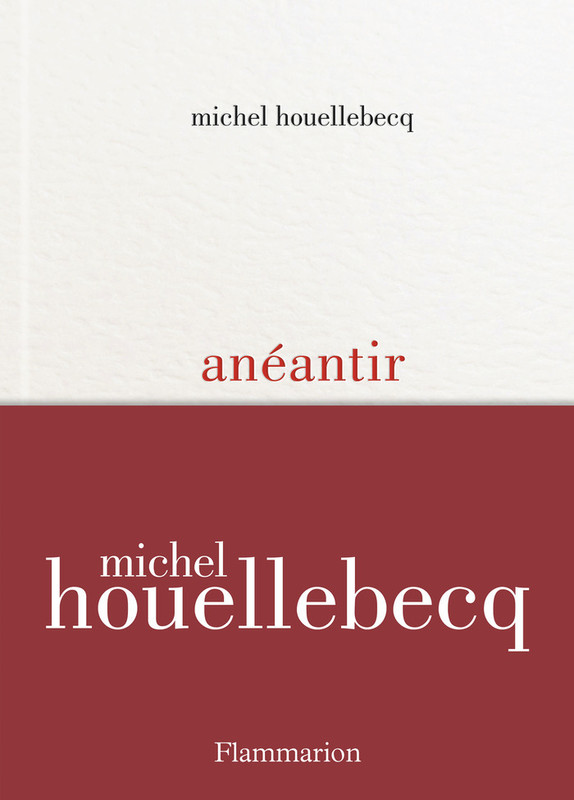>> Toutes les rubriques <<
· Discussion (473)
· Poésies (203)
· Mes ballades (83)
· MUSIQUE (112)
· UN PEU DE CORSE, la langue d'ici (40)
· HANDICAP (13)
· PHOTOS (17)
· MAXIMES,REFLEXIONS (33)
· Dansons,dansons, (23)
· Blagues (16)
· RANDONNÉE CORSE – POZZI DE BASTELICA
· POESIE de mon pays
· La Conspiration de l'ombre
· Dardanus.
· La Traversée des temps - Paradis perdus
· POESIE d'été
· Les glacières de Cardo et de Ville-di-Pietrabugno
· OLMO
· Rando:Cima di e Follicie
· LA PANTHÈRE DES NEIGES.SYLVAIN TESSON
· Avant elle
· VENISE!!
· Vie pour Vie
· Randonnée chemin du littoral ou sentier des douaniers.
· le petit pont génois
angebot bereit schnell
hallo,
ungl aublich, aber wahr, es gibt zu viele betrügereien über kreditangebot
Par Sabine, le 08.02.2022
comment ne pas aimer la corse !
Par Anonyme, le 20.07.2021
bonjour,
me rci pour ce relais...
nou s connaissons-no us peut-être?
bien à vous.
hugue s simard
Par Anonyme, le 03.05.2021
et comme toujours pas un mot sur la seule cause à la base de la catastrophe climatique : la surpopulation, jam
Par anonyme, le 22.04.2021
donat nonnotte; donatien nonnotte, né le 10 février 1708 à besançon et mort le 5 février 1785 à lyon, est un p
Par Anonyme, le 14.03.2021
air amis amour art background belle bleu bonne carte centre cheval chez
Abonnement au blogImagesStatistiques
Date de création : 16.06.2010
Dernière mise à jour :
01.08.2024
1173 articles
La vengeance du pangolin
Résumé;
Un virus bien en chair et en os, si je puis me permettre, a démontré que le virus virtuel n'était pas la seule réalité avec laquelle nous avions à compter. Venu de Chine où des pangolins et des chauves-souris ont été incriminés, il a mis le monde à genoux.
Il a été le révélateur, au sens photographique du terme, des folies de notre époque : impéritie de l'État français, faiblesse extrême de son chef, impuissance de l'Europe de Maastricht, sottise de philosophes qui invitaient à laisser mourir les vieux pour sauver l'économie, cacophonie des scientifiques, volatilisation de l'expertise, agglutination des défenseurs du système dans la haine du professeur Raoult, émergence d'une médecine médiatique, indigence du monde journalistique, rien de très neuf...
Le covid-19 rappelle une leçon de choses élémentaire : il n'est pas le retour de la mort refoulée, mais la preuve vitaliste que la vie n'est que par la mort qui la rend possible. Tout ce qui est naît, vit, croît et meurt uniquement pour se reproduire – y compris, et surtout, chez les humains. Ce virus veut la vie qui le veut, ce qui induit parfois la mort de ceux qu'il touche. Mais quel tempérament tragique peut et veut encore entendre cette leçon de philosophie vitaliste ?
...................................................................................................................................................................................
RÉFACE
L’épidémie, une leçon de vie
Un dicton de l’empire du Milieu dit que les Chinois mangent tout ce qui a quatre pattes, sauf une table, tout ce qui vole, sauf un avion, et tout ce qui se trouve dans l’eau, sauf un bateau.
Voilà pourquoi on trouve sur les tables chinoises de la soupe de pénis de tigre infusée au gingembre, du vin d’os du même animal confectionné avec de l’alcool de riz, de la salamandre géante, des tortues, des petits oiseaux, dont le bruant auréole qui, de ce fait, vit ses derniers battements d’ailes.
On écorche également des serpents après les avoir excités afin que leur agressivité sature leur organisme. On les saigne, on verse leur sang dans un bol et l’on ajoute le venin extrait de sa poche, puis le fiel, et l’on boit l’ensemble cul sec. Le breuvage sang-fiel-venin apporte la vitalité sexuelle à coup sûr…
Ces pratiques extravagantes procèdent d’une médecine chinoise ancestrale que le nihilisme contemporain préfère parfois à la chimie moléculaire de l’allopathie occidentale. Quand la raison est mise en procès, on peut en effet trouver des vertus aux griffes et aux dents de tigres pour soigner la fièvre, à leurs yeux et à leur bile pour prémunir de l’épilepsie, à leur cerveau pour évacuer la fatigue et les boutons, à la corne de rhinocéros pour guérir l’impuissance sexuelle, à la bile d’ours pour triompher du cancer ou aux hippocampes séchés pour recouvrer de l’énergie…
Ces préparations sont extrêmement coûteuses et, la plupart du temps, elles ne sont accessibles qu’aux riches, autrement dit : à la mafia, donc aux membres du parti, aux membres du parti, donc à la mafia. Se mettre un pénis de tigre dans la bouche est donc une affaire de communistes enrichis par le marché ou de capitalistes enrichis par le communisme. Cette engeance est nombreuse.
Cette passion baroque pour le ragoût de chauve-souris, l’escalope de chien, le rôti de chat, les nids d’hirondelles, les œufs pourris, le scorpion grillé, le sauté de crocodile, les yeux de poisson bouillis, les testicules de poulet marinés, constitue le buffet potentiel de presque un milliard et demi d’habitants. Autant dire que la population de petits oiseaux moins gros qu’un poing se trouve mise en péril de façon inimaginable.
La fin des espèces n’est pas uniquement due au réchauffement climatique, elle est également à mettre en relation avec des habitudes alimentaires qui, eu égard à la démographie chinoise, mais pas seulement, fait comprendre qu’un si petit garde-manger ne saurait suffire à nourrir autant de bouches.
Le pangolin fait partie de ces mets de choix. Voilà pourquoi l’existence de cet animal est en péril. Or on dit que ce fourmilier préhistorique recherché pour sa viande et ses écailles aurait joué dans cette épidémie le rôle d’un transmetteur…
La consommation de viande de brousse partout sur la planète met en contact des hommes avec des animaux sauvages porteurs de maladies et qui, faute d’une cuisson suffisante ou lors de contacts qui génèrent des blessures humaines, produisent des zoonoses.
La zoonose valide les thèses de Darwin : il n’existe pas des différences de nature entre l’homme et l’animal, mais des différences de degrés. D’autres maladies ont montré que de la vache, du mouton ou du porc à l’homme il n’y avait qu’un pas – j’ajoute en passant qu’un peu d’observation valide parfois cette hypothèse…
C’est donc la proximité des animaux et des hommes qui est en cause. Quand chacun vivait chez soi, les animaux dans la nature, les hommes dans les villages, puis les villes, les relations étaient limitées, les contaminations restaient locales.
La déforestation réduit l’espace vital des animaux, elle augmente donc la promiscuité entre les humains et leurs semblables dépourvus de vêtements. Pendant le confinement, les hommes enfermés dans les cages de leurs appartements comme des animaux ont pu voir derrière les barreaux de leurs fenêtres passer des renards, des sangliers, des chevreuils, des canards, des biches ou des cerfs. Une ironique inversion des valeurs s’est opérée : parqués dans un zoo comme des animaux, les humains voyaient les animaux vivre comme eux dans les villes : ils déambulaient, ils furetaient, fouinaient, ils vidaient les poubelles pour trouver à manger, ils faisaient du tourisme, ils visitaient la ville. C’est à peine une allégorie, pas même une métaphore.
Cette déforestation planétaire se double d’une autre catastrophe : on le dit peu, mais la prolifération inconsidérée d’humains sur le globe génère une destruction de celui-ci bien plus que le pet des vaches ou la trace carbone d’une mobylette. Cette surabondance de naissances est le véritable péril de la nature qui n’en peut plus de subvenir aux besoins délirants de bipèdes qui consomment à s’en faire péter la sous-ventrière et qui gaspillent au point qu’ils vont mourir sous le poids de leurs ordures. Si l’on veut vraiment sauver la planète, le malthusianisme est une pensée qui a de l’avenir.
Trop d’hommes au contact des animaux dans de moins en moins de nature, voilà qui ne peut que générer ces épidémies. Il n’est pas nécessaire d’en rechercher la généalogie dans le laboratoire de savants chinois fous (ou maladroits : le tube à essai qui tombe par terre…), dans celui d’Américains encore plus fous qui auraient inoculé la maladie à un peuple sur le principe des guerres bactériologiques ! Si le virus s’était échappé d’une éprouvette chinoise, ce serait probablement par accident mais, en amont de celui-ci, ce virus existait et témoignait de cet étrange accouplement entre des humains et des animaux sur lequel travaillent des chercheurs.
Le covid1 est une chimère au sens scientifique du terme : un assemblage d’animal humain et d’animal non humain. Ce parent des centaures et des sirènes donne vie à notre à-venir mais dans un présent dont les humains, pour l’heure, ne savent que faire. Ce qui advient est à venir, le passé du Covid, c’est donc notre futur, c’est la première leçon de l’épidémie.
La deuxième leçon n’est pas que la mort serait revenue tirer les humains par les pieds alors que, depuis plus d’un siècle, ils essaient de la conjurer par tous les moyens : on cache les mourants, on dissimule les cadavres, on maquille les morts, on les réduit en cendres au plus vite par crémation afin d’évincer la réalité de la pourriture et l’on confie les cercueils à un genre de HLM (habitation à loyer modéré…) fait de caveaux en ciment, car il ne faut pas que le corps retourne à la terre pour nourrir le cycle de la vie mais qu’il vive son éternité dans le néant de clapiers pour défunts.
Ça n’est donc pas la mort qui est revenue mais la vie dont on ignore toujours ce qu’elle est – à savoir une préparation à la mort dont elle est, vérité de La Palice, la seule condition de possibilité. La vie ne connaît qu’une chose : la reproduction de la vie. Quand cet objectif est atteint, la mort débarrasse le terrain pour que les vivants nouveaux venus effectuent la même tâche et connaissent le même destin. Naître, être, vivre, copuler, vieillir, mourir : c’est le destin de tout ce qui est vivant : de l’infiniment petit du ciron cher à Montaigne à l’infiniment grand des univers cher à Pascal.
Les hommes connaissent bien sûr ce cycle du vivant qui s’avère la loi de tout ce qui est : on croit aimer un être en particulier, on s’imagine amoureux d’une personne qu’on pense originale, singulière, sans double, exceptionnelle ; par amour, pense-t-on, on met au monde avec elle des enfants, on les éduque, on pourvoit à leur existence ; on vieillit, on désire moins, autre chose, autrement, plus du tout ; on vieillit plus encore, on part en morceaux, on fuit, on se ramollit, on épaissit, on se fissure, on fait sous soi, on se vide, on meurt ; on croit cesser de vivre mais la vie continue car elle réduit le cadavre à plus rien – du minéral, du sec, des os, puis, la vie continuant son travail de mort, elle transforme tout ça en poudre, les fameuses cendres qu’une simple brise disperse. Ce qui fut un jour n’est même plus néant : il est semblable à ce qui n’a jamais été.
Schopenhauer a raconté les raisons de ce trajet que tous ou presque empruntent en se reproduisant : l’individu croit choisir et vouloir, en fait, il est choisi et voulu par plus fort que lui : l’espèce. Car elle veut être et durer, et tout est fait dans la nature pour que les espèces vivent et survivent au prix des individus floués.
Le parasitisme est l’une des modalités du vivant. Qu’on songe au ver nématode qui, pour se reproduire, pénètre le corps d’un grillon par ingestion de son œuf, colonise cet organisme, atteint le cerveau et en prend les commandes grâce à des informations chimiques adéquates afin de contraindre un jour l’insecte à se jeter dans l’eau où le nématode, parvenu à maturité, perforera le ventre de l’animal qu’il tuera afin de pouvoir mener sa vie. Lui aussi pondra, lui aussi verra ses œufs mangés par un grillon, qui lui aussi, etc.
Le Covid obéit également à cette loi du vivant. Je n’ignore pas qu’il y a débat chez les scientifiques pour savoir si le virus relève du vivant ou pas. Je laisse les scientifiques faire leurs communications au Quai Conti sur ce sujet. Pour ma part, je crois que les virus, tout autant que les trous noirs des astrophysiciens, élargissent la notion de vivant, qu’ils débordent la lecture strictement anthropomorphique de la chose – donc du mot.
Il n’est pas impossible que le virus ait un cycle comme l’éphémère ou la Voie lactée, comme le chêne ou l’homme, comme le ciron et l’infini. Mais, tout à notre lecture étroitement matérialiste – je ne fais pas l’éloge d’une lecture spiritualiste pour autant… –, nous ne sommes pas capables de penser selon l’ordre vitaliste qui se soucie moins de la matière qui compose le vivant que de ce qui la lie. Schopenhauer, Nietzsche ou Bergson, sinon Deleuze, auraient été intellectuellement séduits par le mécanisme du covid.
Ce cycle est peut-être de cinq cent quarante-sept ans, hypothèse de travail, mais nous ne disposons d’aucune documentation qui en attesterait. S’il y a eu une épidémie de covid cinq cent quarante-sept ans en amont, rien ne permettra de le savoir ; mais peut-être que dans cinq cent quarante-sept ans, on le saura – s’il reste encore des hommes sur terre, mais également si ces humanoïdes sont encore capables de penser, ce qui paraît moins sûr au train où vont les choses…
Car, qu’est-ce qui a déclenché la Grande Peste médiévale qui, au milieu du XIVe siècle, a rayé presque la moitié de la population européenne de la carte en sept années seulement ? Elle arrive vers 1346, elle disparaît en 1353, elle fait autour de 25 millions de morts. On ignore pourquoi elle apparaît, mais on ignore surtout pourquoi elle s’en va.
Il n’y avait à l’époque aucun remède. On ne peut donc inférer que la pandémie a été stoppée par une molécule. Pas plus on ne fera des masques à long bec d’oiseau dans lesquels on bourrait des herbes aux vertus prétendument prophylactiques les médications les plus efficaces ! La peste est arrivée, elle a tué, elle est repartie – elle a développé son cycle, elle a vécu sa vie en répandant la mort. Pourquoi n’a-t-elle pas plus tué au point d’éradiquer l’homme de la planète ? Nul ne sait…
Le Covid a fait de même.
Il a montré que la vie se nourrit de la mort et vice versa. Il s’est réveillé, peu importe que ce soit ici ou ailleurs ; il s’est répandu sur toute la planète ; il a tapé ici, moins là, pas du tout ailleurs ; il a emporté des vieux mais aussi des jeunes, des gens en mauvaise santé (c’est mieux de parler de comorbidité…), des adultes mais également des enfants ; il s’est installé dans un endroit (les fameux clusters des communicants, comme si foyers ne faisait pas l’affaire), il n’a fait que passer dans un autre ; il a tué d’un coup, en deux jours, ou bien il a longtemps fait souffrir ; il a été bénin, il a été mortel ; il a été latent (on dit asymptomatique…), il a été visible ; chez tel ou tel il est parti, mais il est revenu, puis il a fait semblant de partir, mais il était resté – il n’a eu que faire de qui ou quoi que ce soit : sa vie, c’était de répandre la maladie et la mort, c’est à ce prix qu’il a été vivant.
Troisième leçon : ce présent de l’humanité qui eut un passé dans les longues durées est également appelé à un futur lui aussi dans les longues durées. Les hommes seront de plus en plus nombreux. Ces prédateurs sans prédateurs semblent avoir pour vocation d’effacer le vivant de la planète afin de l’artificialiser pour en faire commerce ensuite, ils détruisent déjà la nature et éteignent les espèces, le tout sans vergogne. Ils ont tué les abeilles, ils vendent aujourd’hui des robots pollinisateurs pour les remplacer.
Des chefs d’État cyniques n’ont que faire de sauver la planète puisqu’ils aspirent à la marchandiser, mais de plus cyniques encore prétendent en avoir grand souci sans rien en faire pour autant. Lesdites démocratures valent sur ce terrain les démocraties qui valent la même chose que les dictatures : les États-Unis ou le Brésil tout autant que la France ou la Chine sont des régimes faits sur mesure par et pour les hommes et leur folie, pas pour la nature.
Et si ce prédateur sans prédateur qu’est l’homme avait trouvé le sien ? Le covid pourrait bien être en effet un test du vivant pour vérifier l’étendue, la solidité, la validité de la vitalité du vivant – du vivant en général mais aussi du vivant qu’est l’homme en particulier. La vie qui veut la vie la veut aussi en semant la mort de ce qui sème la mort. Autrement dit : le virus tue l’homme qui tue le vivant pour que le vivant soit et dure. Ce qui est ne veut jamais qu’être et persévérer dans son être. Le virus est là pour le rappeler.
Je ne souscris pas à l’écologie mondaine et urbaine qui, certes, a le souci de la nature, mais pas celui de l’inscription de cette nature dans le cosmos. Comment dès lors comprendre vraiment l’ordre du monde ? Elle est soucieuse de l’écologie dans les villes parce qu’elle est pensée dans les villes.
J’aspire à une écologie globale qui pense moins la nature comme un fétiche panthéiste, la Gaïa du Contrat naturel de Michel Serres, ou comme la Terre anthropomorphique qui se vengerait des offenses que lui feraient subir les hommes, mais comme un organisme vivant dans lequel la loi du battement d’ailes d’un papillon ici provoque un raz-de-marée à des milliers de kilomètres de ce souffle infime. Le développement de la physique quantique résoudra probablement l’actuel mystère de ces équations.
Le virus est un organe de cet organisme, une partie du tout, un rouage du mécanisme, une pièce de la machine vivante. En tant que tel, s’il apparaît ou disparaît, s’il rentre en dormance ou s’active, s’il répand sa loi ici plutôt qu’ailleurs, c’est qu’il obéit à l’ordre des raisons vitalistes. Lui ne veut rien car il est déjà voulu par une volition plus grande que lui. Il existe une homéostasie du vivant dans laquelle il joue un rôle majeur. On ignore lequel mais on sait que c’est ainsi.
Pour l’heure, si je puis me permettre ici un peu l’anthropomorphisation que je déplore par ailleurs, il faut bien que j’explicite mon titre, le virus s’est bien moqué des comités de scientifiques, des présidents de la République et des gouvernements, des officiels de la science et des journalistes santé de la télévision, de quelques philosophes aussi, bien entendu, il en a rendu cinglés quelques-uns qui furent plus bêtes que lui… Mais il s’est surtout amusé des humains qu’il a ramenés pendant deux mois à l’état de bêtes dans des cages. Ce fut l’arroseur arrosé ou bien, en d’autres termes : la vengeance du pangolin.
...................................................
Mardi 28 janvier
PROLOGUE
Retranscription du dialogue de l’émission de télévision d’Audrey & Co
Jean-Michel Apathie, Dr Kiersiek & Onfray
Verbatim1 de l’émission :
Audrey Crespo-Mara : Michel Onfray, il vous inquiète ce coronavirus ?
Michel Onfray : Oui, car je trouve qu’on joue un peu à la roulette russe ! Enfin : le gouvernement joue un peu à la roulette russe… On a une vingtaine d’avions, je crois, qui arrivent tous les jours de Chine et puis les gens descendent et on leur pose une question : « Vous avez mal à la tête ? Vous avez un peu de fièvre ? Non ? Allez-y. »
Et puis un sur dix, ai-je lu, se fait questionner et on distribue des petits bouts de papier à chacun en leur disant : « Si vous avez un problème, appelez le 15 », et puis tout le monde s’en va dans la nature !
Je ne sais pas combien ça fait, 5 000/6 000 personnes par jour qui arrivent de Chine et qui s’en vont dans la nature et qui peuvent contaminer donc !
Dr Kierzek : De toute façon on n’a pas la capacité de faire autrement, soit on interdit les vols et ça c’est une décision qui est lourde de conséquences, on se rappelle le SRAS en 2002/2003, c’est tout le tourisme qui était impacté, les vols étaient arrêtés.
Michel Onfray : C’est une affaire d’économie !
Dr Kierzek : Ce n’est pas qu’une affaire d’économie mais de psychose aussi, c’est pour ça que l’OMS ne va pas instituer l’état d’urgence comme il était question la semaine dernière parce qu’il n’y a pas de critères médicaux.
Michel Onfray : On peut bien dire : « On se protège et on arrête les vols !! » Il y a de l’économie en jeu parce que les Chinois sont ceux qui font marcher le commerce.
Dr Kierzek : Il n’y a pas de raison médicale non plus, encore une fois ce n’est pas un virus que vous attrapez et vous mourrez à tous les coups. Mais c’est pas du tout ça, on est plus sur un virus de type grippal, ça va être intéressant parce que ce jeune homme de 33 ans n’a pas de symptôme, il est testé positif au coronavirus en Allemagne mais il n’a pas de symptôme. Ça change la donne si à 33 ans il se retrouve en réanimation, intubé, ventilé et avec plus ou moins un décès à la clé, parce que là on se dirait effectivement il faut prendre des mesures drastiques. Mais est-ce qu’on prend chaque année des mesures drastiques pour la grippe ? Non. On n’arrête pas les vols de Chine et pourtant la grippe elle vient de Chine chaque année, on le sait. Donc tant que la virulence, la dangerosité du virus n’est pas un cran au-dessus, on n’est pas dans ces mesures-là. Là où je vous rejoins, c’est qu’on pourrait peut-être, notamment aux aéroports, contrôler de manière un peu plus systématique que ce n’est fait actuellement, ne serait-ce que pour la symbolique. Et c’est toujours bien de mettre un filet en disant ce filet, il ne prend pas tous les cas possibles mais au moins il y a toujours un filet, c’est toujours mieux que rien.
Thierry Moreaux : Sauf que ce cas allemand serait passé au milieu des filets parce qu’il est porteur du virus et qu’il ne le développe pas.
Dr Kierzek : Mais surtout il n’a jamais voyagé. Ma grand-mère disait que c’était mieux que rien, il vaut mieux mettre des tests, ça permet déjà de rassurer, sur Twitter je réponds à beaucoup de questions, plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi il n’y a pas ce contrôle, donc ça permettrait, même si ce n’est pas un contrôle efficace à 100 %, de filtrer, peut-être 1, 2, 3 personnes qui auraient de la température, de les orienter directement, plutôt que de les laisser partir dans la nature. Là où il va se poser une autre question, les citoyens français qui vont être rapatriés dans les quelques jours, il y a plusieurs centaines de personnes qui ne vont pas être mises en quarantaine mais en quatorzaine.
Michel Onfray : Oui moi, ce qui m’étonne, c’est qu’on nous rebat les oreilles avec le principe de précaution depuis des années, c’est-à-dire que, dans l’école primaire de mon village, on ne peut pas amener un gâteau pour l’anniversaire d’un petit garçon sous prétexte que la traçabilité n’est pas assurée et que le principe de précaution interdit ce genre de chose ! Mais, là, il n’y a plus du tout de principe de précaution ! C’est-à-dire qu’on sait qu’il y a une ville qui est contaminée, on sait qu’il y a des morts, une ville de plusieurs millions d’habitants qui est totalement confinée, qui n’a plus aucun contact avec le restant de la planète, et puis on vous dit : « Rentrez, circulez, il n’y a pas de problème. » On vous donne un petit papier où, en cas de problème, vous appelez, en sachant très bien qu’en appelant on aura encore un problème en arrivant à l’hôpital. Déjà, en temps normal, on a des difficultés à accueillir des gens aux urgences, on manque de lits et on leur dit : « S’il y a un problème, ne vous inquiétez pas, on va s’occuper de vous. » Je trouve que ce principe de précaution qui a été inscrit dans la Constitution, je crois à l’époque de Chirac…
Jean-Michel Apathie : (Interrompant.) Je pense qu’il n’y a pas assez de cas en France pour prendre les mesures que vous préconisez
Michel Onfray : Si la Chine interdit à une ville de plusieurs millions d’habitants que la circulation puisse se faire, on peut imaginer qu’eux, ils ont des informations inquiétantes !
Jean-Michel Apathie : La Chine gère plusieurs questions à la fois, que nous on n’a pas. Pour l’instant il n’y a pas de cas assez nombreux pour que l’on coupe les relations.
Michel Onfray : C’est le principe de précaution : qu’on n’aille pas au-devant de la difficulté ! Que la difficulté soit là, mais qu’on dise qu’on va faire le nécessaire…
Dr Kierzek : C’est assez impressionnant de voir les gens descendre de l’avion, on les a vus interviewés hier : « Est-ce que vous avez eu un contrôle ? » « Non, non. » Comme un contrôle d’alcoolémie, il y a le barrage et si vous n’avez pas envie de vous y soumettre vous pouvez passer à droite. Ce ne sera pas efficace à 100 % donc encore une fois on est dans un principe de précaution, la ministre a pris des précautions, est-ce qu’on peut aller un cran plus loin ? Probablement. Mais là je vous dis ce qui est la nouveauté, c’est ce sujet autochtone qui n’a jamais voyagé, il va changer la donne. Encore une fois il faut se calmer, ce n’est pas un virus qui est létal avec une mortalité extrêmement importante, on est plus sur une grippe, voire même avec une mortalité inférieure, mais à voir comment les choses évoluent.
Audrey Crespo-Mara : Merci pour toutes ces informations mon cher docteur.
...........................................................................................................................................................................
Bio:
Michel Onfray, né le 1er janvier 1959 à Argentan, est un philosophe, essayiste et polémiste français. Il est l'auteur de plus de cent quinze ouvrages dont certains ont connu un grand succès, y compris dans les pays non francophones où il est traduit en vingt-huit langues.
À la suite de l'accession de Jean-Marie Le Pen (Front national) au second tour de l'élection présidentielle française de 2002, il quitte sa carrière d'enseignant pour créer l'université populaire de Caen où il délivre pendant seize ans le cours « contre-histoire de la philosophie » qui est retransmis sur la station de radio France Culture.
Il intervient régulièrement à la radio et à la télévision sur des sujets politiques et sociaux. Ses prises de position suscitent de nombreuses controverses.
Samouraï
« TU VEUX PAS ÉCRIRE UN ROMAN SÉRIEUX ? » a conseillé Lisa à Alan, avant de le quitter pour un universitaire spécialiste de Ronsard. Depuis, Alan cherche un sujet de « roman sérieux ». Il veut profiter de l’été qui commence pour se plonger avec la discipline d’un guerrier samouraï dans l’écriture d’un livre profond et poignant. Ça et aussi s’occuper de la piscine des voisins partis en vacances. Or bientôt l’eau du bassin se met à verdir, de drôles d’insectes appelés notonectes se multiplient à la surface… Il y a chez Fabrice Caro une grâce douce-amère, une façon unique et désopilante de raconter l’absurde de nos vies.
..........................................................................
Cette semaine-là, à quelques jours d’intervalle, mon meilleur ami d’enfance s’est suicidé, Lisa m’a quitté et on annonçait qu’une météorite allait frôler la Terre à une distance suffisamment proche pour que l’on s’en inquiète– selon certains spécialistes, il n’était pas exclu qu’elle la percute. La date et l’heure étaient incroyablement précises, et je me suis toujours demandé comment les astronomes pouvaient calculer les trajectoires avec une telle précision alors que la météo à sept jours, elle, est à peine fiable. Un événement sur les trois s’est plutôt bien terminé, il faut toujours voir le verre à moitié plein– au tiers plein pour être exact. Le départ de Lisa a précédé le suicide de Marc, elle n’aurait pas poussé l’indélicatesse jusqu’à partir tout de suite après. Encore que. Quand la passion vous enflamme, toute considération rationnelle vous quitte et c’est absent à tout que vous traversez la vie, 7la vie avec ses suicides et ses météorites. De la même manière, Marc ne s’est pas suicidé parce que Lisa m’a quitté. Ces deux événements étaient totalement indépendants l’un de l’autre, ils n’étaient unis que par mon abattement et ma sidération. Il arrive parfois que tout soit concentré sur un laps de temps très court, un condensé d’événements, et après tout pourquoi pas. Comme disait ma mère quand on vidait les courses du coffre de la Talbot Horizon: Prends deux sacs d’un coup, ça évitera d’y revenir. Voilà: prends deux sacs d’un coup, ça évitera d’y revenir.
.................................................................................................................................................................
MYLÈNE
Je ne sais pas exactement en quoi consiste le fait de surveiller une piscine, comme si elle allait déguerpir à toutes jambes à la moindre occasion, mes voisins me demandent ça: est-ce que je voudrais bien surveiller leur piscine en leur absence. Ils partent en Grèce pendant quinze jours et ma mission, si je l’accepte, consisterait à mettre deux galets de chlore par semaine dans le skimmer, rien de bien compliqué, là le type joint le geste à la parole pour me montrer le skimmer, un petit panier en plastique blanc plongé dans l’eau au bord du bassin, les galets de chlore se trouvent dans un seau dans le petit local là-bas, donc deux par semaine et voilà, le tour est joué. Il ajoute que je n’hésite surtout pas à faire un plouf si l’envie m’en prenait, qu’elle serve au moins à quelqu’un pendant cette période, et je n’ose pas lui répondre que l’envie risque de ne pas forcément me prendre, que faire un plouf n’est pas dans la 11liste de mes priorités, que je ne comprends pas quel plaisir ont les gens à être dans une piscine. Il suffit, que moi, je pénètre dans L’eau (piscine, mer, baignoire, qu’importe le contenant) pour que le temps se mette subitement à s’étirer de manière irrationnelle. Je ne sais absolument pas quoi faire de cet élément. Nager, se mouvoir, faire des clapotis avec la paume de ses mains, prendre de l’eau dans la bouche et la recracher en jet, oui, bon, d’accord, mais pourquoi? L’immersion suscite immédiatement chez moi un ennui profond, m’apparaissent alors toutes ces choses que je pourrais faire ailleurs, hors de l’eau, je prends subitement conscience du temps qui passe, les minutes se concrétisent en une entité rare et friable que l’on se doit de chérir, un don divin qu’il ne faut gâcher à aucun prix, à ce stade je me mets généralement à penser à la mort. À l’entrée de chaque piscine municipale, sur l’écriteau, juste en dessous de Bonnet de bain obligatoire– Il est interdit de courir autour du bassin devrait figurer Il est déconseillé de penser à la mort. Je le remercie pour sa proposition et le sourire qu’il affiche trahit une fierté humaniste, comme s’il venait d’offrir un sac de riz à une famille du Yémen, une sorte de Bah c’est tout naturel, quand on a la chance comme nous de posséder une piscine, il faut savoir la partager. Mes voisins ont la gauche aquatique. Pendant qu’il m’explique le principe de pompe et de circulation de l’eau, je jette un œil à leur immense terrasse faite de dalles jaunes lumineuses sur laquelle, à l’ombre d’un store orangé, trône une table en bois massive, et je m’imagine aussitôt venir m’installer là tous les jours pour y écrire mon roman, j’y serais bien mieux que dans mon appartement encore chargé de la présence lourde de Lisa. Je me visualise attablé sous le store, devant mon ordinateur, cintré dans un peignoir brodé de mes initiales, un thé à la menthe dans la main, une cigarette dans l’autre, le regard tendu vers l'œuvre. À l’instar des enfants qui se targuent d’avoir des chaussures qui courent vite, il me semble que cette terrasse pourrait écrire quelque chose de qualité.
Mon premier roman, Partage des maux, paru l’année dernière, est passé totalement inaperçu. Il y est question d’une succession, les trois enfants, deux frères et une sœur, se disputant un tableau de leur mère récemment disparue dont on présume qu’il s’agit d’un Modigliani, et qui s’avérera finalement une vulgaire croûte, mais qui aura entre-temps servi de révélateur à tout un tas de tensions fraternelles et aura mis au jour les personnalités cachées de chacun. Sans compter les époux et épouses respectifs des uns et des autres ne faisant qu’ajouter à la cacophonie ambiante, une comédie prétexte à parler des liens familiaux, des rapports humains, ce genre de choses. Je n’avais eu quasiment aucune presse si ce n’est Biba qui m’avait attribué trois étoiles, On rit beaucoup dans cette comédie où rien ne va! Fier, j’avais montré la critique à Lisa et elle avait eu un sourire qui se voulait de félicitation mais s’était épuisé en chemin pour s’échouer sur un de ces sourires qui tapotent la tête du cancre quand il obtient un 6 au lieu de son 3 habituel. Puis elle avait ajouté, sur un ton qui n’avait pas l’air d’y toucher, Tu veux pas écrire un roman sérieux? Et cette phrase avait fini de m’achever. Non seulement Lisa trouvait que mon roman manquait singulièrement de profondeur, mais elle me reprochait d’avoir utilisé nombre de faits nous appartenant, et surtout de l’avoir vampirisée elle. Et force m’est d’avouer qu’effectivement, la Élise de mon roman lui ressemblait un peu. À ceci près que j’en avais fait un personnage névrosé, en tout cas plus que ne l’était Lisa, attaché à des futilités et pris d’accès d’hystérie un peu plus appuyés qu’ils ne l’étaient en réalité. J’avais eu beau lui répéter en boucle qu’il s’agissait d’un roman, et donc fait d’un matériau romanesque, non réel, elle n’en démordait pas, elle s’était sentie dépossédée, déformée, exposée, et tout un tas d’adjectifs que je trouvais excessifs mais qui, d’une certaine manière, étaient probablement justifiés. Non et puis, Élise, Lisa, y a rien qui t’interpelle là? Tu aurais pu au moins trouver un prénom plus éloigné…Alors que des auteurs font le tour des émissions pour parler de leur livre, ma période de promotion à moi avait consisté à répéter sans fin à mes proches Mais non il ne s’agit absolument pas de toi, c’est une fiction. Non seulement personne n’avait lu ce livre, mais les seuls qui l’avaient lu étaient ceux dont je m’étais inspiré pour l’écrire (ou qui croyaient que je m’étais inspiré d’eux) et qui me le reprochaient amèrement, ceux-là mêmes que précisément je n’aurais pas voulu avoir pour lecteurs. J’avais même reçu un message d’une ex-petite amie que je n’avais pas revue depuis mes vingt ans, qui me disait être choquée et déçue que j’aie pu utiliser une anecdote nous appartenant. Nous avons dix sept ans, dans la perspective de notre premier rapport je vais acheter des préservatifs à la pharmacie, développant des trésors de discrétion et de détachement tant je suis gêné par la situation, lâchant même entre mes dents mais suffisamment fort Rhaaa je sais plus si c’est ça qu’il m’a demandé, pour laisser croire que je ne suis qu’un émissaire. Le lendemain soir je vais chercher mon amoureuse chez elle et, tétanisé, découvre en entrant dans son salon ses parents en train de prendre l’apéritif avec un autre couple dont la femme n’est autre que la pharmacienne. En lisant ça, mon ex s’était sentie trahie, alors que l’anecdote était largement romancée: dans le roman je pousse la situation à l’extrême, la pharmacienne, un peu ivre, me demande en plaisantant si c’était la bonne taille, décuplant mon malaise. Rien de tout ça dans la réalité, bien évidemment, elle n’avait rien dit, elle avait respecté le secret professionnel, du moins en ma présence. Je trouvais la réaction de mon ancienne fiancée injustifiée, non seulement elle était la seule à savoir que cette anecdote s’appuyait sur une base réelle, mais en plus j’avais changé le prénom– certes, Léa s’était transformée en Cléa, là aussi j’aurais pu faire un effort d’imagination, c’est vrai. C’était peut être ça mon problème: je ne changeais pas assez de lettres dans les prénoms. Comme un voyou qui repeindrait une voiture volée mais qui, par paresse, ne repeindrait que l’aile gauche. Si mon livre avait été un best-seller les réactions auraient été radicalement différentes. Ça n’est pas le vol qu’on vous reproche, c’est l’échec. On veut bien être utilisé, mais pas dans les fiascos, sinon c’est double peine.
..........................................................................
Bio:
Fabrice Caro est né en 1973. Il a écrit et dessiné une trentaine de bandes dessinées, dont le fameux Zaï Zaï Zaï Zaï. Il est aussi l’auteur de romans parus aux Éditions Gallimard, Figurec (2006), Le discours (2018) et Broadway (2020
Jusqu'en enfer
Résumé:
Dans une planque djihadiste en Syrie, Maxime Barelli, capitaine au sein des forces spéciales, découvre une drogue inconnue, la drogue de la sauvagerie. À Paris, le lieutenant Yann Braque enquête sur la mort d'une femme dont le crâne a littéralement implosé alors qu'elle se livrait à un jeu sexuel en ligne. À des milliers de kilomètres de là, dans une forêt africaine, une section de paras est anéantie. Des événements que rien ne semble relier. Du moins en apparence... Car cette violence sans précédent qui déferle sur le monde a peut-être une seule et même origine. Et si, à force d'aller toujours plus loin, la science finissait par fabriquer la haine et semer la mort ?
..................................................................................................................................................................
La fille était en transe. Elle avait éteint toutes les lumières, et seule la lueur glauque qui émanait de la ville laissait deviner sa silhouette mince quand elle passait devant la fenêtre battue par la pluie, côté rue des Pyrénées.
Soirée solitaire. Elle était pieds nus, en culotte et T-shirt. Le casque intégral en Bakélite noire recouvrait sa tête, ne laissant libre que la bouche. C’était un casque dernier cri, un modèle russe dessiné comme un véritable objet d’art avec deux antennes sur le côté droit et une visière en verre fumé ; il avait coûté une fortune et ce luxe détonnait dans son intérieur plutôt crade.
Apparemment, la transmission était de bonne qualité. La fille oscillait sur place, langoureusement. Comme si elle avait été au téléphone avec un amant éloquent, sa bouche était à demi ouverte, à l’affût du plaisir. Ses deux mains, doigts écartés, étaient posées sur son ventre, le bassin propulsé vers l’avant, les muscles des cuisses tendus, les genoux fléchis.
Un corps bien proportionné. La petite quarantaine. Ceux qui la connaissaient sans casque lui trouvaient un charme un peu fade, mais ils ne l’avaient jamais vue dans cet état-là. De ses lèvres s’échappait en ce moment un halètement sourd qui s’accélérait. Jouissance urbaine. Les mains se dirigèrent alors vers le pubis. À travers le tissu, la pointe de ses seins durcissait. Une violente bourrasque fit trembler les vitres, mais la fille était bien trop loin dans son fantasme pour s’en émouvoir.
Dans la chambre d’à côté, une pièce de la taille d’un grand placard, l’étudiant en médecine ne ratait rien, malgré la pénombre, du show solitaire de sa voisine. L’œil collé à un trou dans le mur, la gorge sèche d’excitation, il suivait du regard les mains qui remontaient maintenant vers la poitrine. Ce n’était pas la première fois que Sonia partait dans un délire du genre. Il connaissait. D’abord du tchat, une cavalcade sur le clavier, et puis le jeu. Ce qu’il préférait, c’étaient ses gémissements de féline en chaleur. Il en perdait carrément la tête. Impossible de se concentrer sur ses cours de biochimie, de penser à autre chose qu’à ce spectacle hypnotisant.
La tension montait. La fille n’arrivait plus à contenir les feulements qui venaient jusqu’à lui par vagues. Elle y était presque.
Soudain, comme si on la réveillait brusquement de son coït virtuel, elle se mit à jurer :
— Saloperie de casque !
Ce furent les derniers mots que saisit l’étudiant. Sonia continua à parler, mais il n’entendait plus qu’un galimatias de plus en plus lent d’onomatopées incompréhensibles. Il la vit faire un pas vers le sofa rose. Sa jambe gauche partit brutalement en arrière, donnant l’impression qu’elle ne la contrôlait plus. Elle essayait d’arracher le casque, mais ses mains glissaient sur la Bakélite. Sa jambe droite, quant à elle, se mit à convulser comme si elle voulait se séparer du reste de son corps. La jeune femme tenta alors de s’agripper à un meuble, heurta une lampe qui s’alluma avant de se fracasser sur le lino. La jambe folle se déroba tout à coup et Sonia chuta lourdement contre un des bras du sofa.
Là, le flot de syllabes affolées se mua en une plainte de plus en plus aiguë. Elle tentait toujours désespérément de retirer le casque avec des gestes erratiques. Ses fonctions motrices semblaient complètement déréglées. Le gémissement cessa. Et elle hurla. Un hurlement abominable, féroce, le cri d’une bête broyée, à glacer le sang. Il ne dura que quelques secondes. Une éternité. Puis le corps de Sonia glissa sur le lino et le casque, toujours sanglé, laissa échapper un flot rouge. La jambe droite continua pendant quelques instants ses mouvements réflexes, après quoi le silence tomba, aussi noir et profond que la terreur de l’étudiant.
*
* *
Tous les habitants de l’immeuble étaient dans l’escalier. Dragos Popescu, le légiste, se serait cru sur un tournage de série policière, mais, heureusement, le foutoir s’arrêtait à l’étage de la victime.
Il n’y avait rien à dire, les gars avaient travaillé proprement. On avait ramené les voisins de palier chez eux, et les journalistes étaient parqués sur le trottoir. Quant à la scène de crime, elle n’avait pas bougé. Personne n’avait eu l’idée saugrenue d’ouvrir la fenêtre, le genre d’erreur de débutant qui pouvait vous faire rater l’heure exacte du décès. Même si, dans le cas présent, il n’y avait pas tellement de doute. En effet, l’étudiant affirmait avoir téléphoné au 17 sans attendre.
Ce dernier était d’ailleurs toujours sur le pas de sa porte, blanc comme un linge, pâleur que ne faisait que renforcer la loupiote qui diffusait une lumière blafarde au plafond. Le médecin s’approcha de lui.
— Dragos Popescu. Médecin légiste. Tu étais avec la victime quand c’est arrivé ?
— Non. J’étais chez moi.
L’étudiant coula un regard embarrassé vers le lieutenant de la PJ qui arrivait à son tour, un échalas de presque deux mètres qui ricana :
— Tu parles ! Il matait à travers le mur. Un petit show de cul gratos, ça se refuse pas. Et tant mieux pour nous. C’est pas tous les jours qu’on a un témoin oculaire. Une petite branlette pour lui, un grand pas pour l’enquête.
Yann Braque partit d’un grand rire. Malgré son visage en lame de couteau et ses dents de loup, il semblait d’un naturel joyeux. Cramoisi, l’étudiant, lui, ne savait plus où se mettre.
— Alors comme ça, tu as tout vu ?
— Oui.
— Qu’est-ce qui s’est passé ?
— C’est le casque…
— Mais encore…
— Il a explosé.
— Explosé ? Explosé comment ?
— Elle a essayé de l’enlever. Et puis il a explosé. Enfin, c’était pas vraiment une explosion. Plutôt…
Le gamin cherchait le mot exact, mais l’image horrible qui occupait son esprit l’empêchait de réfléchir.
— Ce n’est pas le casque. C’est sa tête. C’est sa tête qui a explosé dans le casque. Vous comprenez ?
Il était livide. Il avait voulu se rincer l’œil et, maintenant, il allait lui falloir un an de psy pour oublier cette boucherie. Le légiste écarta les bras, posa ses deux mains gantées de latex sur l’encadrement de la porte et jeta un regard dans l’appartement de Sonia Callaire. Puis il se retourna vers le lieutenant.
— J’y vais, annonça-t-il.
Il enfila sa combinaison Tyvek blanche et pénétra dans le deux pièces. Quelques secondes après, il y eut un brouhaha derrière lui et il entendit la voix rauque du lieutenant Braque qui mugissait dans l’escalier.
— Nom de Dieu ! J’ai dit : pas de journalistes. C’est quand même pas compliqué à comprendre ? Soit vous descendez tout seul, soit je vous aide.
Le légiste eut un sourire. Aucun journaliste n’avait envie de se faire « aider » par Yann Braque. Problème réglé. Après avoir enfilé ses gants, le lieutenant pénétra à son tour dans l’appartement.
— Je vous laisse faire votre boulot, lança-t-il. Après, j’embarque l’ordinateur au commissariat.
Dragos Popescu étudia le corps. La victime était couchée de trois quarts sur le lino. Une flaque de sang s’étalait autour de sa tête et son T-shirt « Cordial Web » n’avait pas été épargné. Elle avait glissé du sofa et son bras droit, dressé, semblait montrer le plafond ou le haut de la fenêtre. Par acquit de conscience, le médecin vérifia le pouls. Rien. Puis l’hypostase. La lividité cadavérique était normale. Les fluides colorés avaient déjà commencé à quitter les petits vaisseaux pour diffuser dans les tissus interstitiels. La peau en contact avec le sol était blanche : la fesse, la jambe, le flanc et l’épaule côté gauche. Le reste du corps était rose. Il n’avait pas été déplacé, ça se confirmait.
Toujours accroupi, le légiste se décala de quelques centimètres pour mieux observer la tête. Sans instrument, il ne pouvait malheureusement que relever la visière. La bouche déformée de la victime lui fit penser à un AVC, mais ses yeux exorbités, deux disques blancs qui semblaient posés sur un masque de sang à demi coagulé, évoquaient plutôt un traumatisme crânien.
Debout près de la fenêtre secouée par l’orage et battue par la pluie, le lieutenant Yann Braque se concentra un instant sur le cadavre, puis sur le légiste. Après quoi il songea à l’étudiant. Même si celui-ci avait l’air complètement choqué, appeler la police pour se disculper, c’était une des plus vieilles ficelles criminelles. Il était trop tôt pour parler d’homicide, mais qui disait mort suspecte disait liste de suspects. Faute d’autre candidat pour le moment, le gamin y figurait en première position.
À genoux sur le lino, penché au-dessus de Sonia Callaire, Dragos Popescu réfléchissait. À l’école, on lui avait appris à attendre d’avoir rassemblé tous les indices pour tirer des conclusions, mais c’était plus fort que lui. Avant même qu’il sache quoi que ce soit, la petite lumière rouge qui s’allumait dans sa tête lui disait qu’il était devant un cas sacrément spécial. En effet, si sa raison et sa logique lui disaient que la victime avait subi un trauma ultraviolent, force était de constater qu’il n’y avait aucune trace de choc sur la coque en Bakélite. Alors, d’où était venu le coup ?
Le médecin releva la tête et croisa le regard interrogateur du flic, un regard gris-bleu, intelligent, perçant, qui tranchait avec l’humour balourd qu’il avait infligé à l’étudiant. Le scientifique haussa les épaules et se redressa sans quitter des yeux le casque ensanglanté. Une affaire tordue en perspective.
Sur la table, une planche soutenue par des tréteaux, l’ordinateur était toujours allumé. Un message clignotait en lettres bleues sur l’écran couvert de poussière et maculé de taches : « téléchargement interrompu ».
..............................................
La capitaine Maxime Barelli n’aimait pas les surprises et il fallait reconnaître que la mission avait été préparée avec minutie. Entre la côte abkhaze et le hangar, le minutage effectué par la DGSE avait été parfait. Le quad au moteur ultrasilencieux avait roulé sur le sentier cabossé comme sur une autoroute. Il ne serait pas de trop pour rapporter le matériel.
Les sept cibles entrèrent en réunion à l’heure prévue, quatre minutes exactement avant de mourir. L’exercice avait assez été répété pour devenir un enchaînement de réflexes conditionnés. Un mécanisme pur. Une performance désincarnée. À force d’avoir travaillé sur le comment, le temps des pourquoi était passé depuis longtemps. Un groupe entraîné, c’étaient des réponses qui s’emboîtaient, sans questions. Ainsi, aucun membre du commando français ne s’interrogeait sur le bien-fondé de la mission consistant à éliminer sept informaticiens vêtus comme des adolescents et rassemblés sous haute protection dans un hangar perdu du Caucase. Ne pas penser. Même pour des soldats aguerris, il est difficile de tuer des hommes jeunes, d’allure décontractée et sans armes. Mais il suffisait de se concentrer sur autre chose, le timing, par exemple.
La capitaine Maxime Barelli ouvrit le feu avec son Sieg prolongé d’un silencieux. Deux fois. Les deux hommes les plus proches de la porte tombèrent, une expression d’intense surprise sur le visage. Elle avait fait ce choix pour gêner les autres en cas de tentative de fuite. La femme au bandana noir, elle, mourut plus vite que prévu parce qu’elle avait porté la main à sa poche. Les autres furent abattus sans bruit, comme au stand, avec une facilité irréelle de jeu vidéo. Le « pop » des silencieux faisait penser au staccato d’une imprimante haut de gamme. Les cibles ne comprirent pas ce qui leur arrivait.
Dans le fond, rien d’étonnant : les hackers vivaient dans un monde à part, un monde où les conséquences de leurs actions étaient lointaines, impalpables et floues. D’une pression du doigt sur un clavier, ils pouvaient déclencher l’apocalypse dans n’importe quelle organisation à travers la planète, ruiner des entreprises, briser des familles et déstabiliser des États. Ce soir-là, à quelques kilomètres de Soukhoumi, capitale délabrée d’un État fantoche, la riposte commençait.
Le commando vérifia chaque corps. Le hangar fut nettoyé et intégralement vidé en quatre minutes chrono, à peine plus vite que dans l’exercice de simulation à Mont-Louis. Ils avaient vu un peu juste pour le transport du butin, mais ils réussirent à tout mettre dans le quad alors que le soleil déclinait rapidement. Documents, disques durs, téléphones. Tout devait partir. Le succès de l’opération « Neurone-1 » en dépendait. Mais au moment où ils s’apprêtaient à lever le camp définitivement, ils furent accrochés. Et ça, la DGSE ne l’avait pas prévu. Gonzo, l’artificier, trinqua : il passa la porte du hangar le premier et fut allumé tout de suite. Une balle dans la main droite. Bouillie de chairs sanglantes.
Le groupe se replia à l’intérieur et on banda la blessure à la hâte. Ils devaient filer avant que les renforts de ces salopards débarquent, mais d’abord il fallait savoir à combien de salopards on avait affaire. La capitaine et Foxy disposaient d’un numéro bien rodé, répété des dizaines de fois. Pas besoin de se parler. Elle se dirigea donc vers un coin du hangar qu’elle avait repéré parce qu’il manquait un morceau de tôle au niveau du sol et se coucha par terre, le trépied du fusil à lunette posé sur une plinthe en métal. Foxy, lui, retourna à la porte du hangar, s’accroupit et la fit pivoter d’un quart de tour sur ses gonds. De l’autre côté du no man’s land, quelque chose bougea dans les fourrés et, dans sa lunette, la capitaine Barelli vit distinctement deux casques. Trente secondes plus tard, Foxy ouvrit grand la porte comme s’il s’apprêtait à quitter les lieux, provoquant ainsi un autre mouvement : deux M16 sortirent de la végétation avec, derrière chaque arme, un visage de brute mangé par une barbe imposante. Le doigt de la capitaine pressa deux fois la détente. Le sifflement du vent emporta le bruit des détonations alors que les types s’effondraient. La voie était libre. Le groupe s’élança dehors.
Gonzo était hors course. Il fallait le remplacer et neutraliser l’hélico pour empêcher les salopards de les suivre jusqu’à l’unité navale. Rien ne devait relier cette opération à la France. Sans tarder, il y eut deux volontaires pour prendre le relais, mais Maxime les récusa d’un geste. Pour placer une charge explosive sous la turbine de l’hélico, la meilleure, après Gonzo, c’était elle. Point barre. La capitaine dut hurler afin de se faire comprendre, et pas seulement à cause du vent. Pas le temps de discuter. Elle ne donnait pas dans la démocratie participative. Ce n’était pas son truc. Alors, quand Foxy lui rappela qu’en tant qu’officier cheffe de groupe elle n’était pas supposée faire ce genre de choses elle-même, elle lâcha simplement :
— Fermez-la, Foxy, arrêtez de m’emmerder et foutez le camp. Je serai trente secondes derrière vous. On se retrouve dans les kékés au sud de la route. Est-ce qu’il y a un truc pas clair ?
— Négatif, mon capitaine.
— Alors exécution, bon Dieu.
Dans la foulée, elle alla piéger l’hélico. Un jeu d’enfant. Puis elle s’élança vers les buissons de kékés, vers Foxy, Gonzo et les autres, qui l’attendaient pour se replier vers la côte. Jamais Maxime ne se sentait plus vivante que dans ces moments-là. Des mois d’entraînement, quelques minutes d’action. Elle fendait la tempête à grandes enjambées. La pluie redoublait, brouillant sa vue. Ce fut là, à mi-chemin des arbres, les oreilles déchirées par le vent, que le ciel lui tomba sur la tête. Voile noir.
*
* *
La main gauche de l’homme était posée sur la nuque de la capitaine Barelli et la maintenait au sol. De l’autre, il cherchait à agripper le couteau recourbé qu’il portait contre son ventre. Le visage dans la boue, elle étouffait. Le type soufflait sur sa nuque une haleine de tabac, d’épices et de vin. Son corps de tueur était posé en travers du sien et le pressait contre les pierres de la piste. Elle ne ressentait plus ni la violence du vent ni la pluie diluvienne, seulement ce poids mort.
............................................................................................................................................................
Biographie:
Stéphane Marchand est un journaliste et écrivain.
En 2016, il publie, sous le nom de Stefan Palk, son troisième roman, un thriller captivant, "Cognitum".
Stéphane Marchand est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE).
Il commence sa carrière en 1987 au journal "Le Figaro" comme reporter au service Étranger. Il est envoyé l'année suivante à Jérusalem comme correspondant alors que se termine la guerre du Liban et que commence la première Intifada. À la fin de 1990, il est correspondant du Figaro à Washington, où il couvre la fin du mandat de George Bush (père) et le premier mandat de Bill Clinton. Il analyse en particulier, de Washington, les suites de la première guerre du Golfe et les guerres des Balkans.
De retour en France, toujours au Figaro, il est rédacteur en chef du service de Macroéconomie. En 2006, il est directeur adjoint de la rédaction du Figaro, en charge des pages Débats Opinions où il signe des éditoriaux.
Il quitte le Figaro en 2008 et fonde, puis dirige jusqu'en 2009 le journal économique en ligne E24.
Il est chroniqueur économique sur la chaîne France 24 et rédacteur en chef de ParisTech Review, une revue anglophone consacrée aux technologies et destinée à promouvoir dans les grands pays émergents, les enseignements et les unités de recherche des écoles de ParisTech, en partenariat avec la Harvard Business Review, la revue Knowledge@wharton et le journal Les Echos. Il est chroniqueur scientifique au journal L'Opinion.
Ses œuvres:
Cinq enquêtes :
Les Secrets de votre cerveau, fayard, 2017
La Ruée vers l'intelligence, Fayard, 2012
Quand la Chine veut vaincre, Fayard, 2007 ;
Arabie Saoudite : la menace, Fayard, 2003 ;
Les Guerres du luxe, Fayard, mai 2001, 382 p. (ISBN 978-2-213-60953-9)
Quatre essais :
L’affaire du plombier polonais éditeur=Fayard, 2006, 279 p. (ISBN 978-2-213-62713-7) ;
L’Europe est mal partie, Fayard, 2005 ;
Le Commerce des illusions : À quoi sert Alain Minc ?, Lattès, 2000;
French Blues, First, 1997.
Quatre romans :
Face Mort, Fleuve Noir, 2020
Cognitum, Philippe Rey, 2016
Le Complot de Novembre, Lattès, mai 1996, 358 p. (ISBN 978-2-7096-1704-8) ;
L’Égyptien, Lattès, 1998 ;
Le chat du bibliothécaire (Tome 3) - Théâtre macabre
RÉSUMÉ
L'université d'Athena invite un nouvel auteur entre ses murs : Connor Lawton, un jeune dramaturge connu pour son franc-parler et son écriture cinglante. Charlie fait la rencontre de ce personnage acerbe et prétentieux, qu'il n'apprécie guère. Toutefois, en parallèle, il se réjouit de retrouver sa fille Laura, embauchée grâce à Lawton pour remplacer temporairement une professeure de la fac. Mais c'est compter sans les drames qui semblent s'accumuler dans cette bourgade paisible du Mississippi. Car, clou du spectacle, alors que Lawton achève sa nouvelle pièce de théâtre, il est assassiné. Et le suspect numéro un n'est autre que Laura, qui semblait entretenir d'intimes relations avec le défunt ! Persuadé que sa fille est innocente, et aidé de son fidèle compagnon Diesel, Charlie part à la recherche de preuves contre les ennemis de Connor, particulièrement nombreux, parmi lesquels se cache le véritable meurtrier...
............................................................................................................................................................
Connor Lawton avait fait très, très mauvaise impression lors de sa première visite à la bibliothèque municipale d’Athena. Et à présent, quatre semaines plus tard, j’en avais suffisamment vu du dramaturge pour savoir que cela ne s’arrangeait pas en le fréquentant. Si bien que je maudis silencieusement ma malchance en le voyant s’approcher du comptoir d’accueil du service de documentation, où j’étais posté cet après-midi-là pour aider les usagers. Un gazouillis interrogateur me parvint depuis le sol. Je baissai les yeux vers Diesel, mon maine coon de trois ans. Il avait le don de sentir quand quelque chose ou quelqu’un générait chez moi du stress ou de l’inquiétude. Je ne pus m’empêcher de sourire. — Tout va bien, mon brave. Pas de quoi s’en faire. Diesel gazouilla de nouveau avant de s’étirer, rassuré. — Vous parlez à vos pieds ? s’enquit Connor Lawton avec un sourire narquois. Entre son nez cassé, son crâne rasé et sa silhouette musculeuse, il avait plus l’air d’un boxeur que d’un auteur dramatique. Ce jour-là, il portait un débardeur qui exposait les tatouages colorés 9de ses avant-bras. Les motifs de style japonais contrastaient nettement avec sa peau bronzée et le tissu blanc. Un unique diamant scintillait à son oreille gauche. — Non, à mon chat. Vous vous souvenez de lui ? — Malheureusement, grimaça Lawton. Rarement vu une bestiole aussi farouche. Je me retins de rire. Diesel appréciait pratiquement tous ceux qu’il rencontrait. C’était un félin très sociable et facile à vivre. Comme moi, à vrai dire. Mais certaines personnes le prenaient à rebrousse-poil, et c’était ce qu’avait fait Lawton lors de leur première rencontre. Il lui avait immédiatement passé une main entre les pattes pour lui gratter le ventre. Agacé par cette prise de contact malvenue, Diesel s’était mis à gronder. Lawton avait vivement retiré sa main, et mon chat avait tourné les talons. Depuis lors, Diesel gardait ses distances avec l’écrivain, qui semblait en prendre ombrage. — Ça m’étonne qu’on vous laisse emmener un animal comme lui à la bibliothèque, commenta Lawton. J’espère qu’elle va pas se transformer en refuge, ajouta-t-il avec son accent traînant. Je réprimai un soupir. Diesel avait posé une patte sur mon genou. En se redressant sur ses pattes arrière, il serait assez grand pour voir mon interlocuteur de l’autre côté du comptoir. — Que puis-je faire pour vous aujourd’hui, monsieur Lawton ? — Où sont les archives de journaux ? Il fronça les sourcils, l’air vaguement mal à l’aise. — Des recherches pour la pièce que je suis en train d’écrire, précisa-t-il. Ah, oui, la pièce. Il ne manquait jamais une occasion de la mentionner. À ce stade, tous les habitants 10d’Athena étaient informés que le jeune et brillant Connor Lawton, coqueluche de Broadway et d’Hollywood, allait passer les deux prochains semestres en ville, dans le cadre de la résidence d’écriture de l’université. La rentrée n’aurait lieu que dans dix jours mais Lawton était arrivé plus tôt pour s’installer et « laisser la Muse s’imprégner de l’atmosphère féconde du Sud littéraire, patrie d’auteurs immortels comme William Faulkner,
Eudora Welty et Flannery O’Connor ». Il ne semblait pas y avoir de limites à sa prétention. Il m’avait même confié avoir été baptisé en hommage à Flannery O’Connor mais s’être débarrassé du « O’ » parce que cela faisait trop « artiste qui se la joue ». — Vous cherchez d’anciennes éditions du journal local ? demandai-je. Nous avons accès à un certain nombre d’archives en ligne, mais la Gazette d’Athena n’a pas encore été numérisée. Rien avant 1998 en tout cas. — Que du local, du moins dans l’immédiat. Lawton me dévisagea, le front plissé. — Si vous voulez bien me suivre, dis-je en sortant de derrière le comptoir. Je vais vous montrer où se trouvent les microfilms. — Ouais. Lawton se rapprocha en désignant quelque chose derrière moi. — C’est obligé que le chat nous accompagne ? — Oui, répondis-je en lançant un coup d’œil à Diesel. S’il le souhaite, en tout cas. Mon chat leva son regard intense vers moi, émit deux gazouillis, puis se détourna pour retourner s’asseoir auprès de ma collègue Lizzie Hayes. Bien vu, Diesel. Lizzie est beaucoup plus sympa.
— Suivez-moi, dis-je de nouveau en reprenant ma route. J’entendis Lawton marmonner quelque chose en m’emboîtant le pas. Nous remontâmes le couloir le plus proche, et je lui indiquai une petite salle occupée par plusieurs classeurs à tiroirs, deux tables et deux lecteurs de microfilms. Je m’arrêtai à côté des classeurs. — Les films de la Gazette d’Athena sont stockés ici. Vous trouverez les dates inscrites sur chaque tiroir. Quand vous aurez terminé avec une pellicule, merci de la placer dans ce panier au sommet du meuble. Je m’interrompis, le temps de me racler la gorge. — Avez-vous déjà utilisé ce type de matériel auparavant ? Lawton s’approcha avec un hochement de tête. Je m’écartai pour le laisser examiner les étiquettes sur les compartiments. Il s’accroupit et en tira un pour examiner son contenu. — Bon, si vous n’avez besoin de rien d’autre, je retourne à l’accueil. — Ouais, merci, répondit Lawton. — Avec plaisir, répondis-je, surpris. Je l’avais aidé à plusieurs reprises mais c’était la première fois qu’il daignait me remercier. Je jetai un coup d’œil à ma montre en retournant vers l’accueil. 14 h 45. Plus que quinze minutes avant que Diesel et moi puissions rentrer chez nous. Une pause serait la bienvenue. Après une semaine longue et étouffante, je me réjouissais déjà à l’idée de faire une petite sieste avant de préparer le dîner. Je repris ma place, l’esprit tourné vers différents menus potentiels. Diesel délaissa Lizzie pour revenir vers moi. Je lui grattai la tête tandis qu’il se frottait contre ma jambe. De nature affectueuse, il ne s’éloignait jamais beaucoup de moi, sauf pour passer du temps avec l’un de ses nombreux amis humains. Mon petit compagnon avait beaucoup de succès auprès des usagers de la bibliothèque et se soumettait volontiers à leurs caresses… tant qu’il ne s’agissait pas d’enfants prompts à lui arracher des touffes de poils. Je renseignai deux personnes sur la façon d’utiliser les archives. Consultant de nouveau ma montre, je constatai que le quart d’heure s’était réduit à trois minutes. La nouvelle employée de la bibliothèque, Bronwyn Forster, s’approcha, un sourire aux lèvres, prête à prendre le relais. — Bonjour, Charlie. Du monde aujourd’hui ? — À peu près comme d’habitude, répondis-je. La fréquentation sera en hausse avec la reprise des cours la semaine prochaine.
Bronwyn opina du chef tout en caressant le crâne de Diesel. Elle lui adressa quelques onomatopées affectueuses auxquelles il répondit en ronronnant. Il devait, comme moi, estimer que Bronwyn – qui était toujours d’humeur égale – était un vrai rayon de soleil, en comparaison de l’odieuse mégère qu’elle avait remplacée deux mois plus tôt. J’attendis qu’elle ait fini de le papouiller, puis Diesel et moi lui dîmes au revoir, ainsi qu’à Lizzie. Je récupérai ma serviette dans le bureau que je partageais avec l’une des bibliothécaires à plein temps lors de mes interventions bénévoles du vendredi. J’enfilai son harnais à Diesel puis y accrochai sa laisse. Nous étions prêts à partir.
................................................................................................................................................................
Biographie:
Nationalité : États-Unis
Miranda James est le pseudonyme de Dean James, un Mississippien de septième génération récemment rentré chez lui après plus de trente ans au Texas. Fan de mystère depuis l'âge de dix ans, il écrit son premier roman à l'âge de douze ans. La seule copie de The Mystery of the Willow Key a disparu il y a des années, mais comme elle était très dérivée de la série mystère de Nancy Drew et Trixie Belden, c'est probablement une bonne chose.
Actuellement bibliothécaire au Texas Medical Center à Houston, Dean a publié des articles sur des sujets de bibliothéconomie, d'histoire de la science/médecine et de romans policiers.
Dean vit avec deux jeunes chats, des milliers de livres et pense fréquemment à tuer des gens – mais seulement dans les pages de fiction.
La Ville des Os
Quand Ava Gold, première inspectrice de New York, est appelée pour enquêter sur l’assassinat d’une jeune femme sous le pont de Brooklyn, elle se rend vite compte que ce n’est pas un meurtre ordinaire – et qu’elle se heurte à un tueur qui n’a rien de banal. Pour le trouver, ses recherches vont la mener dans des rues mal famées et sur les docks du Brooklyn des années 20 en plein essor.
LA VILLE DES OS (Un Roman Policier Ava Gold – Tome 3) est le troisième d’une nouvelle série attendue par l’auteur no1 et meilleur écrivain au classement d’USA Today : Blake Pierce. Son best-seller Sans Laisser de Traces (en téléchargement gratuit) a reçu plus de 1000 avis à 5 étoiles.
Dans les rues mal famées du New York dans années 1920 Ava Gold, veuve de 34 ans et mère célibataire, a gravi les échelons afin de devenir la première inspectrice à la criminelle de son commissariat. Elle est des plus endurcies, et a bien l’intention de se défendre dans ce monde d’hommes. Mais lorsqu’une adolescente est assassinée, même Ava est ébranlée.
Mais Ava, qui doit faire face au ressentiment et à l’opposition des forces de police entièrement masculines, a été transférée dans un commissariat de ville, et est constamment harcelée dans l’espoir qu’elle abandonne la course.
Ava, poussée à bout, va devoir compter sur son intellect brillant pour entrer dans l’esprit du tueur, faire ses preuves, et l’arrêter avant qu’il ne frappe encore.
Thriller au suspense mené tambour battant et rempli de rebondissements étonnants, la série authentique et à l’ambiance bien particulière Ava Gold est captivante et nous fait aimer un personnage fort et brillant, qui capturera votre cœur et vous fera lire jusqu’au bout de la nuit.
..................................................................................................................................................................
PROLOGUE
Millie Newsom ne cessait d’entendre que le monde changeait pour le mieux, mais c’est à peine si elle avait pu le constater ne serait-ce qu’un peu. En marchant dans la rue elle se sentait encore comme une citoyenne de deuxième classe, en particulier car elle n’était qu’une femme. D’après les mentalités et débats tenus partout dans New York, Millie croyait qu’un jour viendrait où les femmes seraient considérées comme des égales, mais elle doutait de le voir au cours de sa vie.
Son travail en était un bon exemple. Elle était reporter depuis deux ans maintenant et même si elle faisait partie des meilleurs de son journal, elle n’était pas vue comme seulement une journaliste, mais une femme journaliste – comme si avoir des seins faisait d’elle quelqu’un de pire ou meilleur qu’un homme. Malgré tout, elle savait qu’elle était chanceuse d’avoir ce poste car le journalisme, comme toute autre profession, était majoritairement un travail d’homme.
Millie n’était pas vraiment un nom courant, pas même pour ceux qui mettaient un point d’honneur à lire les journaux quotidiennement. Mais suffisamment de gens la connaissaient dans son propre journal et les feuilles de chou concurrents. Elle était douée dans son travail et bien qu’il semblât douloureux pour certains de l’admettre, elle savait que c’était vrai. Elle utilisait cette assurance pour garder un bon pas et avoir l’esprit tranquille tandis qu’elle marchait dans les rues de Brooklyn à cinq heures et quart, avant de traverser la route et de faire de son mieux pour se fondre dans la masse. C’était un peu plus dur ici à Brooklyn que dans d’autres quartiers plus animés de la ville. Celui-ci dégageait une atmosphère de nouveauté et d’excitation tandis qu’il semblait grandir de jour en jour, mais il lui manquait tout de même l’animation et le dynamisme auxquels elle était habituée plus près de Manhattan.
Millie s’était habillée aussi simplement que possible, afin de ne pas attirer l’attention sur elle. On lui avait confié la tâche de prendre en filature un membre connu de la pègre, dans l’espoir de publier un article concernant le soi-disant succès de la mafia dans des opérations de contrebande. Elle regarda devant elle et vit sa cible au bout de la rue. Il
se dépêchait et sa tête était tournée droit devant lui. Millie faisait de son mieux pour conserver un pas régulier, car elle voulait rester juste assez loin derrière le mafieux pour qu’il ne la voie pas, mais suffisamment prêt pour ne pas le perdre.
« Millie ! Eh, Millie ! »
Le murmure mentionnant son nom dans son dos l’effraya et l’irrita en égale mesure. Elle marqua un court temps d’arrêt et regarda derrière elle. Un homme mince et à l’air bien trop jeune la suivait. Son nom était Ronald Amberley, un journaliste prometteur à qui les rédacteurs en chef avaient demandé de la suivre. D’après eux, c’était dans le but qu’il puisse apprendre d’elle, mais elle ne pouvait s’empêcher de se demander si ce n’était pas pour associer secrètement une présence masculine à ses succès. Elle n’avait pas aimé l’idée au début, mais elle savait que c’était sensé.
Elle était, après tout, une femme blonde assez attirante sur les talons de la pègre. Avoir une sorte de présence masculine était une bonne idée même s’il était maigre comme un clou et que sa barbe clairsemée lui donnait l’apparence d’un garçon essayant de jouer à l’adulte. Oui, Ronald avait bien droit à sa formation. Mais en réalité, il ne faisait que la ralentir.
— Qu’est-ce qu’il y a, Ronald ? dit-elle pendant qu’il la rattrapait.
— Vous ne croyez pas que vous marchez trop vite ?
— Non. Il est à presque un pâté de maisons de moi. Gardez le rythme.
— Mais si vous—
Elle lui lança un regard noir et secoua la tête, en prenant peut-être un peu trop de plaisir à la vue de l’air alarmé qui passa sur son visage. Ronald savait combien elle était discrètement respectée et admirée au journal. Elle avait vingt-huit ans et toute une carrière devant elle. Elle faisait de son mieux pour marcher dans les pas de son héroïne, Elizabeth Jane Cochran, une des premières journalistes influentes qui venait justement de voyager autour du monde pendant soixante-douze jours afin de montrer à Jules Verne que cela pouvait effectivement être fait. Et bien que Millie sût qu’il était insensé de rêver d’une aventure mondiale, elle pensait pouvoir un jour arriver au même niveau de réussite qu’Elizabeth Cochran.
Si elle parvenait à dévoiler cette histoire, ce serait un énorme pas fait dans cette direction, c’était certain. Et la clef pour y arriver était ce mafioso plus loin devant elle. Elle le regarda attentivement tourner sur la droite et prendre une autre rue. Quelques personnes marchaient entre eux, lui fournissant une couverture amplement suffisante pendant qu’elle le suivait. Elle avait aussi conscience de la présence de Ronald sur ses talons. Quand tout cela serait terminé, elle supposait que la première chose qu’elle devrait correctement lui apprendre serait comment rester discret tout en filant quelqu’un.
Elle jeta rapidement un coup d’œil en arrière, juste pour s’assurer qu’il n’avait pas été séparé d’elle avant qu’elle ne tourne à ce même angle derrière lequel elle avait vu disparaître l’homme de la pègre. Ronald était encore là derrière, et avait du mal à garder le rythme tout en se fondant aussi dans la masse. Il avait plutôt l’air d’être en train de la suivre – ce qui n’allait pas non plus les aider à être discrets.
Lorsque Millie se retourna pour localiser le mafieux, elle vit qu’il s’était arrêté. Non seulement cela, mais il regardait aussi droit vers elle. Réagissant aussi vite que possible, Millie s’arrêta net et, Dieu merci, remarqua le kiosque à journaux sur sa droite, juste au bord du trottoir.
Elle se pencha légèrement et prit un des journaux du jour. Du coin de l’œil, elle essaya de garder le mafieux dans son champ de vision, mais il était juste hors de vue. Alors qu’elle faisait semblant de regarder le journal, attirant à présent l’attention du vendeur, elle commença aussi à se soucier que sa couverture puisse être compromise. Même si elle parvenait à garder son calme, Dieu seul savait comment Ronald réagirait quand il arriverait à son niveau et verrait qu’il avait potentiellement été repéré.
Que faire ? se demandait-elle. Que faire, que f—
Une détonation résonna. Clair et très proche, le bruit caractéristique d’un coup de feu.
Ce ne fut qu’un seul son, mais il déclencha toute une agitation dans la rue. Tout d’abord, il fit faire à Millie un bond pour s’écarter du kiosque, tandis que sa tête se tournait dans la direction d’où elle pensait que le tir provenait, puis à la recherche de Ronald.
Cependant, elle ne le vit pas. Trop de personnes étaient en train de courir afin de se mettre à l’abri après avoir entendu la déflagration. Des femmes hurlaient et des cris inquiets jaillissaient de toutes les directions. Millie leva le pied droit pour se mettre à courir vers là où elle
espérait voir apparaître Ronald d’une minute à l’autre, à l’angle, mais lever la jambe lui parut soudain très difficile.
C’est alors qu’elle sentit une douleur froide et lancinante juste sous sa poitrine. Elle baissa les yeux et vit une tache rouge vif sur le motif à carreaux de son manteau. À cet instant précis, Ronald apparut à l’angle du bâtiment à côté d’elle. Lorsqu’il la vit, ses yeux déjà grands comme des soucoupes à cause du coup de feu s’écarquillèrent encore plus en repérant la tache de sang grandissant encore sous son sein gauche.
— Ronald…
— Mon dieu Millie !
Alors qu’elle se sentait tomber, il se précipita vers elle. Ses genoux cédèrent et elle s’effondra brutalement. Elle était presque sûre que Ronald l’avait rattrapée dans sa chute, mais sa tête était tournée de l’autre côté. La dernière chose qu’elle vit avant que les ténèbres ne l’envahissent fut le mafieux en train de s’échapper rapidement au milieu de la foule paniquée.
.............................................................................
CHAPITRE UN
Ava Gold contemplait le bâtiment délabré en face d’elle en essayant de déterminer à quoi il avait servi. Il avait l’apparence d’une sorte de bar louche, pas tout à fait assez grand pour en faire un club. Bien sûr, les bars n’existaient plus à cause du carcan controversé de la prohibition. Mais elle pouvait imaginer que cet endroit ait autrefois accueilli de gros buveurs et des hommes désireux de passer un peu de temps loin de leur femme et de leurs enfants. C’était une simple affaire d’un étage, faite de bois et de vieilles briques. Elle dégageait une impression générale miteuse, surtout dans l’obscurité de la nuit, celle du genre d’endroit qui gardait des secrets.
À cet égard, il était logique qu’elle ait atterri ici. Ava suivait une piste en lien avec la mort de Clarence depuis cinq jours maintenant. Tout ceci avait débuté avec la recherche d’anciennes affaires où un criminel avait été libéré et toute description d’un homme de petite taille portant un chapeau à large bord enfoncé sur la tête. C’était le portrait de celui qui avait tué Clarence, ainsi que celui d’un homme qui s’était échappé après une autre fusillade juste une semaine ou deux auparavant.
Quelques interrogatoires rapides de témoins oculaires et le recoupement d’anciens dossiers de police l’avaient menée ici. Les vieilles lettres décolorées au-dessus de la porte formaient le mot Clancy’s, et les fenêtres cassées ainsi que la porte barricadée indiquaient que ce lieu n’avait pas été ouvert depuis au moins plusieurs mois. Mais d’après les informations qu’elle avait obtenues de certains de ses amis jazzmen, le vieil endroit était utilisé à des fins crapuleuses.
Le Clancy’s se trouvait en plein milieu d’une rue tout autant tombée en désuétude et poussiéreuse. En cet instant, à neuf heures du soir, celle-ci était pratiquement vide. Ava aurait voulu y arriver plus tôt mais avait fait en sorte de rentrer chez elle à temps pour mettre Jeffrey au lit. Elle était seule, car il ne s’agissait pas d’une affaire officielle. En fait, elle pensait que Frank deviendrait fou s’il savait ce qu’elle s’apprêtait à faire.
Tu penses beaucoup à Frank, non ? se demanda-t-elle. Elle supposait que oui, mais c’était à prévoir. Après tout, ils devaient dîner ensemble plus tard dans la soirée. Ils étaient censés se retrouver dans une demi-heure, mais elle n’était pas sûre que les choses se passent ainsi. Cette affaire privée pourrait être une bonne excuse pour le manquer. Elle savait qu’elle aurait dû lui dire non quand il le lui avait demandé, mais elle avait pensé que cela pourrait passer pour une impolitesse.
« Concentre-toi », se dit-elle. Puis, chassant de sa tête les pensées concernant le futur (et sûrement embarrassant) dîner avec Frank, elle se hâta de traverser la rue. Elle s’assura de rester dans l’ombre le long du bâtiment tout en avançant discrètement dans une vieille ruelle qui sentait l’urine et la poussière. Elle ralentit le pas en gardant la tête près du mur. Elle cherchait une entrée latérale mais n’en voyait pas. Il faisait si sombre dans la ruelle qu’elle devait faire courir ses mains le long des briques pour s’assurer de ne pas manquer une ouverture.
Quand elle arriva à l’arrière du bâtiment, elle trouva une autre ruelle qui passait derrière la rangée de commerces fermés. ...
............................................................................................................................................................
BIO:
Blake Pierce est auteur d'une populaire série de thrillers qui met en scène l'agent spécial Riley Paige ("Riley Paige Mystery").
"Sans laisser de traces" (Once Gone), le premier tome de la série et son premier roman, a été publié en 2015.
Blake Pierce a écrit également la série de thrillers "Mackenzie White Mystery" (2016).
Le Mage du Kremlin
Le mage du Kremlin :
On l’appelait le « mage du Kremlin ». L’énigmatique Vadim Baranov fut metteur en scène puis producteur d’émissions de télé-réalité avant de devenir l’éminence grise de Poutine, dit le Tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu’à ce que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre…
Ce récit nous plonge au cœur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques se livrent une guerre de tous les instants. Et où Vadim, devenu le principal spin doctor du régime, transforme un pays entier en un théâtre politique, où il n’est d’autre réalité que l’accomplissement des souhaits du Tsar. Mais Vadim n’est pas un ambitieux comme les autres : entraîné dans les arcanes de plus en plus sombres du système qu’il a contribué à construire, ce poète égaré parmi les loups fera tout pour s’en sortir.
De la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques de Sotchi, Le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie contemporaine. Dévoilant les dessous de l’ère Poutine, il offre une sublime méditation sur le pouvoir.
Le mage du Kremlin est le premier roman de l' auteur .
................................................................................................................................................................
1
On disait depuis longtemps les choses les plus diverses sur son compte. Il y en avait qui affirmaient qu’il s’était retiré dans un monastère au mont Athos pour prier entre les pierres et les lézards, d’autres juraient l’avoir vu dans une villa de Sotogrande s’agiter au milieu d’une nuée de mannequins cocaïnés. D’autres encore soutenaient avoir retrouvé ses traces sur la piste de l’aéroport de Chardja, dans le quartier général des milices du Donbass ou parmi les ruines de Mogadiscio.
Depuis que Vadim Baranov avait démissionné de son poste de conseiller du Tsar, les histoires sur son compte, au lieu de s’éteindre, s’étaient multipliées. Cela arrive parfois. La plupart des hommes de pouvoir tirent leur aura de la position qu’ils occupent. À partir du moment où ils la perdent, c’est comme si la prise avait été arrachée. Ils se dégonflent comme ces poupées qui se trouvent à l’entrée des parcs d’attractions. On les croise dans la rue et on ne réussit pas à comprendre comment un type de ce genre a pu susciter autant de passions.
Baranov appartenait à une race différente. Même si, en vérité, je n’aurais su dire laquelle. Les photos présentaient le portrait d’un homme massif, mais pas athlétique, presque toujours vêtu de couleurs sombres, et de costumes légèrement trop grands. Il avait un visage banal, peut-être un peu enfantin, le teint pâle, les cheveux noirs, très raides, et une coiffure de premier communiant. Dans une vidéo, tournée en marge d’une rencontre officielle, on le voyait rire, chose très rare en Russie où un simple sourire est considéré comme un signe d’idiotie. En fait, il donnait l’impression de ne se préoccuper en rien de son apparence. Trait curieux si on pense que son métier consistait précisément en cela : disposer des miroirs en cercle pour transformer une étincelle en enchantement.
Baranov avançait dans la vie entouré d’énigmes. La seule chose plus ou moins certaine était son influence sur le Tsar. Durant les quinze années qu’il avait passées à son service, il avait contribué de façon décisive à l’édification de son pouvoir.
On l’appelait le « mage du Kremlin », le « nouveau Raspoutine ». À l’époque il n’avait pas un rôle bien défini. Il se manifestait dans le bureau du président quand les affaires courantes avaient été expédiées. Ce n’étaient pas les secrétaires qui le prévenaient. Peut-être que le Tsar en personne le convoquait sur sa ligne directe. Ou bien lui-même devinait le moment exact, grâce à ses talents prodigieux, dont tout le monde parlait sans que personne fût capable de dire avec précision en quoi ils consistaient. Parfois quelqu’un se joignait à eux. Un ministre en vogue ou le patron d’une entreprise d’État. Mais étant donné qu’à Moscou, par principe et depuis des siècles, personne ne dit jamais rien, même la présence de ces témoins occasionnels ne parvenait pas à éclairer les activités nocturnes du Tsar et de son conseiller. Il arrivait cependant qu’on fût informé de leurs conséquences. Un matin, la Russie s’était ainsi réveillée en apprenant l’arrestation de l’homme d’affaires le plus riche et le plus connu du pays, le symbole même du nouveau système capitaliste. Une autre fois, tous les présidents des républiques de la Fédération, élus par le peuple, avaient été mis à pied. Dorénavant ce serait le Tsar et personne d’autre qui les nommerait, avaient annoncé les premières informations de la matinée aux citoyens encore à moitié endormis. Mais, dans la plupart des cas, les fruits de ces insomnies restaient invisibles. Et ce n’est que des années plus tard que l’on notait des changements qui apparaissaient alors comme tout à fait naturels, bien qu’ils fussent en réalité le produit d’une activité méticuleuse.
À l’époque, Baranov était très discret, on ne le voyait nulle part et l’idée de donner une interview ne l’effleurait pas. Il avait pourtant une singularité. De temps en temps, il écrivait, soit un petit essai qu’il publiait dans une obscure revue indépendante, soit une étude de stratégie militaire destinée aux sommets de l’armée, parfois même un récit où il faisait la preuve d’une veine paradoxale dans la meilleure tradition russe. Il ne signait jamais ces textes de son nom, mais il les parsemait d’allusions qui étaient autant de clés pour interpréter le monde nouveau issu des insomnies du Kremlin. En tout cas, c’est ce que croyaient les courtisans moscovites et les chancelleries étrangères qui rivalisaient pour être les premiers à décrypter les formules obscures de Baranov.
Le pseudonyme derrière lequel il se cachait à ces occasions, Nicolas Brandeis, ajoutait un élément de confusion ultérieure. Les plus zélés avaient reconnu sous ce nom le personnage mineur d’un roman secondaire de Joseph Roth. Un Tartare, sorte de deus ex machina qui faisait son apparition dans les moments décisifs de la narration pour s’éclipser aussitôt. « Il ne faut aucune vigueur pour conquérir quoi que ce soit, disait-il, tout est pourri et se rend, mais lâcher, savoir laisser aller, c’est cela qui compte. » Ainsi, de même que les personnages du roman de Roth s’interrogeaient sur les actions du Tartare dont la formidable indifférence était la garantie de tout succès, les hiérarques du Kremlin, et ceux qui les entouraient, allaient à la chasse du moindre indice susceptible de révéler la pensée de Baranov et, à travers celle-ci, les intentions du Tsar. Une mission d’autant plus désespérée que le mage du Kremlin était convaincu que le plagiat était la base du progrès : raison pour laquelle on ne comprenait jamais jusqu’à quel point il exprimait ses propres idées ou jouait avec celles d’un autre.
L’apothéose de cette équivoque se produisit un soir d’hiver au cours duquel la masse compacte des berlines d’apparat, avec leur cortège de sirènes et de gardes du corps, se déversa sur le petit théâtre d’avant-garde où l’on donnait une pièce en un acte dont l’auteur se nommait Nicolas Brandeis. On vit alors des banquiers, des magnats du pétrole, des ministres et des généraux du FSB faire la queue, avec leurs maîtresses couvertes de saphirs et de rubis, pour s’installer sur les fauteuils défoncés d’une salle dont ils ne soupçonnaient jusque-là même pas l’existence, afin d’assister à un spectacle qui, d’un bout à l’autre, se moquait des tics et des prétentions culturelles des banquiers, des magnats du pétrole, des ministres et des généraux du FSB. « Dans un pays civilisé, une guerre civile éclaterait, affirmait à un certain moment le héros de la pièce, mais chez nous il n’y a pas de citoyens, il s’agira donc d’une guerre entre laquais. Ce n’est pas pire qu’une guerre civile, mais c’est un peu plus répugnant, plus misérable. » Ce soir-là, on ne vit pas Baranov dans la salle mais, par prudence, les banquiers et les ministres applaudirent à tout rompre : certains prétendaient que l’auteur observait le parterre à travers un minuscule hublot situé à droite de la loge.
Pourtant, même ces distractions un peu puériles n’étaient pas parvenues à dissiper le malaise de Baranov. À partir d’un certain moment le petit nombre de gens qui avaient l’occasion de le rencontrer s’était mis à lui attribuer une humeur de plus en plus noire. On disait qu’il était inquiet, fatigué. Qu’il pensait à autre chose. Il avait démarré trop tôt et maintenant il s’ennuyait. De lui-même surtout. Et du Tsar. Qui lui en revanche ne s’ennuyait jamais. Et s’en rendait compte. Et commençait à le haïr. Quoi ? Je t’ai conduit jusqu’ici et tu as le courage de t’ennuyer ? Il ne faut jamais sous-estimer la nature sentimentale des rapports politiques.
Jusqu’au jour où Baranov avait disparu. Une brève note du Kremlin avait annoncé la démission du conseiller politique du président de la Fédération de Russie. On avait alors perdu toute trace de lui, hormis ces apparitions périodiques à travers le monde que personne n’avait jamais confirmées.
Quand j’arrivai à Moscou quelques années plus tard, le souvenir de Baranov planait comme une ombre vague qui, affranchie d’un corps par ailleurs considérable, était libre de se manifester ici et là, chaque fois qu’il semblait utile de l’évoquer pour illustrer une mesure particulièrement obscure du Kremlin. Et, étant donné que Moscou – indéchiffrable capitale d’une époque nouvelle dont personne ne réussissait à définir les contours – s’était trouvé de façon inattendue sur le devant de la scène, l’ancien mage du Kremlin avait ses exégètes même parmi nous, les étrangers. Un journaliste de la BBC avait tourné un documentaire dans lequel il attribuait à Baranov la responsabilité de l’importation en politique des artifices du théâtre d’avant-garde. Un de ses collègues avait écrit un livre dans lequel il le décrivait comme une espèce de prestidigitateur qui faisait apparaître et disparaître personnages et partis d’un simple claquement de doigts. Un professeur lui avait consacré une monographie : « Vadim Baranov et l’invention de la Fake Democracy ». Tout le monde s’interrogeait sur ses activités les plus récentes. Exerçait-il encore une influence sur le Tsar ? Quel rôle avait-il joué dans la guerre contre l’Ukraine ? Et quelle avait été sa contribution à l’élaboration de la stratégie de propagande qui avait produit des effets aussi extraordinaires sur les équilibres géopolitiques de la planète ?
Personnellement je suivais toutes ces élucubrations avec un certain détachement. Les vivants m’ont toujours moins intéressé que les morts. Je me sentais perdu dans le monde jusqu’au moment où j’ai découvert que je pouvais passer la plus grande partie de mon temps en leur compagnie plutôt que de m’embêter avec mes contemporains. C’est pourquoi, à cette époque, à Moscou, comme dans n’importe quel autre endroit, je fréquentais surtout les bibliothèques et les archives, quelques restaurants et un café où les serveurs s’habituaient peu à peu à ma présence solitaire. Je feuilletais de vieux livres, me promenais dans la pâle lumière de l’hiver et renaissais toutes les fins d’après-midi des vapeurs des bains de la rue Seleznevskaya. Puis, le soir, un petit bar de Kitaï-Gorod refermait généreusement sur moi les portes du repos et de l’oubli. À mes côtés, presque partout, marchait un magnifique fantôme dans lequel j’avais reconnu un allié potentiel pour quelques raisonnements auxquels je me livrais.
En apparence Evgueni Zamiatine était un auteur du début du vingtième siècle, né dans un village de Tsiganes et de voleurs de chevaux, arrêté et envoyé en exil par l’autorité tsariste pour avoir pris part à la révolution de 1905.
Écrivain apprécié pour ses récits, il avait également été ingénieur naval en Angleterre, où il avait construit des brise-glaces. Rentré en Russie en 1918 pour participer à la révolution bolchevique, Zamiatine avait rapidement compris que le paradis de la classe ouvrière n’était pas à l’ordre du jour. Alors il s’était mis à écrire un roman : Nous. Et là s’était produit un de ces phénomènes incroyables qui nous font comprendre de quoi parlent les physiciens quand ils évoquent l’hypothèse de l’existence simultanée d’univers parallèles.
En 1922, Zamiatine avait cessé d’être un simple écrivain et était devenu une machine du temps. Parce qu’il croyait être en train d’écrire une critique féroce du système soviétique en construction. Ses censeurs eux-mêmes l’avaient lue ainsi, raison pour laquelle ils en avaient interdit la publication. Mais en vérité Zamiatine ne s’adressait pas à eux. Sans s’en rendre compte, il avait enjambé un siècle pour s’adresser directement à notre ère. Nous dépeignait une société gouvernée par la logique, où toute chose était convertie en chiffres, et où la vie de chaque individu était réglée dans les moindres détails pour garantir une efficacité maximale. Une dictature implacable mais confortable qui permettait à n’importe qui de produire trois sonates musicales en une heure en poussant simplement un bouton, et où les rapports entre les sexes étaient réglés par un mécanisme automatique, déterminant les partenaires les plus compatibles et permettant de s’accoupler avec chacun d’entre eux. Tout était transparent dans le monde de Zamiatine, jusque dans la rue où une membrane décorée comme une œuvre d’art enregistrait la conversation des piétons. Par ailleurs, il est évident que dans un endroit pareil le vote devait lui aussi être public : « On dit que les anciens votaient en quelque sorte en secret, à la sauvette, comme des voleurs », déclare à un certain moment le personnage principal, D-503. « À quoi servait tout ce mystère – cela n’a jamais été établi exactement (...). Nous, nous ne cachons rien, nous n’avons honte de rien : nous célébrons les élections ouvertement, loyalement, en plein jour. Je vois tout le monde voter pour le Bienfaiteur ; tout le monde me voit voter pour le Bienfaiteur. »
Depuis que je l’avais découvert, Zamiatine était devenu mon obsession. Il me semblait que son œuvre concentrait toutes les questions de l’époque qui était la nôtre. Nous ne décrivait pas que l’Union soviétique, il racontait surtout le monde lisse, sans aspérités, des algorithmes, la matrice globale en construction et, face à celle-ci, l’irrémédiable insuffisance de nos cerveaux primitifs. Zamiatine était un oracle, il ne s’adressait pas seulement à Staline : il épinglait tous les dictateurs à venir, les oligarques de la Silicon Valley comme les mandarins du parti unique chinois. Son livre était l’arme finale contre la ruche digitale qui commençait à recouvrir la planète et mon devoir consistait à la déterrer et à la pointer dans la bonne direction. Le vrai problème étant que les moyens à ma disposition n’étaient pas exactement en mesure de faire trembler Mark Zuckerberg ni Xi Jinping. Sous le prétexte qu’après avoir échappé à Staline Zamiatine avait terminé ses jours à Paris, j’avais réussi à convaincre mon université de financer une recherche sur lui. Une maison d’édition avait manifesté un vague intérêt pour le projet d’une réédition de Nous et un ami producteur de documentaires ne s’était pas montré hostile à l’idée d’en faire quelque chose. « Tâche de trouver de la matière pendant que tu seras à Moscou », m’avait-il dit en sirotant un Negroni dans un bar du 9e.
Dès mon arrivée à Moscou, pourtant, je fus distrait de ma mission par la découverte que cette ville impitoyable était capable de produire des enchantements délicats comme ceux que j’éprouvais chaque jour en
Écrivain apprécié pour ses récits, il avait également été ingénieur naval en Angleterre, où il avait construit des brise-glaces. Rentré en Russie en 1918 pour participer à la révolution bolchevique, Zamiatine avait rapidement compris que le paradis de la classe ouvrière n’était pas à l’ordre du jour. Alors il s’était mis à écrire un roman : Nous. Et là s’était produit un de ces phénomènes incroyables qui nous font comprendre de quoi parlent les physiciens quand ils évoquent l’hypothèse de l’existence simultanée d’univers parallèles.
En 1922, Zamiatine avait cessé d’être un simple écrivain et était devenu une machine du temps. Parce qu’il croyait être en train d’écrire une critique féroce du système soviétique en construction. Ses censeurs eux-mêmes l’avaient lue ainsi, raison pour laquelle ils en avaient interdit la publication. Mais en vérité Zamiatine ne s’adressait pas à eux. Sans s’en rendre compte, il avait enjambé un siècle pour s’adresser directement à notre ère. Nous dépeignait une société gouvernée par la logique, où toute chose était convertie en chiffres, et où la vie de chaque individu était réglée dans les moindres détails pour garantir une efficacité maximale. Une dictature implacable mais confortable qui permettait à n’importe qui de produire trois sonates musicales en une heure en poussant simplement un bouton, et où les rapports entre les sexes étaient réglés par un mécanisme automatique, déterminant les partenaires les plus compatibles et permettant de s’accoupler avec chacun d’entre eux. Tout était transparent dans le monde de Zamiatine, jusque dans la rue où une membrane décorée comme une œuvre d’art enregistrait la conversation des piétons. Par ailleurs, il est évident que dans un endroit pareil le vote devait lui aussi être public : « On dit que les anciens votaient en quelque sorte en secret, à la sauvette, comme des voleurs », déclare à un certain moment le personnage principal, D-503. « À quoi servait tout ce mystère – cela n’a jamais été établi exactement (...). Nous, nous ne cachons rien, nous n’avons honte de rien : nous célébrons les élections ouvertement, loyalement, en plein jour. Je vois tout le monde voter pour le Bienfaiteur ; tout le monde me voit voter pour le Bienfaiteur. »
Depuis que je l’avais découvert, Zamiatine était devenu mon obsession. Il me semblait que son œuvre concentrait toutes les questions de l’époque qui était la nôtre. Nous ne décrivait pas que l’Union soviétique, il racontait surtout le monde lisse, sans aspérités, des algorithmes, la matrice globale en construction et, face à celle-ci, l’irrémédiable insuffisance de nos cerveaux primitifs. Zamiatine était un oracle, il ne s’adressait pas seulement à Staline : il épinglait tous les dictateurs à venir, les oligarques de la Silicon Valley comme les mandarins du parti unique chinois. Son livre était l’arme finale contre la ruche digitale qui commençait à recouvrir la planète et mon devoir consistait à la déterrer et à la pointer dans la bonne direction. Le vrai problème étant que les moyens à ma disposition n’étaient pas exactement en mesure de faire trembler Mark Zuckerberg ni Xi Jinping. Sous le prétexte qu’après avoir échappé à Staline Zamiatine avait terminé ses jours à Paris, j’avais réussi à convaincre mon université de financer une recherche sur lui. Une maison d’édition avait manifesté un vague intérêt pour le projet d’une réédition de Nous et un ami producteur de documentaires ne s’était pas montré hostile à l’idée d’en faire quelque chose. « Tâche de trouver de la matière pendant que tu seras à Moscou », m’avait-il dit en sirotant un Negroni dans un bar du 9e.
Dès mon arrivée à Moscou, pourtant, je fus distrait de ma mission par la découverte que cette ville impitoyable était capable de produire des enchantements délicats comme ceux que j’éprouvais chaque jour en m’aventurant dans les ruelles gelées de Petrovka et de l’Arbat. La morosité qui émanait des impénétrables façades staliniennes s’estompait dans les pâles reflets des anciennes demeures de boyards et la neige même, transformée en boue par les roues de l’interminable procession des berlines noires, retrouvait sa pureté dans les cours et les petits jardins cachés qui murmuraient les histoires d’un temps révolu.
Toutes ces temporalités, les années vingt de Zamiatine et le futur dystopique de Nous, les cicatrices de Staline gravées sur la ville et les traces plus aimables du Moscou prérévolutionnaire, se croisaient en moi, produisant le décalage qui constituait alors ma condition de vie normale. Pourtant, je ne me désintéressais pas complètement de ce qui se passait autour de moi. J’avais cessé à cette époque de lire les journaux, mais les réseaux sociaux satisfaisaient abondamment mes besoins limités d’information.
Parmi les profils russes que je suivais, il y avait notamment celui d’un certain Nicolas Brandeis. Il s’agissait probablement d’un étudiant, planqué dans un studio à Kazan, plutôt que du mage du Kremlin, mais dans le doute je le lisais. Personne ne sait rien en Russie, il faut faire avec ou s’en aller. Ce n’était pas une grande affaire, car Brandeis ne publiait qu’une phrase tous les dix ou quinze jours, ne commentait jamais l’actualité, camouflait des fragments littéraires, citait des strophes de chansons ou faisait référence à la Paris Review – ce qui tendait à renforcer la thèse de l’étudiant de Kazan.
« Tout est permis au Paradis, sauf la curiosité. »
« Si ton ami est mort ne l’enterre pas. Reste un peu à l’écart et attends. Les vautours arriveront et tu te feras des tas de nouveaux amis. »
« Il n’y a rien de plus triste au monde que de voir comment une famille saine et forte est réduite en pièces par une stupide banalité. Par exemple par une meute de loups. »
Le jeune homme avait un tour d’esprit un peu sombre, mais il s’adaptait plutôt bien au caractère local.
Un soir, au lieu de me diriger vers mon bar habituel, je restai lire à la maison. J’avais loué deux chambres au dernier étage d’un bel immeuble des années cinquante, construit par des prisonniers de guerre allemands, une sorte de marque de standing moscovite : puissance et confort bourgeois, fondés, comme toujours ici, sur une base solide d’oppression. À la fenêtre, les lueurs orangées de la ville étaient amorties par les coups de fouet d’une chute de neige nerveuse. Dans l’appartement régnait le climat d’improvisation que j’ai tendance à reproduire partout : piles de livres, cartons de fast-food et bouteilles de vin à moitié vides. La voix de Marlene Dietrich donnait une touche décadente à l’atmosphère, renforçant le sentiment d’étrangeté qui constituait à cette époque la source principale de mes plaisirs.
J’avais délaissé Zamiatine pour un récit de Nabokov, mais il m’endormait doucement comme d’habitude : le pensionnaire du Montreux Palace a toujours été un peu trop raffiné à mon goût. Sans même que je m’en rende compte, toutes les deux minutes mon regard quittait le livre à la recherche de réconfort et tombait inévitablement sur la tablette maléfique. Et là, perdue parmi les indignations du moment et les photos de koalas, apparut soudain cette phrase : « Entre nos murs transparents comme tissés d’air étincelant, nous vivons à la vue de tous, toujours inondés de lumière. Nous n’avons rien à nous cacher les uns aux autres. » Zamiatine. Le voir surgir sur mon fil d’actu produisit sur moi
l’effet d’un coup de marteau. Presque automatiquement je rajoutai au tweet de Brandeis la phrase suivante tirée de Nous : « De plus, cela allège le travail noble et pénible des Gardiens. Sans quoi, qui sait ce qui pourrait arriver. »
Puis je jetai ma tablette à travers la pièce pour m’obliger à reprendre la lecture du livre. Pour se venger, le lendemain matin, tandis que je le récupérais sous les coussins, l’objet infernal me signala la réception d’un nouveau message. « Je ne savais pas qu’en France on lisait encore Z. » Brandeis m’avait écrit à trois heures du matin. Je répondis sans y penser : « Z est le roi secret de notre époque. » Une question s’afficha alors : « Combien de temps restez-vous à Moscou ? »
Bref moment d’hésitation : comment ce jeune étudiant connaissait-il mes déplacements ? Puis je me rendis compte que l’on pouvait déduire de certains de mes tweets de ces dernières semaines, peut-être en lisant un peu entre les lignes, que je me trouvais ici. Je répondis que je ne le savais pas encore exactement, puis je sortis dans la ville glacée poursuivre les rituels quotidiens de mon existence solitaire. À mon retour, un nouveau message m’attendait. « Si vous êtes toujours intéressé par Z, j’ai quelque chose à vous montrer. »
Pourquoi pas ? Je n’avais rien à perdre. Au pire, je ferais la connaissance d’un étudiant passionné de littérature. Un peu lugubre par moments, mais c’est un problème que quelques verres de vodka réussissent généralement à soulager.
..............................................................................................................................................................
Biographie:
Giuliano da Empoli (né en 1973 à Neuilly-sur-Seine) est un écrivain et journaliste italien et suisse. Il est le président de Volta, un think tank basé à Milan.
Essais en français
LA PESTE ET L’ORGIE, Grasset, 2007.
LE FLORENTIN, Grasset, 2016.
LES INGÉNIEURS DU CHAOS, JC Lattès, 2019.
Essais en italien
UN GRANDE FUTURO DIETRO DI NOI, Marsilio, 1996.
LA GUERRA DEL TALENTO, Marsilio, 2000.
OVERDOSE, Marsilio, 2002.
LA SINDROME DI MEUCCI, Marsilio, 2005.
CANTON EXPRESS, Einaudi, 2008.
OBAMA. LA POLITICA NELL’ERA DI FACEBOOK, Marsilio, 2008.
CONTRO GLI SPECIALISTI, Marsilio, 2013.
LA PROVA DEL POTERE, Mondadori, 2015.
LA RABBIA E L’ALGORITMO, Marsilio, 2017.
La Malédiction de la zone de confort
Rose a (presque) tout pour être heureuse.
Après 763 auditions infructueuses elle a enfin décroché son premier grand rôle dans la série télé de l’année. Elle peut compter sur le soutien d’une joyeuse bande et d’un fiancé imaginaire avec qui elle assure vivre, enfin, une relation équilibrée. Son unique manque ? Un précieux recueil de poésie médiévale dont elle a besoin pour calmer son émotivité pathologique.
Ben n’a (presque) rien pour être heureux.
En panne d’émotions, le scénariste et auteur de polars n’arrive plus à écrire une ligne. Il se noie dans un quotidien sinistre qu’il dissimule mal à ses deux seuls amis. Son unique réconfort ? Les mails hystériques d’une dingue qui lui réclame un bouquin comme une naufragée, une bouée au milieu du Pacifique.
Ils étaient faits pour ne PAS se rencontrer.
Probabilité qu’ils vivent un jour heureux ensemble : nulle.
Probabilité qu’une probabilité soit fausse : non négligeable.
Et si la vie déjouait les algorithmes ?
...........................................................................................................................................................
1
Elle, Hugh Grant, l’utérus
et la zone de confort
Debout, j’ai tendance à me sentir toute petite. Là, je me sentais minuscule. J’étais en position horizontale. Je m’étais trompée de soutien-gorge. Je faisais un effort désespéré pour ignorer mes mollets. Ils avaient renoué avec l’état de nature. Blonde à poil long, même en janvier, c’est compliqué à assumer. Cruella me fixait avec un rictus objectivement sadique en sortant une guirlande de préservatifs de l’un des tiroirs de son cabinet cossu. Et, moi, je pensais très fort à Friedrich Nietzsche.
Ce qui ne te tue pas te rend plus forte.
Un philosophe majeur est obligé d’avoir raison, je me répétais en boucle. Parce qu’un philosophe majeur ne peut pas avoir tort. Malgré la logique implacable de mon raisonnement, un gros doute me submergea. Le contexte, sûrement. Même avant-gardiste, un philosophe majeur du XIXe a peu de chance d’être allé un jour volontairement s’allonger chez ma gynéco.
Une envie de me noyer dans le drap en papier me saisit. De m’enfoncer dans le matelas jusqu’à disparaître tout à fait. Ou, mieux encore, de quitter provisoirement la planète Terre. En prenant soin de laisser un petit message d’explication sur mon répondeur, évidemment.
Salut, c’est Rose !
Je suis indisponible pour le moment. Pour la durée du moment, ça va dépendre. Si c’est toi, Isa, tu sais où me trouver. Si c’est vous, Hugh Grant, je saurai où vous trouver. Si c’est monsieur Spielberg, je suis OK pour tous les rôles. Et si c’est le médecin, jetez un œil à votre agenda. Ma pauvre, vous êtes totalement surbookée. Le surmenage est très mauvais pour le cœur (source : Organisation mondiale de la santé). Ne prenez pas le risque de me rappeler.
Mon corps finit par se détendre un peu. Je glissais de quelques centimètres. Le skaï couina pour me dénoncer. Cruella me fusilla de ses yeux couleur husky de Sibérie. Un bleu translucide objectivement suspect pour quelqu’un qui n’est pas originaire d’une contrée glacée où le soleil ne se couche jamais.
Pour éviter de me lancer dans un exposé embarrassant sur la pluie, le beau temps, mon revival d’acné en mai dernier ou la date de mon dernier rendez-vous amoureux – il y a un an environ –, je souris au plafond.
Sur la table d’examen, mon genou droit et mon genou gauche refusaient de se séparer. Ils avaient décidé de faire bloc. D’opposer une résistance dérisoire à une issue inéluctable. Cruella allait m’examiner. Puis, elle allait parler. Et j’allais l’écouter.
Le soleil se lève à l’est. Il se couche à l’ouest.
Moi, chaque année, au mois de janvier, je m’allonge.
Elle m’examine.
Et, je l’écoute.
Après mon premier rendez-vous, il y a cinq ans, avec Isa, ma colocataire, nous avions bien envisagé ma fuite. Nous avions donc pesé le pour et le contre. Elle avait fini par déclarer sur un ton solennel que la capacité à « surmonter l’adversité » est « le point commun » de « ceux » qui réussissent. L’énergie qu’ils déploient pour écarter les obstacles sur leur route leur permet d’échapper à « la malédiction de la zone de confort ». Isa avait ensuite suggéré que sinon je pouvais me faire inoculer la peste bubonique ou encore déménager en Corée du Nord. Cela avait accéléré mon processus de décision.
Je voulais réussir. Supporter Cruella, son regard psychédélique et ses sarcasmes une fois par an constituait, sans aucun doute, un premier pas vers le succès. C’était mathématique. Un 2 en 1 qui permettait de prendre simultanément soin de mon corps et de mon esprit. Moins cher et moins chronophage qu’une séance hebdomadaire chez le psy.
De notre canapé, le plan semblait parfait.
Il l’était beaucoup moins vu de la table d’examen.
Je n’avais même pas eu le temps de plier mes affaires sur le petit tabouret qui faisait vestiaire. Elles avaient roulé par terre. Évidemment, mon slip fatigué – deuxième acte manqué – avait atterri en haut de la pile. Bien sûr, cela n’avait pas échappé à Cruella.
Tétanisée à l’idée de ce qui allait suivre, je m’étais réfugiée dans mon monde intérieur. Un paradis où tout est possible. Surtout ce qui ne l’est plus dans le monde d’aujourd’hui. Espérer rencontrer l’amour sans vivre à mi-temps sur Tinder. Renoncer au principe même du rendez-vous express. Refuser le j’aime/j’aime pas en trois secondes. M’épargner le j’aime pas finalement du lendemain matin. Me téléporter au XIIe siècle pour goûter les joies de l’amour courtois. Avoir le plaisir de résister à un poète et l’obliger à cogiter comme un dingue pour me convaincre de lui céder. Vivre d’amour, de San Pellegrino et, toute médaille ayant son revers, de sanglier.
Évidemment, il fallait faire preuve d’une certaine ouverture d’esprit pour oublier que les mollets un peu épais du troubadour qui me contait fleurette étaient incarcérés dans des collants vert bouteille. Ce qui était considéré comme rédhibitoire au XXIe siècle était ultratendance de son point de vue à lui. Et l’empathie est, paraît-il, un truc indispensable à l’harmonie amoureuse (source : Isa).
— Vous vous croyez au cinéma, Rose ? Vous attendez la fin des bandes-annonces ? me lança Cruella, impatiente.
— Non, madame. Enfin… pardon, je veux dire… non, docteur, je bafouillai.
Pourtant, une furieuse envie de lui rappeler que notre relation relevait d’un cadre strictement professionnel me saisit. Mon humiliation était peut-être remboursée par la Sécurité sociale mais cela ne la dispensait pas pour autant des règles de base de la civilisation. Elle devait donc m’appeler « mademoiselle Simon » comme tout le monde.
Ça, c’est ce que j’aurais dû lui dire. Si j’avais eu la force d’affronter la réalité. Mais depuis trois cent soixante mois environ, j’entretiens un rapport compliqué avec la vie en vrai.
Impossible de l’oublier car chaque fois que ma mère fait la queue quelque part, elle se met à raconter les circonstances de ma venue sur terre. Elle avait donné le jour à une artiste. Elle n’y pouvait rien. J’avais voulu prolonger les choses. Mon sens inné de la dramaturgie. Au début, personne n’y avait vu d’inconvénients. Mais quarante-huit heures plus tard, le personnel de l’hôpital avait commencé à trouver la pièce trop longue. Et trois jours après, la moitié de la maternité avait été appelée à la rescousse pour me convaincre de pousser mon premier cri. Chacun avait dressé la liste des aspects positifs de l’expérience humaine. Finalement, une jeune sage-femme s’était frayé un chemin jusqu’à moi et avait murmuré que si je sortais, c’était à moi de voir bien sûr, je ne serais pas obligée de supporter tout ça. Je pourrais toujours me réfugier au cinéma.
C’était comme la vie mais en mieux.
Pour me punir, Cruella décida d’allumer les néons. La notion de double peine prit alors un sens nouveau. La lumière crue qui tombait du plafond était objectivement sadique, elle aussi. Elle éclairait mon teint de janvier, une nuance de vert qui déprimerait même une olive extradée d’une boîte périmée, et soulignait les reliefs post-réveillon qui avaient décidé de camper sur mon abdomen.
Elle me jeta un coup d’œil consterné. Il signifiait : « Alors ma grande, le principe de réalité tu connais ? À trente ans, tu devrais, enfin si tu décides un jour de devenir une adulte responsable ! » Une perspective qu’elle considérait utopique étant donné la manière pathétique dont je m’obstinais à essayer de gagner ma vie.
Comme à chaque consultation, elle ne m’avait pas laissé quitter ma doudoune avant d’attaquer : « Situation professionnelle inchangée ? Actrice, figurante, mannequin pieds ? Enfin, dans l’ordre inverse, je suppose… » Et, comme chaque fois, je m’étais recroquevillée sur mon siège. J’avais eu envie de répondre. Mais je m’étais tu.
Pourtant, cette fois, tout était différent. Isa le disait : la roue n’avait pas tourné, elle était devenue « hystérique ». Comprendre : pendant un an, nous serions en mesure de payer le loyer de notre deux-pièces (vraie cuisine et vraie salle de bains) sans faire la voix off qui tente de rassurer la vache dans les pubs pour le fromage au lait cru ou recourir au pouvoir de séduction de mes orteils.
J’avais eu envie de rétorquer à Cruella qu’elle se trompait. Qu’une fois qu’elle m’aurait libérée, 2017 commencerait pour de bon. Ce serait mon année. Mon nom apparaîtrait chaque semaine pendant quelques mois au générique de la série dont tout le monde allait parler. Au bureau, à la fac, au bistrot, dans le RER C. Même elle qui n’avait jamais posé ses escarpins Prada dans un train de banlieue.
C’est sûr, lors de ma prochaine visite, elle brûlerait de me poser mille questions. Une question, en particulier. « Cet Ugo Belin, comment est-il en vrai ? » demanderait-elle après avoir légèrement éclairci sa voix et en fixant avec amour les feuilles de son ordonnancier. Comme les autres, les millions d’autres, elle serait bouleversée par le regard de l’acteur. Par les mouvements d’Ugo dans l’espace.
Pour démontrer que la perfection existait même depuis la fin du classicisme, Dieu avait jugé radical de créer Ugo. Judicieuse initiative à en croire le nombre de femmes qui suivaient ses faits et gestes dans les journaux, sur Instagram, voire à pied pour les plus tenaces d’entre elles.
Cruella ajouterait certainement : « Et le prochain épisode, Rose ? Enfin, je veux dire, mademoiselle Simon ? Tout va s’arranger au prochain épisode, n’est-ce pas ? Cela ne peut pas se terminer ainsi ! C’est impossible. Atroce. Inhumain ! » Et elle ferait comment, elle, pendant un an en attendant que les personnages reviennent pour la saison suivante ? Déjà le manque était douloureux. Mais l’ignorance était au-dessus de ses forces. Donc, il lui arriverait quoi à Ugo ?
Et moi, je lui répondrai par un sourire énigmatique.
La Joconde.
En mieux.
— J’ai huit autres patientes dans la salle d’attente, ce n’est pas quand vous voulez, vous savez !
Elle agita sa sonde comme si elle regrettait d’avoir fait médecine plutôt qu’une formation accélérée de dresseuse de félins. Même si, à en juger par l’expression dédaigneuse sur son visage, je ressemblais plutôt à une otarie inoffensive échouée dans son cabinet chic du XVIe arrondissement à Paris à cause de la mondialisation.
Pour me donner du courage, je me reconcentrai sur mon troubadour. Lui n’avait jamais peur de rien. Il affrontait la vie sans anesthésie. Cela ne lui avait pas mal réussi. Un peu réconfortée, je la laissai travailler.
Doc C observa longuement l’écran relié à son instrument. Et, évidemment, elle finit par lâcher :
— Dites, il est toujours aussi moche votre utérus.
J’avais envie de dire sur un ton détaché : « Décidément, c’est obsessionnel chez vous. Dans quel monde vivez-vous pour vous obstiner à considérer qu’un muscle reproductif puisse avoir la moindre valeur esthétique ? Avez-vous déjà pensé à consulter ? »
Je balbutiai :
— C’est grave ?
— Pas grave, non. Mais qu’est-ce que c’est moche ! répondit-elle en me tendant une demi-feuille de Sopalin version hard discount pour que je ne m’essuie pas tout à fait et que mon humiliation soit complète.
À ce moment précis, ma liste de vœux 2017 surgit dans mon cerveau. Elle me renvoya à la ligne 1 de ma « ne plus jamais faire liste » 2016. Il y a un an exactement, dans des circonstances identiques – presque, puisque le verdict de Cruella avait été : « hideux » –, je n’avais pu réprimer une larme. J’avais bégayé un remerciement. Payé la consultation. Oublié de remettre mes chaussettes. Mais, même à Paris, personne ne peut survivre pieds nus dans ses Converse avant les vacances de février. J’avais donc patienté, jusqu’à la fin de l’après-midi, planquée derrière un Kleenex, pour oser demander la permission de les récupérer en m’interrogeant sur la note qu’Isa donnerait à ma zone d’inconfort. Puis, j’avais encore patienté jusqu’à 20 heures pour que la femme de ménage me les rapporte. Elle n’en avait retrouvé qu’une seule. Une semaine plus tard, mon utérus et moi étions sous la couette avec 39 °C de fièvre.
Cette fois, je regardai Doc C bien droit dans les yeux, je lui offris mon sourire le plus pro – celui de la pub pour les cures thermales qui promettait de désintégrer le stress des trajets en métro passés à côté d’un psycho qui vous fixe façon Vol au-dessus d’un nid de coucou en pire – et je demandai :
— Vous pourriez me refaire cette expression ? Vous savez, légèrement cruelle et totalement excédée. J’essaye de faire le plein de nouvelles émotions, ça peut me servir pour mon nouveau boulot. Je vais tourner dans une série avec Lucie Adam, je vous l’ai dit, non ?
Elle lâcha son instrument. Laissa aussi tomber la mâchoire. Chercha ses mots. Un mot. En vain.
J’adorais 2017.
Et c’était réciproque.
.......................................
2
Extrait de Elle
Séries TV
Lucie Adam s’envole vers les séries
Au hit-parade des infos les plus excitantes du début de l’année, en plus de toutes celles qui concernent Ryan Gosling, la réhabilitation des choux à la crème, Pierre Niney, les choux à la crème et Ugo Belin, avec ou sans crème, c’est une info… télé qui l’emporte. The news 2017. Lucie Adam, récompensée l’an passé par le César de la meilleure actrice pour son rôle dans L’Âme délicate du pigeon – elle y interprétait l’errance poétique d’une femme carnivore qui, en nourrissant chaque jour les oiseaux avec les restes de ses repas, arrivait à se connecter spirituellement avec les volatiles – vient d’accepter le rôle principal dans JT, la nouvelle série de France Plus.
Elle retrouve donc le réalisateur Paul Marignan. « Le journal télévisé est le concentré d’une époque. Cette époque est la nôtre. C’est nous. La série est l’objet artistique majeur du XXIe siècle, JT était par conséquent un projet évident pour moi. J’ai envie d’une série folle, très conceptuelle, jamais vue. La première série française à l’américaine ! Mon producteur m’a donné carte blanche », affirme le réalisateur qui n’a pas eu de mal à convaincre la star de faire ses premiers pas à la télé.
« Je suis passionnément Game of Thrones, confie Lucie Adam. Depuis, j’ai une relation très particulière avec les dragons, je l’avoue. J’ai immédiatement été séduite lorsque Paul m’a proposé une série. J’adore le concept de JT. C’est enivrant de plonger dans les coulisses de la machine à fabriquer de l’information. Je suis follement excitée à l’idée de faire connaissance avec Fabienne, mon personnage. Une femme forte et fragile à la fois, absolument moderne et totalement solaire qui présente le journal télévisé le plus suivi de France. J’attends avec impatience aussi de vivre cette relation si particulière qu’une série fait naître entre l’acteur et le public. »
L’incandescent Ugo Belin, rescapé de la télé-réalité, incarnera Xavier Mosse, un reporter baroudeur sexy qui fait craquer Claire Legrand, une journaliste idéaliste (interprétée par Rose Simon, une jeune comédienne qui fait ses débuts). Le tournage de la saison 1 d’une série qui s’annonce comme l’événement culturel et esthétique de l’année débute ces jours-ci en région parisienne.
.............................................
3
Lui, Aragon, la série à l’américaine
et le tarama rose foncé
Benjamin Duval émergea de la bouche de métro place de la Concorde. Il avait toujours aimé marcher. Depuis un mois, il avait besoin de marcher. Il ignora la pluie glacée de février qui lui fouettait le visage. Il remonta le col de son blouson, enfonça son bonnet en shetland et traversa en courant le passage clouté devant l’hôtel Crillon. « C’est vert, connard ! Tu vois pas que le feu est VERT ! » lui lança le conducteur d’une berline Mercedes. Ben se retourna et lui montra son doigt.
Putain, je vais vraiment mal.
Il se dirigea vers l’automobiliste pour s’excuser de s’être laissé aller. L’autre lui montra deux doigts. Ben sourit. Il n’avait pas souri depuis un mois. Dans la nuit, il entama la remontée des Champs-Élysées en se demandant pourquoi des millions de touristes venaient y immortaliser leur séjour à Paris. Il ne se passait jamais rien de passionnant par ici.
La pluie s’intensifia et il regretta un instant de ne pas avoir pris un taxi. Il avait cru que traîner dans le métro lui ferait du bien. Il y avait des gens dans le métro. Et les gens, c’était son boulot. Ce que faisaient les gens, en fait. Il n’y a pas si longtemps, les doigts du gars dans la berline Mercedes lui auraient permis de remplir au moins dix pages dans son carnet Moleskine. Il lui aurait imaginé une vie au propriétaire de ces gros doigts dressés vers le ciel. L’hémisphère droit de son cerveau se serait immédiatement demandé pourquoi il ne portait pas de chevalière en or 18 carats gravée d’un R. Vu qu’il avait la tête d’un gars qui s’appelle Régis, c’est-à-dire celle d’un type qui porte une bague pareille, se fait épiler le dos et pratique l’amour tarifé pour essayer d’oublier que les seins de sa femme lui arrivent aux genoux.
Mais, depuis le 1er janvier, il n’imaginait plus grand-chose. À part un plan de reconversion. Une perspective déprimante pour le commun des mortels. Une tragédie pour un auteur. Des trombes d’eau s’abattaient sur lui maintenant.
Bien.
Ça l’empêcherait d’allumer la seule Marlboro qu’il trimbalait toujours dans sa poche intérieure à côté du Bic noir pointe épaisse qui glissait si rapidement sur les feuilles qu’il n’arrivait plus à noircir. Arrivé au rond-point des Champs-Élysées, il bifurqua avenue Montaigne. Son iPhone gémit. Il pria pour que ce petit cri annonce un mail de la malade qui le harcelait depuis la semaine dernière. Ses messages lui faisaient l’effet d’un défibrillateur. Ils avaient un peu ramené à la vie une partie de lui-même qui s’était fait la malle au petit matin. Comme ça. Sans prévenir. À l’heure de sa clope-café. Son traditionnel petit déjeuner. Au mieux, son imagination était dans le coma. Au pire, il devrait bientôt déclarer l’heure du décès.
Putain, ça fait chier.
Pour sauver son téléphone de la mort par noyade, il trouva refuge chez Louis Vuitton. Le portier eut l’air déconcerté par l’âge avancé du vieux cuir que Ben portait et jeta un regard désolé sur les godillots qu’il jugeait inutile de cirer. Pour prouver qu’il n’avait pas d’intention malhonnête, il enleva son bonnet et il esquissa un sourire qui signifiait : « Désolé vieux, mon Louis à moi, c’est plutôt Aragon. Sans rancune ? » Puis, sans attendre de savoir s’il était pardonné, il plongea le nez dans ses messages. La merveille technologique l’informa qu’il avait reçu un nouveau SMS. Il provenait d’un autre genre de malade. Celui qu’il devait rejoindre.
18.59 – Vlad
Tu fous quoi, là ?
19.00 – Ben1984
Je remonte le supermarché du luxe à ciel ouvert où tu as eu le mauvais goût de me donner RDV.
19.01 – Vlad
Poète disparu, mais toujours poète, donc. Ça tombe bien ! ACCÉLÈRE.
Ben hésita à rebrousser chemin. Puis il se rappela qu’il ne fallait jamais rien prendre personnellement avec Vlad. Depuis qu’ils s’étaient rencontrés en classe prépa à Louis-Le-Grand, son ami menait sa vie de la façon dont il écrivait ses textos, sans prendre de précautions. Raison pour laquelle ceux qui croisaient son chemin le considéraient comme un « connard magistral ». Souvent, d’ailleurs, dès les cinq premières minutes. Mais ils n’osaient jamais mettre des mots sur l’allergie qu’ils ressentaient car Vlad était aussi très efficace dans la vie. Sa carte de visite sur laquelle était imprimé Vladimir Shol, producteur heureux en était la preuve. À ceux qui lui demandaient de préciser, il répondait : « Mes bureaux sont place Vendôme, je vais à la gym au Ritz et j’ai ma table à l’année chez Costes. » Forcément, les gens oubliaient très vite « connard » et se concentraient sur « magistral ».
Vlad l’attendait sur une banquette de L’Avenue. L’endroit était bondé. Les gens parlaient fort pour être certains que personne n’ignore les détails du dossier sur lequel ils avaient bossé toute la journée. Son ami, lui, était surtout concentré sur les olives qu’il gobait toujours méthodiquement lorsqu’il réfléchissait.
Quand il lui avait laissé un message pour lui proposer un verre, Vlad n’avait pas mentionné qu’il s’agissait de boulot. Son costume Hugo Boss bleu marine et la cravate qu’il n’avait pas desserrée indiquaient que le producteur était très préoccupé. Ben le connaissait par cœur. Depuis l’âge de dix-huit ans et le matin où ils avaient simultanément décidé avec Max qu’ils n’avaient besoin que de deux amis. Mais de vrais. Après un cours d’économie consacré au taux de rendement maximal.
Ben se pencha pour l’embrasser. Des gouttes de pluie noyèrent le whisky sec qui accompagnait les olives.
— Tu bois quoi ? demanda Vlad.
— Je sens que ce n’est pas un jour à te laisser tomber. Alors pareil. On attend Max ?
À peine avait-il esquissé un geste de la main que la serveuse se précipita pour prendre la commande. Vlad était un producteur heureux à temps plein.
— Nan. Il est coincé dans son épicerie par un producteur de pinard qui lui promet que ses bouteilles miraculeuses vont faire exploser son chiffre d’affaires.
— C’est pour la bonne cause alors, dit Ben.
— Ça aussi, c’est pour la bonne cause, répondit Vlad en sortant de sa serviette en cuir un document format A4 relié qu’il fit glisser vers Ben. J’aimerais que tu jettes un œil et que tu me dises ce que t’en penses. J’ai un doute.
.................................................................................................................................................................
Biographie:
Née à , Paris
Marianne Levy est une auteure de comédies romantiques.
Elle a fait des études de droit, puis a été journaliste sportive. Après des années passées à couvrir des événements sportifs majeurs comme les Jeux olympiques pour plusieurs quotidiens nationaux, elle a poursuivi sa carrière de reporter dans les coulisses de la télévision.
Depuis plus de dix ans, comme critique, elle écrit notamment sur les séries françaises, américaines et internationales.
La journaliste a également été chroniqueuse télé dans le talk radio culturel, animé des débats consacrés à l'écriture et été jurée dans des festivals de fiction télé.
Après avoir suivi les masterclass du script-doctor John Truby, elle concrétise son désir de raconter des histoires et signe "La Malédiction de la zone de confort" aux éditions Pygmalion en 2017. Puis "Chaussures à son pied" en 2019, chez le même éditeur. Son roman "Dress Code et petits secrets" est paru le 9 octobre 2019.
Elle est membre de la #TeamRomCom le collectif d'auteures de comédies romantiques à la française.
Anéantir
Résumé:
L'intrigue débute au mois de novembre 2026, quelques mois avant le début de l'élection présidentielle de 2027. Le personnage principal, Paul Raison, fonctionnaire auprès du Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, âgé d'une quarantaine d'années, travaille au cabinet du ministre Bruno Juge, avec lequel il entretient également des liens d'amitié. Le climat politique est marqué par des attentats terroristes, qui épargnent dans un premier temps les vies humaines. Ceux-ci sont extrêmement sophistiqués et font appel à des moyens militaires importants, sans que cela soit aisément possible d'évaluer les motivations profondes des auteurs.
Le père de Paul, Edouard Raison, est un ancien membre des services secrets.
Paul entretient des liens distants avec sa femme Prudence, également fonctionnaire. Paul a une sœur catholique pratiquante, Cécile, qui est mariée à un notaire au chômage, Hervé. Le couple habite à Arras et vote ouvertement pour le Rassemblement national. Enfin, Paul a un petit frère, Aurélien, qui travaille comme restaurateur d’œuvres d'art au ministère de la culture et est marié à une femme détestable nommée Indy.
Personnages
Bastien Doutremont : un informaticien quadragénaire travaillant à la DGSI
Fred : un informaticien quadragénaire travaillant à la DGSI
Bruno Juge : le Ministre de l'Économie et des Finances, et du Budget
Paul Raison : un fonctionnaire du Ministère de l'Économie et des Finances, et du Budget
Prudence : une fonctionnaire de la direction du Trésor, la compagne de Paul Raison
Édouard Raison : le père de Paul Raison
Madeleine : la compagne d'Édouard Raison
Suzanne Raison : la mère de Paul Raison, restauratrice d'art
Cécile Raison : la sœur de Paul Raison (et fille d'Édouard et Suzanne Raison)
Hervé : époux de Cécile Raison, et notaire au chômage
Anne-Lise : fille de Cécile Raison et de son époux Hervé
Aurélien Raison : le frère de Paul Raison (et fils d'Édouard et Suzanne Raison), restaurateur d'art
Véronique : ancienne compagne de Paul Raison
Maryse : aide-soignante béninoise
Le personnage de Bruno Juge, Ministre de l'Économie et des Finances, et du Budget, fait probablement référence à Bruno Le Maire (Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance au moment de la parution du roman). Bruno Le Maire, qui revendique être l'un des proches de Michel Houellebecq, a en octobre 2021 révélé quelques éléments de l'intrigue du roman encore à paraître
..........................................................................................................................................................
UN
1
Certains lundis de la toute fin novembre, ou du début de décembre, surtout lorsqu’on est célibataire, on a la sensation d’être dans le couloir de la mort. Les vacances d’été sont depuis longtemps oubliées, la nouvelle année est encore loin ; la proximité du néant est inhabituelle.
Le lundi 23 novembre, Bastien Doutremont décida de se rendre au travail en métro. En descendant à la station Porte de Clichy, il se retrouva en face de cette inscription dont lui avaient parlé plusieurs de ses collègues les jours précédents. Il était un peu plus de dix heures du matin ; le quai était désert.
Depuis son adolescence, il s’intéressait aux graffitis du métro parisien. Il les prenait souvent en photo, avec son iPhone désuet – on devait en être à la génération 23, il s’était arrêté à la 11. Il classait ses photos par stations et par lignes, de nombreux dossiers sur son ordinateur y étaient consacrés. C’était un hobby si l’on veut, mais il préférait l’expression en principe plus douce, mais au fond plus brutale, de passe-temps. Un de ses graffitis préférés était d’ailleurs cette inscription, en lettres penchées et précises, qu’il avait découverte au milieu d’un long couloir blanc de la station Place d’Italie, et qui proclamait avec énergie : « Le temps ne passera pas ! »
Les affiches de l’opération « Poésie RATP », avec leur étalage de niaiseries molles qui avaient un temps submergé l’ensemble des stations parisiennes, jusqu’à se répandre par capillarité dans certaines rames, avaient suscité chez les usagers des réactions de colère désaxées, multiples. Il avait ainsi pu relever, à la station Victor Hugo : « Je revendique le titre honorifique de roi d’Israël. Je ne peux faire autrement. » À la station Voltaire, le graffiti était plus brutal et plus angoissé : « Message définitif à tous les télépathes, à tous les Stéphane qui ont voulu perturber ma vie : c’est NON ! »
L’inscription de la station Porte de Clichy n’était à vrai dire pas un graffiti : en lettres épaisses énormes, de deux mètres de haut, tracées à la peinture noire, elle s’étendait sur toute la longueur du quai en direction Gabriel Péri-Asnières-Gennevilliers. Même en passant sur le quai opposé, il lui avait été impossible de la cadrer entièrement, mais il avait pu découvrir le texte dans son intégralité : « Survivances de monopoles / Au cœur de la métropole ». Cela n’avait rien de très inquiétant, ni même de très explicite ; c’était pourtant le genre de choses qui pouvaient susciter l’intérêt de la DGSI, comme toutes les communications mystérieuses, obscurément menaçantes, qui envahissaient l’espace public depuis quelques années, qu’on ne pouvait attribuer à aucun groupuscule politique clairement répertorié, et dont les messages Internet qu’il était chargé d’élucider en ce moment étaient l’exemple le plus spectaculaire et le plus alarmant.
Sur son bureau, il trouva le rapport du laboratoire de lexicologie ; il était arrivé à la première distribution du matin. L’examen par le laboratoire des messages attestés avait permis d’isoler cinquante-trois lettres – des caractères alphabétiques, et non des idéogrammes ; les espacements avaient permis de répartir ces lettres en mots. Ils s’étaient ensuite attachés à établir une bijection avec un alphabet existant, et avaient fait leur première tentative avec le français. De manière inespérée, cela semblait pouvoir correspondre : si l’on ajoutait aux vingt-six lettres de base les caractères accentués et ceux dotés d’une ligature ou d’une cédille, on obtenait quarante-deux signes. Traditionnellement, on recensait par ailleurs onze signes de ponctuation, ce qui permettait d’obtenir un total de cinquante-trois signes. Ils se retrouvaient donc face à un problème de décryptage classique, consistant à établir une correspondance biunivoque entre les caractères des messages et ceux de l’alphabet français au sens large. Malheureusement, après deux semaines d’efforts, ils s’étaient retrouvés face à une impasse totale : aucune correspondance n’avait pu être établie, par aucun des systèmes de cryptage connus ; c’était la première fois que cela se produisait, depuis la création du laboratoire. Diffuser sur Internet des messages que personne ne parviendrait à lire était évidemment une démarche absurde, il y avait forcément des destinataires ; mais qui ?
Il se leva, se prépara un expresso et marcha jusqu’à la baie vitrée, sa tasse à la main. Une luminosité aveuglante se réverbérait sur les parois du tribunal de grande instance. Il n’avait jamais trouvé aucun mérite esthétique particulier à cette juxtaposition déstructurée de gigantesques parallélépipèdes de verre et d’acier, qui dominait un paysage boueux et morne. De toute façon le but poursuivi par les concepteurs n’était pas la beauté, ni même vraiment l’agrément, mais plutôt l’étalage d’un certain savoir-faire technique – comme s’il s’agissait, avant tout, d’en mettre plein la vue à d’éventuels extraterrestres. Bastien n’avait pas connu les bâtiments historiques du 36, quai des Orfèvres, et n’en éprouvait par conséquent aucune nostalgie, contrairement à ses collègues plus âgés ; mais il fallait bien reconnaître que ce quartier du « nouveau Clichy » évoluait jour après jour vers le désastre urbain pur et simple ; le centre commercial, les cafés, les restaurants prévus dans le plan d’aménagement initial n’avaient jamais accédé à l’existence, et se détendre en dehors du cadre de travail pendant la journée était devenu, dans les nouveaux locaux, presque impossible ; on n’avait, par contre, aucune difficulté à se garer.
Une cinquantaine de mètres plus bas, une Aston Martin DB11 pénétra dans le parking visiteurs ; Fred était arrivé, donc. C’était un trait étrange, chez un geek comme Fred, qui aurait logiquement dû acheter une Tesla, cette fidélité aux charmes désuets du moteur à explosion – il restait parfois des minutes entières à rêvasser en se berçant du ronronnement de son V12. Il finit par sortir, claqua la portière derrière lui. Avec les procédures de sécurité de l’accueil, il serait là dans dix minutes. Il espérait que Fred avait du nouveau ; c’était même, à vrai dire, son dernier espoir de pouvoir faire état d’une avancée quelconque lors de la prochaine réunion.
Lorsqu’ils avaient, sept ans auparavant, été embauchés comme contractuels par la DGSI – à un salaire plus que confortable pour des jeunes gens dépourvus du moindre diplôme, de la moindre expérience professionnelle – l’entretien d’embauche s’était résumé à une démonstration de leurs capacités d’intrusion dans différents sites Internet. Devant la quinzaine d’agents de la BEFTI et d’autres services techniques du ministère de l’Intérieur réunis pour l’occasion, ils avaient expliqué comment, une fois entrés dans le RNIPP, ils pouvaient, d’un simple clic, désactiver ou réactiver une carte Vitale ; comment ils procédaient pour pénétrer sur le site gouvernemental des impôts, et de là pour modifier, très simplement, le montant des revenus déclarés. Ils leur avaient même montré – la procédure était plus lourde, les codes étaient changés régulièrement – comment ils parvenaient, une fois introduits dans le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, à modifier ou à détruire un profil ADN, même dans le cas d’un individu déjà condamné. La seule chose qu’ils avaient estimé préférable de passer sous silence, c’était leur incursion sur le site de la centrale nucléaire de Chooz. Pendant quarante-huit heures ils avaient pris la main sur le système, et ils auraient pu déclencher une procédure d’arrêt en urgence du réacteur – privant ainsi d’électricité plusieurs départements français. Ils n’auraient par contre pas pu déclencher d’incident nucléaire majeur – il demeurait pour pénétrer au cœur du réacteur une clef de cryptage à 4096 bits, qu’ils n’avaient pas encore craquée. Fred avait un nouveau logiciel de craquage, qu’il avait été tenté de lancer ; mais d’un commun accord ils avaient décidé, ce jour-là, qu’ils étaient peut-être allés trop loin ; ils étaient ressortis, effaçant toutes les traces de leur intrusion, et n’en avaient plus jamais reparlé – ni à personne, ni même entre eux. Cette nuit-là, Bastien avait fait un cauchemar où il était poursuivi par des chimères monstrueuses composées d’assemblages de nouveau-nés en décomposition ; à la fin de son rêve, le cœur du réacteur lui était apparu. Ils avaient laissé passer plusieurs jours avant de se revoir, ils ne s’étaient même pas téléphoné, et c’est sans doute à partir de ce moment qu’ils avaient, pour la première fois, envisagé de se mettre au service de l’État. Pour eux, dont les héros de jeunesse avaient été Julian Assange et Edward Snowden, collaborer avec les autorités n’avait rien d’évident, mais le contexte du milieu des années 2010 était particulier : la population française, à la suite de différents attentats islamistes meurtriers, s’était mise à soutenir, et même à éprouver une certaine affection pour sa police et son armée.
Fred, cependant, n’avait pas renouvelé son contrat avec la DGSI au bout de la première année ; il était parti créer Distorted Visions, société spécialisée dans les effets spéciaux numériques et l’image de synthèse. Au fond Fred, contrairement à lui, n’avait jamais vraiment été un hacker ; il n’avait jamais vraiment ressenti ce plaisir, un peu analogue à celui du slalom spécial, qu’il éprouvait à contourner une succession de firewalls, ni cette ivresse mégalomane qui l’envahissait lorsqu’il lançait une attaque par force brute, mobilisant des milliers d’ordinateurs zombies afin de décrypter une clef particulièrement retorse. Fred, comme son maître Julian Assange, était avant tout un programmeur né, capable de maîtriser en quelques jours les langages les plus sophistiqués apparaissant sans cesse sur le marché – et il avait utilisé cette aptitude pour écrire des algorithmes de génération de formes et de textures totalement innovants. On parle souvent de l’excellence française dans le domaine de l’aéronautique ou de l’espace, on pense plus rarement aux effets spéciaux numériques. La société de Fred avait régulièrement pour clients les plus gros blockbusters hollywoodiens ; cinq ans après sa création, elle avait déjà atteint le troisième rang mondial.
Lorsqu’il pénétra dans son bureau avant de s’affaler sur le canapé, Doutremont comprit immédiatement que les nouvelles seraient mauvaises.
« En effet, Bastien, je n’ai rien de très réjouissant à t’annoncer, confirma Fred aussitôt. Bon, je vais déjà te parler du premier message. Je sais, ce n’est pas celui qui vous intéresse ; mais, quand même, la vidéo est curieuse. »
La première fenêtre surgissante était passée inaperçue de la DGSI ; elle avait essentiellement parasité des sites d’achat de billets d’avion et de réservation d’hôtels en ligne. Comme les deux suivantes, elle était constituée d’une juxtaposition de pentagones, de cercles et de lignes de texte à l’alphabet indéchiffrable. Lorsqu’on cliquait n’importe où à l’intérieur de la fenêtre, la séquence démarrait. La vue était prise d’un surplomb, ou d’un aérostat en vol stationnaire ; c’était un plan fixe d’une dizaine de minutes. Une immense prairie d’herbes hautes s’étendait jusqu’à l’horizon, le ciel était d’une limpidité parfaite – le paysage évoquait certains états de l’Ouest américain. Sous l’effet du vent, d’immenses lignes rectilignes se formaient dans la surface herbeuse ; puis elles se croisaient, dessinant des triangles et des polygones. Tout se calmait, la surface redevenait étale, à perte de vue ; puis le vent soufflait de nouveau, les polygones se remboîtaient, quadrillant lentement la plaine, jusqu’à l’infini. C’était très beau, mais ne suscitait aucune inquiétude particulière ; le bruit du vent n’avait pas été enregistré, la géométrie de l’ensemble se développait dans un silence total.
« Ces derniers temps, on a réalisé pas mal de scènes de tempête en mer pour des films de guerre, dit Fred. Une surface d’herbe de cette taille, ça se modélise à peu près comme un plan d’eau de taille équivalente – pas l’océan, plutôt un grand lac. Et ce que je peux te dire avec certitude, c’est que les figures géométriques qui se forment dans cette vidéo sont impossibles. Il faudrait supposer que le vent souffle en même temps de trois directions différentes – et, à certains moments, de quatre. Donc, je n’ai aucun doute : c’est de l’image de synthèse. Mais ce qui me pose une vraie question, c’est qu’on peut agrandir l’image autant qu’on veut, les brins d’herbe de synthèse ressemblent toujours autant à des brins d’herbe véritables ; et ça, normalement, ce n’est pas faisable. Il n’y a pas deux brins d’herbe identiques dans la nature ; ils ont tous des irrégularités, des petits défauts, une signature génétique spécifique. On en a agrandi mille, en les choisissant de manière aléatoire dans l’image : ils sont tous différents. Je suis prêt à parier que les millions de brins d’herbe présents dans la vidéo sont tous différents ; c’est hallucinant, c’est un travail de dingue ; on pourrait peut-être le faire, chez Distorted, mais pour une séquence de cette longueur ça nous prendrait des mois de temps de calcul. »
.............................................................................................................................................................
Bio:
Michel Houellebecq, né Michel Thomas à St-Pierre de la Réunion, le 26 février 1956 (acte de naissance), ou en 1958 (selon lui), est un écrivain français. Poète, essayiste, romancier et réalisateur, il est, depuis la fin des années 1990, l'un des auteurs contemporains de langue française les plus vendus et traduits à l'étranger. Il a également fait quelques apparitions remarquées en tant qu'acteur.
Après la publication d'une biographie de Lovecraft, il est révélé par les romans "Extension du domaine de la lutte" et, surtout, "Les particules élémentaires", qui le fait connaître d'un large public. Ce dernier roman, et son livre suivant, "Plateforme", sont considérés comme précurseurs dans la littérature française, notamment pour leur description au scalpel, mais non sans humour, de la misère affective et sexuelle de l'homme occidental dans les années 1990 et 2000.
Avec "La carte et le territoire", Michel Houellebecq reçoit le prix Goncourt en 2010, après avoir été plusieurs fois pressenti pour ce prix.
En janvier 2015, il publie un livre où il imagine la France dirigée par un parti musulman : "Soumission". L'écrit fait polémique.
Il reçoit le prix de la BnF 2015 pour l’ensemble de son œuvre.
Il reçoit la Légion d'Honneur le 1er janvier 2019.
Un jour ce sera vide.
RÉSUMÉ/
"C’est un été en Normandie. Le narrateur est encore dans cet état de l’enfance où tout se vit intensément, où l’on ne sait pas très bien qui l’on est, où une invasion de fourmis équivaut à la déclaration d’une guerre qu’il faudra mener de toutes ses forces. Un jour, il rencontre un autre garçon sur la plage, Baptiste. Se noue entre eux une amitié d’autant plus forte qu’elle se fonde sur un déséquilibre : Baptiste a des parents parfaits, habite dans une maison parfaite. Sa famille est l’image d’un bonheur que le narrateur cherche partout, mais qui se refuse à lui. Flanqué d’une grand-mère à l’accent prononcé, et d’une tante « monstrueuse », notre narrateur rêve, imagine, se raconte des histoires, tente de surpasser la honte sociale et familiale qui le saisit face à son nouvel ami. Il entre dans une zone trouble où le sentiment d’appartenance est ambigu : vers où va, finalement, sa loyauté ? Écrit dans une langue ciselée et très sensible, Un jour ce sera vide est un roman fait de silences et de scènes lumineuses qu’on quitte avec la mélancolie des fins de vacances.
.......................................................................................................................................................................
PREMIÈRE PARTIE
BAPTISTE
1
Les Méduses
L’enfant est à contre-jour. On distingue à peine son visage encadré par une chevelure lisse de vrai garçon. D’abord, il n’est que la cordelette de son slip de bain rouge ou bleu, qui s’approche, jambes graciles, pour observer le spectacle immobile dont je jouissais pour moi seul. Puis-je continuer sans crainte l’auscultation de la méduse à l’aide du bâton ? Plusieurs vagues passent, inondant la petite île de chair translucide avant que j’ose tâter de nouveau. Je presse légèrement la peau épaisse, mais ce n’est déjà plus l’essentiel. L’unique chose qui compte est désormais cette présence entre le soleil et moi. Un garçon de mon âge. Je me cramponne au bâton, orteils griffés dans le sable mouillé à la recherche d’un appui, tandis que la vague qui ruisselle sur la vague qui se retire me donne le vertige. « Tu la retournes ? » Nulle trace de défi dans la voix qui m’invite à poursuivre mes investigations. Une familiarité même, que je n’attendais pas. Mais je sais qu’il suffit d’une maladresse de ma part, un geste trop craintif par exemple, pour que cesse ce moment de grâce où rien n’existe entre nous sinon un peu de curiosité et cette masse compacte et urticante qui ressemble à un extraterrestre. Chaque seconde nous rapproche du moment où il faudra dévoiler plus de soi qu’on ne voudrait. Alors sans un mot, profitant de la poussée du ressac, j’exécute la manœuvre : voilà l’animal sens dessus dessous, ses longs filaments offerts à la morsure du soleil et à notre innocente cruauté. Je m’accroupis pour discerner dans les méandres gluants ce qui pourrait être une larme, un œil, un visage. L’enfant aussi s’approche, frôlant mon épaule de ses cheveux mouillés dont une goutte froide se détache et coule lentement le long de mon bras. Trajet affolant de ce don de sel sur ma peau. « On dirait un sac plastique ». Je lève le visage vers celui du garçon qui sourit, qui semble souriant autant que je puisse en juger tant je suis ébloui. Par le filet de mes yeux plissés, j’aperçois deux grands yeux verts et entre ses lèvres entrouvertes l’espace vide laissé par la chute d’une dent. J’imagine, dans un flash, le cadeau ou la pièce glissés sous l’oreiller épais, le baiser d’une mère, des volets qu’on ouvre sur le chahut d’une famille en vacances. « On la remet à l’eau ? » Les mots sortent plus doux que je ne l’aurais voulu, je trouve ma voix sotte, comme si elle trahissait une vérité qui me paraît soudain tragique et ridicule : je n’ai parlé à personne d’autre qu’à ma grand-mère depuis mon arrivée, autant dire depuis toujours. « À l’eau ? », le corps se déplie en guise de désapprobation. « Et si on la tuait ? » Je regarde ses pieds, ses pieds à lui, indifférents au sol qui se dérobe sous les vagues, indifférents à l’écume, et j’imagine aux orties, aux ronces et à tout ce qui se croit assez important pour les empêcher d’avancer. « Il faut la crever pour voir comment c’est dedans. » J’examine l’enfant qui me surplombe dans sa toute-puissance. Moi accroupi, un bâton tordu à la main, le visage déformé par la lumière, et sa demande me paraît d’autant plus légitime que je n’aimerais rien tant que de savoir de quoi il est fait dedans. Lui. De quel fluide magique ses veines sont parcourues pour donner cet éclat mat à tout son être. Alors je me lève, et avec une lassitude de vieux berger, j’enfonce le bâton en tournant dans la masse gélatineuse, à l’endroit qui m’a paru le plus tendre. Comme rien ne se produit je plonge encore la pointe jusqu’à déchirer la bête en deux. Elle est dure, insensible, comme une viande trop coriace, morte depuis des millénaires. J’abats un cadavre et la sueur accumulée dans mes cils coule soudain sur mes joues, larmes brûlantes qui effacent l’enfant, la plage et cette méduse que je sacrifie à la promesse d’une amitié estivale.
...................................................
2
La Mouche
Est-ce que, comme une cellule, la méduse peut survivre à sa propre division ? La question flotte à la surface de mon esprit alors qu’immobile sur un fauteuil, j’aspire de minuscules gorgées de jus d’orange pétillant. Avec la paille, j’imite la mouche qui s’abreuve de lymphe sur mon genou, sa trompe plantée dans le petit lac d’une plaie dont j’arrache toute tentative de cicatrisation depuis des jours. Il faut bouger le moins possible, ne pas l’effrayer pour profiter encore un peu de sa présence. Comme avec le garçon qui ne m’a pas donné son prénom, mais que j’ai saisi au vol alors que sa mère le hélait. « Baptiste ». À cet appel, il a haussé les épaules et m’a dit « À demain », comme si on tuait ensemble des méduses à heure fixe depuis des années. « À demain. » Me voilà l’heureux destinataire d’un rendez-vous. Pour la première fois depuis mon arrivée j’ai quelque chose à faire. Un projet. Une foule de questions aussi. Est-ce qu’il a voulu dire demain à la même heure ? Est-ce qu’il a dit « demain » comme il aurait dit « à bientôt » ? Voulait-il dire qu’on allait rejouer ensemble ou seulement se saluer d’un signe de tête ? Est-ce lui qui va venir me chercher ? Faut-il l’attendre au même endroit ? Que va-t-on faire ensemble ? Cette rencontre a-t-elle vraiment eu lieu ? Tout, jusqu’à l’existence des méduses, semble soudain discutable. Je ne suis même plus certain d’être allé à la plage ce matin. Pour le vérifier, il faudrait aller dans l’entrée voir si les nattes de paille dans le meuble à patères luisent de sable humide, si les sandales de plastique accusent encore leur séjour dans la vase et s’il tombe toujours des gouttes d’eau du maillot de bain, aussitôt transformées en taches blanches et salées par le métal bouillant du balcon. Mais quand bien même je trouverais le courage de traverser l’écrasante masse d’air chaud du salon pour en avoir le cœur net, les nattes, les sandales et le maillot de bain offriraient une résistance immobile. Amnésiques, comme tous les objets qui m’entourent. J’aspire une nouvelle gorgée de jus d’orange. J’aspire tout le jus d’orange jusqu’à faire crisser la paille au fond du verre, histoire de briser le silence. Devant moi s’étalent les rares jouets avec lesquels je tente parfois de faire avancer le temps. Des jouets vieux de tant d’étés que je ne me souviens pas les avoir jamais désirés. Ils attendent là, comme les casse-tête d’un ennui dont je ne sais plus comment me démêler. J’ignore vers quel destin pourrait rouler cette voiture rouge, ni de quelles aventures devrait triompher ce soldat articulé. Qu’ils se débrouillent, je ne peux plus rien pour eux : toutes mes tentatives finissent invariablement en catastrophes dont les circonstances me laissent un goût de fer rouillé dans la gorge. Que faire d’autre du haut d’un buffet que de sauter quand seul, on a survécu à la défaite de son armée ? À part accélérer dans le vide, que peut espérer une corvette lancée à plein régime sur une commode ? Et cette poupée de chiffon aux yeux cousus de noir ressemble trop à un cadavre pour incarner l’espoir. Alors je ne fais rien d’autre qu’attendre que ma grand-mère se réveille de sa sieste et que reprenne la valse des tâches ménagères qui rythment nos journées. Petit-déjeuner, se laver, s’habiller, déjeuner, dîner, se baigner, se déshabiller, se coucher. Notre vie est une symphonie de robinets qui coulent, de chasses tirées, de bains vidés, de vaisselle lavée, de linge essoré. Et pour se divertir de ce déluge : la mer. Un milliard de milliards de mètres cubes d’apathie liquide devant lesquels s’ébrouent des familles ordinaires. D’un geste, je congédie la mouche dont l’acharnement a fini par m’irriter. La pendule sonne 15 heures tandis que mon unique distraction s’envole par la fenêtre.
........................................................
3
Le Baptême
Caché sous le parasol, allongé sur une natte, une visière masquant mes yeux, j’observe le ballet des familles sur la plage. Mieux, je l’absorbe. L’intimité en plein air révèle quelques-uns des mystères tant convoités de la vie quotidienne des vrais enfants : l’onde paternelle pour laquelle on érige des châteaux, l’embarrassante attention des mères. Mais aujourd’hui je ne m’abandonne pas totalement. Je guette parmi les taches lointaines celle qui, en se précisant, dessinera la silhouette de Baptiste, prêt à passer par la lame de mon bâton toutes les méduses de Normandie pour lui plaire. « Tu viens ? » Le voilà qui se tient devant moi, le soleil dans le dos, m’obligeant une fois encore à lever des yeux plissés vers lui pour ne voir qu’une ombre de son visage. Il m’a surpris, terré, mes jouets dérisoires ridiculement étalés autour de moi, marmonnant pour mes chimères. Mais surtout, il a surpris à mes côtés cette grosse dame en maillot de bain une pièce, le visage profondément ridé, enfoncée sur une petite chaise pliante à motif tournesol, qui tricote à l’ombre d’un parasol usé. Ma grand-mère adorée. Si étrangère à la plage qu’elle ne semble pas affectée par la chaleur. Moi elle m’accable, mais pas tant que la présence de Baptiste. Debout, ne sachant pas comment me tenir, j’éloigne mon camarade d’une main maladroite, en parlant trop vite de tout ce qui me vient à l’esprit pour saturer le sien et brouiller dans sa mémoire l’image fugace de notre petit campement. Mais je n’ai pas fait deux pas que l’accent de ma grand-mère vient y fixer pour toujours mon étrangeté. « Ne retournez pas trop tard », choisit-elle de dire dans un éboulement de r sonores et roulés. Baptiste jette un œil par-dessus son épaule, fronce les sourcils, narines légèrement écartées, puis revient à la conversation, comme s’il avait mal entendu. Feignant l’indifférence, je continue à l’attirer vers la mer où une rangée de méduses monte la garde devant les vagues. « Tu crois qu’elles sentent la douleur ? » L’assurance avec laquelle, la veille, j’ai déchiqueté le pauvre animal me vaut aujourd’hui un statut tout à fait enviable dans le monde de mon nouvel ami, à commencer par le fait d’être son « copain ». « J’ai un autre copain, me dit-il, j’ai un autre copain qui sait attraper les serpents. » Je profiterai plus tard de la joie de cette comparaison, tout occupé que je suis par les mille responsabilités qu’impliquent mes nouvelles attributions. ...
....................................................................................................................................................................
Bio/
Né à : Paris , le 21/10/1978.
Hugo Lindenberg est un écrivain et journaliste français.
Il est diplômé en 2001 d’une maitrise de droit public à l’'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, puis d’un master de journalisme de l’ESJ Lille en 20052. Hugo Lindenberg devient alors journaliste de presse écrite pour divers magazines, notamment Ça m'intéresse et Les Inrocks.
En 2012, il participe au lancement du magazine Neon. L’année suivante, il devient rédacteur en chef adjoint du magazine Stylist. Il est également rédacteur en chef de Machin Chose, un magazine masculin gratuit à partir de 2017. Il exerce ses fonctions jusqu’en 2018. Depuis 2019, il est journaliste indépendant.
Il publie son premier roman "Un jour ce sera vide" aux Christian Bourgois éditeur en 2020 qui reçoit le prix du Livre Inter en juin 2021.
JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME
La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et libre aussi, la femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée.
Appeler les femmes « le sexe faible » est une diffamation; c'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes.
Discours pendant la marche du sel -Ghandi